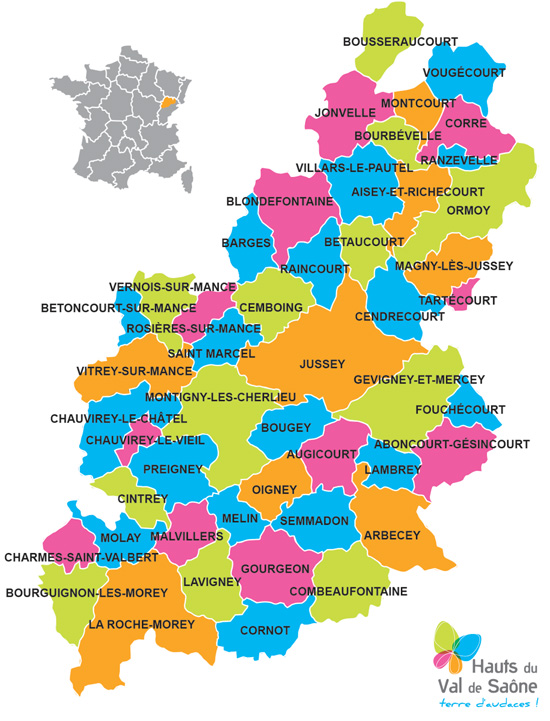« le gouvernement à confirmé que le calcul des émissions étaient théorique »
« on peut visualiser la profondeur de la modulation à la baisse du nucléaire à chaque pic de production renouvelable »
Ainsi, la Programmation pluriannuelle de l'énergie — PPE, qui définit la politique énergétique nationale, est fondée sur :- des calculs théoriques;
- l'hypothèse de l' ADEME selon laquelle : « les EnR se substituent essentiellement au charbon et au gaz. »
Et, donc : favorisent le développement massif des EnR — éolien et solaire !
Or, l'analyse des données de production électrique démontre que, dans les faits, les EnR remplacent essentiellement la production nucléaire décarbonée, plutôt que celle des énergies fossiles.
Dans ce contexte, la stratégie européenne et, donc, nationale, portée par des agences dédiées, ne peut-elle pas être perçue comme la simple propagation d'un narratif — ou fake news ?, afin de servir ... le puissant lobby des énergies renouvelables ? Et le sauvetage de la planète dans tout cela ?...
« Mais la fausseté n’a jamais empêché une vue de l’esprit de prospérer quand elle soutenue par l’idéologie et protégée par l’ignorance. L’erreur fuit les faits lorsqu’elle satisfait un besoin. »
REVEL Jean-François, L’Obsession antiaméricaine
php
***
EnR et CO2 réputé évité : entre supposition
et constat
Mécaniquement, l’empreinte carbone du kWh de chaque moyen de production publié dans la base empreinte de l’ ADEME appliqué au bilan électrique 2024 de RTE permet de calculer qu’en 2024, les EnR intermittentes — EnRi, ont permis d’éviter une moyenne de 6,85gCO2/kWh au mix français, déjà décarboné à plus de 90% depuis ¼ de siècle grâce à son parc nucléaire/hydraulique. Ce calcul de base, développé ci-dessous, est bien loin des 481,4gCO2/kWh avancé par RTE ou des différentes estimations de l’ ADEME dont les variations du simple au double — entre 300gCO2/kWh et 600gCO2/kWh, illustrent le manque de rigueur.

En effet, ces différents calculs théoriques reposent sur une omission majeure et comportent 3 biais méthodologiques. L’omission étant les émissions liées à l’empreinte carbone de la mise en œuvre des EnR, en considérant uniquement 0gCO2/kWh pour leur phase production, alors que l’analyse de leur cycle complet montre notamment que les émissions du solaire, avec 43,9gCO2/kWh, dans cette
base empreinte de l’ ADEME, sont même supérieures à l’empreinte du mix français 2024 que ce calcul indique à 30,44gCO2/kWh*.
Les 3 biais reposent sur le postulat que les EnRi se substituent principalement au thermique en raison de son coût marginal supérieur, alors que concrètement les contraintes de l’équilibre du réseau amène celui-ci à rester présent, voire en préchauffe, pour lisser leur production, tout en dégradant ses facteurs de pollution par les régimes partiels et à coups de fonctionnement induits par ce lissage. Et que d’autre part, les conséquences sur le marché des surplus aléatoires force le nucléaire à s’effacer.
Le 3ème biais consistant à comptabiliser les émissions induites par nos exportations hors frontières, là où l’intérêt pour les EnRi n’est pas celui de la France, alors que celle-ci peine à respecter des engagements financièrement contraignants sur ses émissions nationales. Les
rebondissements juridiques concernant les éventuelles sanctions contre l’excès des émissions françaises planant
à nouveau devant le TA de Paris depuis le
13 décembre 2024. Et aucune circonstance atténuante n’est évoquée pour cet effet de décarbonation des mix électriques de nos voisins pour lesquels ce n’est pas au consommateur français de payer.
Le calcul en question La
base empreinte de l’ ADEME fait état de l’empreinte carbone du cycle de vie de chaque filière française de production d’électricité dont notamment : 3,7gCO2/kWh pour le nucléaire, 14,1g pour l’éolien terrestre, 15,6g pour l’éolien en mer et 43,9g pour le solaire —
fabriqué en Chine et retenu par défaut par l’ ADEME pour la France.
En appliquant ces valeurs à chaque moyen de production du
Bilan RTE 2024, on parvient à des émissions totales de 16,41 millions de tonnes — Mt de CO2, soit une empreinte carbone de 30,44gCO2 pour chacun des 539 milliards de kWh produits en 2024.
Si on retranchait la production des EnRi — éolien + solaire, de ce bilan, la production serait ramenée à 467,4TWh, pour 14,65 Mtonnes de CO2, soit une moyenne de 31,35gCO2 pour une production uniquement pilotable et supérieure aux 449,2 TWh de la consommation
2024. Ce qui, avec 18,2TWh de solde exportateur n’en aurait pas moins placé la France au rang de
2ème exportateur mondial d’électricité derrière la Suède — 33TWh, et devant la Norvège — 18TWh, au lieu de 1er mondial avec un solde export de 89TWh.
En tenant ainsi compte
des émissions bien réelles liées au béton, à l’acier, au transport et au démantèlement de chaque filière, ces valeurs de l’ ADEME indiquent que sur
les 16,41 MtCO2 totaux, éolien et solaire ont été responsables de 1,75 MtCO2, respectivement 603,4 ktonnes de CO2 pour les 42,8 TWh d’éolien terrestre, 62,4ktonnes pour les 4 TWh d’éolien en mer, et 1088,7ktonnes pour les 24,8TWh de solaire. En considérant ainsi leur cycle de vie, les 71,6TWh produits par les EnRi
en 2024 auront donc émis 1,75Mt de CO2, soit une moyenne de 24,5gCO2/kWh, en remplacement des 2,24Mt qu’auraient émis les 31,35gCO2/kWh d’un mix français privé d’ EnRi pour produire ces mêmes 71,6TWh, soit 490,6ktonnes de CO2 mécaniquement évité par la production de 71,6TWh d’éolien et solaire, c'est-à-dire 6,85gCO2 évité par kWh d’ EnRi.
Les biais
Pour parvenir à ses différentes estimations, l’ ADEME considère que les EnRi se substituent essentiellement au charbon et au gaz. Ce qui résiste mal à l’observation.
Étude de cas sur le site Energy Charts : focus sur octobre 2025 Sur l’illustration ci-dessous nous voyons la puissance cumulée des EnRi, avec l’éolien terrestre en gris, l’éolien en mer plus sombre et le solaire en jaune
Et sa variation, entre 1021 MW le
8/10 à 5 h 45 et 27600 MW le
23/10 à 13 h 30.
Par delà les pics journaliers du solaire, on distingue plusieurs périodes de forte production éolienne, dont la première, du samedi 4 et dimanche 5 octobre, correspond à une période de faible consommation.
Modulation nucléaire
Dans le graphique suivant, la ligne noire représente la consommation nationale, et tous les moyens de production ont été ajoutés aux EnRi, dont le nucléaire, en rouge.
C’est ainsi qu’on peut visualiser la profondeur de la modulation à la baisse du nucléaire à chaque pic de production renouvelable, tout spécialement les 2 weekends où la générosité éolienne correspondait à une période de faible consommation.
Le remplacement du nucléaire — 3,7gCO2/kWh, par de l’éolien — 14,1gCO2/kWh, ou pire, du solaire — 43,9gCO2/kWh*, entrainant de facto une augmentation des émissions qui n’est pas comptabilisée par RTE qui retient 0gCO2/kWh pour chacun d’eux.
La décarbonation hors frontières
Mais on peut également déduire que toute la production qui excède la consommation — ligne noire, doit être remontée sur le réseau RTE pour être exportée.
Les facteurs de pollution
L’illustration suivante montre les régimes partiels et à coups de production pratiqués par les centrales à gaz — en bas, en ocre, à chaque pic solaire. La puissance concernée par cette modulation étant bien inférieure à celle du nucléaire.
Le graphique ci-dessous illustre enfin le comportement spécifique du parc à gaz. Les données 2025 n’étant pas encore disponibles, le même mois de 2024 en illustre le fonctionnement. Chaque centrale a une couleur différente, la ligne noire indique la capacité active, c'est-à-dire comprenant les centrales en préchauffe, avec une production de 0,000MW, mais prêtes à démarrer dès que le vent tombe.

C’est ainsi que
le cadre de gauche montre que sur 14 centrales actives, 10 centrales sont en préchauffe pour 4 centrale en production, l’incertitude liée au concours passager des EnRi réclamant ainsi 917 MW actifs pour 259 MW produits. Les émissions de CO2 de ces centrales en préchauffe ne sont comptabilisées nulle part, pas plus que l’augmentation des facteurs de pollution liée aux régimes partiels des centrales en production. On sait pourtant que ce type de fonctionnement a un effet désastreux sur l’impact environnemental, comme l’a montré la
demande de dérogation du Duke Energy pour permettre à ses centrales à gaz de suivre les cycles de production solaire.
C’est d’ailleurs la raison de la
question de la sénatrice Loisier, à laquelle
le gouvernement à confirmé que le calcul des émissions étaient théorique sans que quiconque ait tenté de le vérifier à partir d’une étude d’impact de terrain tenant compte de ces facteurs.
À la
seconde question de la Sénatrice qui précisait le cas de Duke Energy,
le ministère n’a pas apporté de réponse. Et ne semble pas avoir programmé la moindre étude de terrain en ce sens.