Aimé Césaire, 1913-2008
Les ouvriers sacrifiés de l’industrie du verre
Léonard Perrin

Givors se situe dans la « vallée de la chimie », qui s’étend sur une dizaine de kilomètres au sud de Lyon. Depuis que la verrerie — créée par un arrêté royal en 1749 — a fermé ses portes en 2003, seize maladies professionnelles ont été reconnues grâce au combat de l’association des anciens verriers de Givors. « Les verreries, c’est Germinal des temps modernes », nous dit-on. Au printemps 2022, la société O‑I Manufacturing a ainsi été condamnée pour la septième fois par le tribunal judiciaire de Lyon suite au décès d’un ancien travailleur exposé au benzène, l’un des nombreux composés cancérigènes auxquels ont été soumis les salariés durant des années. Plusieurs procédures judiciaires sont en cours, que ce soit pour la reconnaissance de maladies professionnelles ou pour « faute inexcusable » de l’employeur. Le combat des anciens verriers est donc loin d’être terminé : nous publions le reportage que nous lui avions consacré dans les pages de notre revue papier.

Crédit photo : Stéphane Burlot | Ballast
C’est en franchissant une rivière que le train approche de la gare. Le bleu du ciel tente de se faire une place parmi les nuages en mouvement. L’air est humide et la petite ville de Givors, commune de 20 000 habitants au sud-ouest de Lyon, sort tranquillement du sommeil. Une cheminée d’usine se détache des lueurs matinales, surplombant les alentours. Cette prédominance n’est qu’apparente : aucune fumée ne s’en échappe ; la cheminée ne se réveillera pas. Bâtie de briques roses, c’est là le seul vestige d’une ancienne verrerie qui a fonctionné deux siècles et demi durant. Située au bord du Gier — un affluent du Rhône —, elle occupait huit hectares et produisait du verre d’emballage. Après être passée entre plusieurs mains durant la seconde moitié du XXe siècle, c’est BSN, filiale de Danone, et son dirigeant Franck Riboud, qui en finiront avec l’usine. Un complexe montage financier organisé secrètement, une opération spéculative : le capitalisme internationalisé frappe de plein fouet Givors à la fin des années 1990. En dépit d’une forte mobilisation politique et syndicale, le dernier four s’éteint en janvier 2003.
Laurent Gonon porte un béret anthracite, une écharpe rouge, des petites lunettes et une moustache blanche. Il nous salue en souriant. Au rez-de-chaussée d’un immeuble, une plaque, fixée à la porte, indique « Association des anciens verriers de Givors ». Retraité, cet ancien imprimeur s’est à l’époque fortement mobilisé dans la lutte contre la fermeture de l’usine — jusqu’à intégrer l’intersyndicale. Quelques années plus tard, de nombreux verriers semblent touchés par diverses maladies. L’un d’entre eux, Christian Cervantes, présente même deux tumeurs. Sa femme, Mercedes, réagit alors. Elle contacte Laurent en 2009 et envoie, avec son soutien, un questionnaire à 645 anciens verriers de l’usine : sur les 208 réponses exploitables, on compte 92 cancers. Soit un taux 10 fois supérieur à celui habituellement trouvé dans le monde du travail1. Cette « épidémiologie populaire2 » sera, malgré ses limites, suivie de recherches pour mieux retracer les conditions de travail des anciens verriers. Il apparaît que tous ont été exposés à nombre de produits dangereux durant leur carrière, cela au mépris de leur santé. Voilà désormais douze ans que l’association se bat afin que leurs pathologies soient reconnues comme maladies professionnelles.
L’usine toxique
Nous entrons dans le local. Plusieurs personnes bavardent chaleureusement autour d’un café. Au fond, une seconde pièce : un bureau, avec ordinateur et dossiers. Comme tous les vendredis matin, l’association tient sa permanence. C’est la période de renouvellement des cotisations : les ex-verriers et leurs proches défilent, se saluent. Le local, obtenu auprès de BSN pour un euro symbolique lors des derniers jours de négociation du plan social, seize ans plus tôt, a permis de conserver la mutuelle d’entreprise ; il fait également office de lieu de retrouvailles. De quoi maintenir le lien, la solidarité. La discussion est à peine engagée avec Bruno Cordero, ancien technicien machine, qu’il nous lance : « T’as jamais visité une verrerie ? C’est quelque chose… » Et de témoigner du bruit, « intenable » sans bouchons d’oreilles, comme de la chaleur étouffante qui y règne.
L’homme chausse ses lunettes. Puis nous explique les étapes de confection du verre en pointant une feuille sur laquelle figurent le processus et toutes les substances utilisées. Établir ce schéma de fabrication a nécessité six mois de travail lors des permanences, précise Laurent — devenu au fil du temps coordinateur maladies professionnelles de l’association. Amiante, soude, sodium, tétrachlorure de titane, silice, chrome, hydrocarbures aromatiques polycycliques, brouillards d’huile, éclaboussures de graisses chaudes… Une liste vertigineuse, et pourtant loin d’être complète, des produits auxquels ont été exposés les verriers. « Vous vous rendez compte le cocktail qu’il y avait, dans le tube digestif ? », interroge Maurice Privas, mine ferme, cheveux gris. Il a passé vingt-huit ans au service entretien. Son poste l’amenait à intervenir dans toute l’entreprise, multipliant ainsi les expositions. Aujourd’hui à la retraite, il s’est trouvé un temps en invalidité à la suite d’un cancer. La cause ? L’amiante à laquelle il a été exposé : « On ne savait pas ce qu’on touchait. On n’était pas informés. » Il bénéficie d’un suivi médical depuis 2003, mais son cancer n’est pourtant pas reconnu comme maladie professionnelle. Il souffre également d’une surdité sévère dans les aigus : malgré les bouchons d’oreilles qu’il portait, le niveau sonore de 100 décibels de bruit l’a durablement affecté. À nos côtés, Gilles Gabert mime de grands gestes avec les bras : faute de protections, il s’enroulait la tête de papier essuie-mains lorsqu’il intervenait sur une machine projetant du titane. Maurice complète : au contact de ces projections, « un collègue saignait à chaque fois du nez ». Une verrerie vit au rythme de ses fours, lesquels tournent nuit et jour, en continu. Prenant la parole avec hésitation, Hervé Di Pilla, le plus jeune autour de la table, est entré en 1989 à l’usine de Givors. Lors de la fermeture, il a été reclassé sur un autre site et cumule à ce jour trente ans de travail ouvrier en horaires décalés : « Ça pèse, au bout d’un moment. » Et les heures passées sur la route en allers-retours quotidiens s’ajoutent à la fatigue et au stress.

L’industrie verrière se prévaut d’une bonne image : le verre est perçu comme un matériau noble, propre, qui se recycle autant que possible. Sur Internet, photos et vidéos de verreries montrent des usines modernes, mécanisées, sans ouvriers. La réalité est tout autre. Ancien ajusteur, le président de l’association Jean-Claude Moioli ne mâche pas ses mots : « Les verreries, c’est Germinal des temps modernes, ils ont beau dire ce qu’ils veulent les patrons… » Durant plusieurs années, Gilles a été le secrétaire du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, à la verrerie de Veauche3, où il avait été reclassé. Des études de fumées réalisées sur ce site serviront à l’association pour prouver les expositions subies à Givors. Des mesures de taux de graisse dans l’air ont révélé des niveaux supérieurs aux seuils fixés par l’Institut national de recherche et de sécurité : INRS. À Givors, l’amiante était partout, mais seuls certains salariés ont pu, par la suite, obtenir une attestation d’exposition délivrée au bon vouloir de l’entreprise, laquelle considérait que seuls quelques postes pouvaient être à risque. Ces attestations s’arrêtent toutes au 31 décembre 1996, comme si l’interdiction de commercialisation de l’amiante, en 1997, l’avait subitement fait disparaître de l’usine… De sa voix grave et forte, Gilles nous raconte sa stupéfaction lorsqu’il est tombé, en 2015, sur un cordon d’amiante qui traînait dans un placard à Veauche. Cette même année, une étude4 atteste que le site en était encore rempli, bureaux compris.
Trop bavard au goût de certains, Gilles se fait chambrer. Des rires éclatent dans la pièce. L’atmosphère est fraternelle, à l’image de la verrerie de Givors. Alain Besson a le visage fin, le regard bienveillant ; un silence attentif s’installe quand il s’adresse à nous. Cadre ayant débuté comme électromécanicien, il se remémore la solidarité qui primait à l’usine. Les rudes conditions de travail soudaient les travailleurs et imposaient un certain respect entre organisations syndicales. La CGT, majoritaire aux deux tiers, côtoyait la CFDT à laquelle appartenait Alain. À l’annonce de la fermeture de l’usine, les deux syndicats ont compris qu’il leur fallait faire front commun ; l’intersyndicale parlera d’une seule voix tout au long du mouvement social. Alain y a pris part, activement mais non sans rencontrer d’embûches : « C’est pas facile de rentrer dans le combat quand on est cadre, les pressions sont quand même assez importantes. » Mais il refuse de plier face aux menaces de la direction. « Un cadre, ça ferme sa gueule, on me l’a dit cinquante fois. » Celui qui n’a rien perdu de ses convictions syndicales poursuit, non sans émotion : « Les Givordins étaient toujours là quand il le fallait. Et je dis bien, jour et nuit. » Sans cette union et cette cohésion, les salariés n’auraient sans doute obtenu ni reclassements ni préretraites — personne ne sera laissé sur le carreau à la fermeture.
Pour Simone Devaux, la verrerie « était vraiment une famille ». Allure affirmée, yeux clairs, son visage s’assombrit et son sourire s’efface en évoquant la fermeture, combien douloureuse pour elle. Dans cet univers hautement masculin, elle se rappelle que le mépris venait pour l’essentiel des employées des bureaux : « Quand on faisait grève et qu’elles nous voyaient passer, elles se marraient. Elles se moquaient de nous. » Simone a travaillé quarante-trois ans, à des postes variés : une carrière tout entière soumise à la poly-exposition aux produits. Le cancer du sein qu’elle a contracté pourrait bien y être lié. L’actuelle retraitée conserve toutefois un bon souvenir de l’usine, des grèves auxquelles elle a pris part et pour lesquelles elle ne manquait pas de motiver ses collègues.
Se dessine, entre ces propos, la relation ambivalente que les, anciens, verriers ont vis-à-vis de l’usine. Celle-ci leur a longtemps garanti des moyens de subsistance matériels et représentait indéniablement un lieu de camaraderie. Mais elle a aussi usé les corps et détruit la santé de ceux qui y travaillaient. Pour Pascal Marichalar, sociologue et auteur du livre-enquête Qui a tué les verriers de Givors ?, bien comprendre cette histoire nécessite d’aller au-delà d’une simple nostalgie de l’usine, ou, à l’inverse, d’une focalisation exclusive sur l’exploitation et les mauvaises conditions de travail. Mais au contact de ces personnes qui voient leurs anciens collègues et leurs amis mourir à cause de maladies, une question soulevée par l’ouvrage demeure : comment la société peut-elle « s’accommoder de ce qui est normalement considéré comme un crime ? ».

Des maladies qui n’ont rien d’accidentel
La permanence se termine, nous sortons du local et parcourons Givors aux côtés de Laurent. Il désigne la maison du Rhône, postée aux abords du fleuve. C’est dans ce bâtiment que s’est déroulé mi-novembre 2019 un colloque organisé par l’association des anciens verriers. Le thème : « Du travail au lieu de vie. Quelles mobilisations contre les risques professionnels et les atteintes à l’environnement ? » Malgré les difficultés connues pour faire dialoguer monde universitaire et milieu ouvrier, ce pari a été réussi. Pascal Marichalar nous fera part de son enthousiasme : le colloque était « à égalité entre universitaires et ouvriers : c’est rare de vivre des choses comme ça ! ». Tous, selon lui, ont fait preuve d’une fine expertise au sein d’ateliers thématiques. Et de l’expertise, l’association en a besoin. Il faut en effet se battre sur tous les fronts : médical, administratif, juridique. Après la fermeture du site de Givors, BSN a cédé l’activité verrière à O‑I Manufacturing, un groupe américain qui récupère alors l’actif comme le passif de l’entreprise. C’est donc aujourd’hui le responsable légal de la situation des anciens verriers, qu’elle affronte régulièrement dans les actions en justice toujours en cours. Prud’hommes, cour d’appel, cour de cassation : l’association est habituée à fréquenter les tribunaux où O‑I Manufacturing, par le biais de son avocate, ne manque pas de provoquer les anciens verriers et nie en bloc qu’il y ait eu la moindre exposition à des substances toxiques. Pourtant, selon le journal Les Échos5, le groupe a fait passer en 2004 les provisions pour risque amiante de 460 à 990 millions de dollars — preuve que les dirigeants étaient conscients du danger.
Le terrain médical relève lui aussi du parcours du combattant. Mercedes en sait quelque chose. Visage rond et sourire amical, sa légère appréhension initiale est rapidement dissipée. Son propos est clair, sans détour. En 2005, on découvre que son mari a contracté un cancer de la gorge ; une seconde tumeur apparaît plus tard. Le couple Cervantes se lance alors dans les démarches pour que chaque cancer soit reconnu comme maladie professionnelle, avec l’indispensable appui de l’association. « Tout seul, on est perdus », parce qu’en face, « c’est une machine de guerre ». Il faut en premier lieu qu’un médecin généraliste fasse un certificat médical suggérant la possibilité d’un lien entre le travail et la pathologie constatée. Mais les cloisons symboliques entre classes sociales en empêchent souvent la réalisation. De nombreux médecins refusent ainsi d’établir ce certificat, par méconnaissance de la condition ouvrière, par manque de formation sur les maladies professionnelles, par simple désintérêt, peut-être. Laurent va plus loin : « Quand vous allez voir un médecin, jamais il ne vous demande ce que vous faites comme travail, si vous n’êtes pas exposé à un produit. » Trouver un médecin qui prenne en compte le discours du malade est donc primordial. Il faut ensuite monter un dossier conséquent auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie : CPAM6. Formulaires difficiles à remplir, délais très courts, CPAM faisant traîner l’affaire : tout semble être organisé pour décourager celles et ceux qui demandent justice. Des documents originaux transmis ont même été « mystérieusement » perdus.
Le constat de Mercedes est sans appel : « Certains finissent par se lasser. Il y en a d’autres entretemps qui meurent, donc ils sont contents : un dossier de moins. » Dans ces démarches individuelles, l’association apporte un soutien technique et un poids symbolique face aux institutions. « Ils tiennent compte qu’il n’y a plus un individu, il y a un collectif », rebondit Laurent. En février 2012, Christian Cervantes décède ; de son vivant, il n’aura eu aucune reconnaissance de l’origine professionnelle de ses cancers. S’il a bien été exposé à l’amiante et aux hydrocarbures, nulle poly-exposition ne figure dans les tableaux officiels de l’ INRS, ce qui ajoute des difficultés supplémentaires. Ce n’est que plusieurs années après, grâce à une lutte acharnée, des actions en justice et une aide de scientifiques appuyant les dossiers, que Mercedes obtiendra gain de cause. Une victoire qui ne doit pas occulter la violence de pareille situation. « Nos vies, ils nous les ont bousillées », lâche-t-elle. Qui sont donc à ses yeux les responsables ? De toute évidence, la direction de l’entreprise, « qui n’a pas pris les précautions nécessaires ». Et puis la CPAM, « complice de ces gens-là ». « J’aimerais que les fautifs voient toute la souffrance endurée », nous dit-elle les yeux embués, en rappelant que les verriers « ont été sacrifiés sur l’autel des bénéfices ». Elle se lève, sort son téléphone portable de sa poche et nous montre une séquence vidéo. Dans un court reportage diffusé en 2009 par Télé Lyon Métropole, on voit son mari entouré d’appareils médicaux : « Mon petit-fils m’a toujours vu malade », lance Christian Cervantes à la caméra. Malgré ses lourds traitements et sa situation, « il continuait à se battre pour les autres », se souvient la veuve.
Car des autres malades à cause de l’usine, il y en a en nombre. On ne peut qu’être saisi d’effroi face à la recension des cancers : poumons, prostate, ORL, intestins, cerveau, vessie, rein, os, peau, glandes, etc. À se demander quelle partie du corps n’a pas été touchée. Marcel Dumaine, une autre des victimes de Givors, a travaillé durant trente-cinq ans, essentiellement à la partie fusion de la verrerie. Il subissait de nombreuses pressions, car la moindre panne du four stoppait toute la production. Cheveux châtains, voix assurée, sa fille Christine Denuzière se rappelle à quel point l’usine rythmait la vie de la famille. Les horaires d’équipe en 3 x 8, le travail certains week-ends : les verriers étaient mobilisés à toute heure du jour et de la nuit, quelle que soit la période de l’année. Elle dit revoir encore les brûlures rouges qui marquaient le front de son père quand il rentrait. Et le plus grave, peut-être : « Pour se protéger de la chaleur, il avait des combinaisons en amiante… » C’était le cas pour tous ceux qui travaillaient à la fusion, et les femmes lavaient à la maison les bleus amiantés de leur mari. Le danger dépassait largement les portes de l’usine…
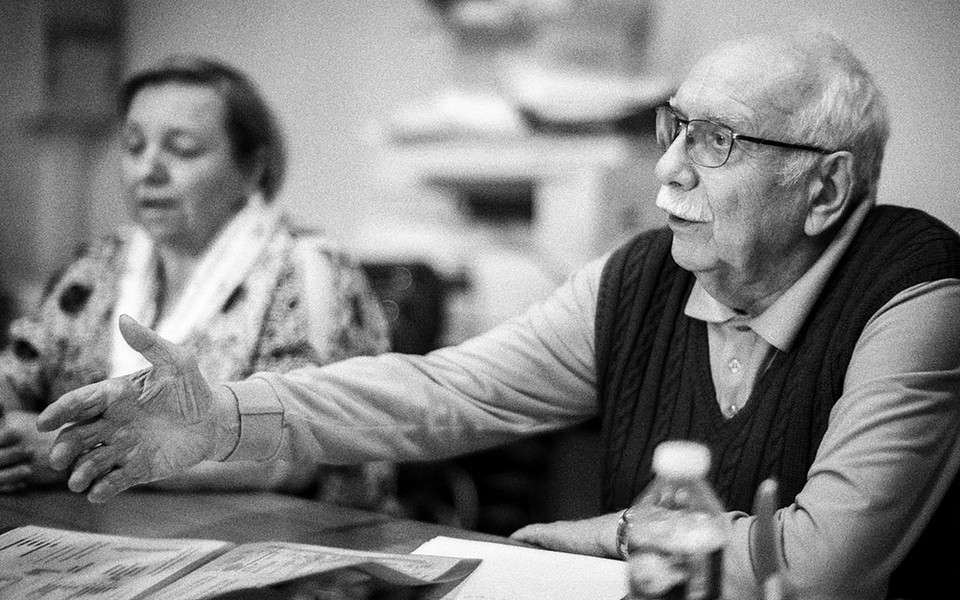
Laurent Gonon et Mercedes Cervantes, novembre 2019, par Stéphane Burlot | Ballast
En 2014, Marcel, alors retraité, tombe malade. Des examens révèlent qu’il est atteint d’une leucémie aiguë lymphoblastique : un cancer du sang. Rapidement affaibli, il suit à Lyon une chimiothérapie très lourde : trois mois durant l’année 2015, il restera enfermé dans une chambre stérile. Christine peut le voir deux fois par jour tout au plus, consignée sur une chaise dans un coin de la pièce. Pendant cette période, il lui dit avoir l’impression d’être « en prison ». Marcel décédera brutalement en septembre 2016. « Ça a été violent », souffle sa fille. Elle se rapproche alors de l’association et constitue rapidement un dossier. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques — dont le benzène, cancérigène lorsqu’il est chauffé —, sont alors identifiés comme étant responsables de la pathologie, figurant bien cette fois dans le tableau de l’ INRS. Cette correspondance exacte avec une liste officielle rendra les choses moins compliquées : quelques mois plus tard, la maladie de Marcel est reconnue comme étant d’origine professionnelle. Sa fille aura sans doute bénéficié des années d’expérience de l’association, qui a pu la guider dans les procédures et la soutenir dans cette épreuve. Mercedes et Christine le prouvent : si la grande majorité des verriers étaient des hommes, les femmes sont aussi au premier plan de cette lutte. Leurs récits nous obligent à regarder ces histoires dans ce qu’elles ont de tragique, mais sans misérabilisme. Car la combativité et la détermination se ressentent aussi dans chacun des mots qu’elles nous transmettent.
Quel travail ?
Sur la porte du local, une photo ; on y voit l’avocat de l’association et plusieurs anciens verriers. L’un d’entre eux, chemise à carreaux, est décédé en 2018 d’un cancer, nous dit-on. Toutes les personnes présentes dans la pièce peuvent en témoigner : son physique avant qu’il soit malade était bien différent de celui que la photo donne à voir, prise peu de temps avant son décès. Mercedes a pu s’en rendre compte avec son mari : « Il faisait 85 kilos » et, à la fin de sa vie, « même pas 40 ». « Ça ronge, les maladies, ça ronge… », ajoute Christine. La verrerie et ses produits toxiques ont maltraité les corps, affecté les gens dans leur chair et dans la durée. Pour autant, les victimes ou leurs proches n’engagent pas systématiquement de procédure de reconnaissance. La tradition d’un capitalisme paternaliste, qui a longtemps marqué l’usine de Givors, n’y est probablement pas pour rien. Les rapports de classes étaient alors dissimulés sous couvert d’une fausse proximité entre patron et ouvriers. Certains « se sentent coupables d’attaquer », analyse aujourd’hui Christine qui, bien que déterminée, a elle aussi réfléchi maintes fois avant de s’engager. Faire cette démarche, c’est aussi d’une certaine manière accepter d’être victime, ce qui n’est pas anodin lorsqu’on a passé des décennies à travailler à la verrerie avec fierté, comme c’était, selon leurs propres mots, le cas d’un très grand nombre. Et bien souvent le moindre problème se négociait avec une prime supplémentaire : « Toute leur vie, on leur a acheté leur santé », résume Laurent.
La filière industrielle du verre d’emballage compte 14 000 salariés en France. Sur cet ensemble, 28 maladies professionnelles sont reconnues à ce jour, et la moitié d’entre elles concerne des ex-verriers de Givors : en novembre 2022, 16 maladies professionnelles sont à présent reconnues pour les anciens verriers, ndlr. Une telle proportion s’explique par la solidité des dossiers portés par l’association et la force du collectif. Grâce à leur lutte, O‑I Manufacturing a été condamnée six fois pour faute inexcusable, sept, en 2022, ndlr, et deux procédures sont encore en cours d’instruction. L’un des plus gros fabricants mondiaux de verre d’emballage serait-il en train de vaciller ? Cette bataille a peu à peu bénéficié d’un écho médiatique, et les différents revers subis par l’entreprise ne sont pas sans effets pour elle. Le sociologue Pascal Marichalar pointe toutefois les angles morts de cette doctrine de « réparation », et la façon dont elle nie les victimes en tant que telles. Tant qu’il n’aura pas obtenu la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie, le malade n’est pas perçu comme une victime. Si reconnaissance il y a, la personne, ou sa famille, perçoit de l’argent en compensation : l’opération est censée réparer le préjudice et clore l’histoire, « donc [elle] n’est plus vraiment une victime non plus », nous dira le sociologue. « C’est un système de gestion. » Difficile, dès lors, d’éprouver un véritable sentiment de justice, même en cas de victoire pour les malades ou leurs proches.
Le choix des mots n’est pas neutre et c’est pourquoi Pascal Marichalar interroge le terme de « risque », souvent employé à propos des expositions : il a un côté « euphémisant ». Dès que des travailleurs sont exposés à un produit dangereux, il y a une « certitude statistique » et la question n’est pas de savoir si, ni même combien il y aura de malades, mais bien qui sera touché. Est-il cependant possible de produire du verre « proprement » ? « On n’a jamais essayé. Jamais, dans l’Histoire, la priorité n’a été de produire du verre sans mettre en danger la vie des travailleurs », nous répondra le sociologue. Car il en est persuadé : « Il y a tellement de marges de manœuvre qu’on n’a pas explorées… » Pour lui, le problème se trouve dans la conception originelle d’un « risque » inhérent à l’industrie moderne, soi-disant inévitable. « Un des axiomes de base qui fait fonctionner le système actuel est de considérer que l’exposition à un danger est légitime. » Il ne s’agit alors que de gestion administrative et d’indemnisation des malades, pas de remettre en cause la légitimité d’une telle organisation sociale du travail. Si les fours d’une verrerie fonctionnent en continu, c’est parce qu’il est extrêmement compliqué de les stopper temporairement — si ce n’est impossible, car une mise à l’arrêt peut les casser. Pour autant, y faire travailler des ouvriers au même rythme et de manière ininterrompue est un choix politique, celui d’augmenter la rentabilité capitaliste d’un outil de production. Le travail posté, avec des changements d’horaires en permanence, tout comme le travail de nuit favorisent la survenue de maladies et sont même classés probablement cancérigènes par le Centre international de la recherche sur le cancer : CIRC. Environ 15 % des salariés français sont soumis au travail de nuit, en augmentation globale depuis vingt ans. D’ailleurs, seuls 37 % de l’ensemble des salariés ont des horaires standards7 ; les deux tiers sont donc assujettis à des horaires atypiques. Combien de ces situations ne relèvent d’aucune nécessité stricte pour la société ? Pascal Marichalar le formulera, non sans ironie, en parlant de la production verrière : « Pourquoi est-on obligé de produire des bouteilles de rosé à 3 heures du matin ? » Une telle question en amène immédiatement d’autres : qui produit ? dans quelles conditions ? pour quoi faire ? Autant d’interrogations fondamentales sur l’organisation économique et sociale, mais largement absentes du débat politique français. L’association est bien consciente que les conditions de travail et les maladies professionnelles restent des sujets encore trop peu visibles ; et Laurent d’ajouter : « Il faut faire éclater ce scandale. En tout cas, il faut mettre, les industriels, sur la défensive : quand on les met sur la défensive, on avance. »

Mercedes Cervantes, novembre 2019, par Stéphane Burlot | Ballast
Bien qu’elles paraissent d’une autre époque, les conditions de travail dans les verreries ont peu évolué au cours des dernières décennies. Les produits utilisés aujourd’hui sont peu ou prou identiques, bien souvent employés dans des circonstances similaires… Une certitude : les mêmes causes produiront ailleurs les mêmes effets. Pascal Marichalar expose dans son livre la double menace qui pèse sur les salariés : « Tiraillée entre la défense de l’emploi et la préservation de la santé, la condition salariale a souvent, aujourd’hui, la structure d’un piège. » Un piège qu’il serait donc grand temps de défaire.
Nous quittons le local et marchons le long du Gier avec Christine et Laurent. À proximité de l’ancien site industriel, Laurent pointe du doigt un gros tuyau d’évacuation qui se jette dans la rivière. Les jours de pluie, l’eau qui en sort est noircie. L’ensemble du sol est extrêmement pollué8 ; la verrerie laisse aussi ses marques sur l’environnement. Les rayons du soleil percent les nuages et illuminent l’ancienne cheminée vers laquelle nous nous dirigeons. Elle n’a pas été détruite, afin de conserver un vestige industriel dans la ville — du moins est-ce l’explication officielle. L’autre raison est qu’elle est entièrement contaminée : le démantèlement et le traitement des déchets représenteraient un coût considérable. Aux abords de la cheminée, deux plaques commémoratives ont été mises en évidence. La plus récente, qui date d’octobre 2019, est une photo de l’ancienne verrerie, perchée sur un pied en métal qui titre « À la mémoire des verriers de Givors 1749–2003 ». Sa pose a rassemblé plus d’une centaine de personnes, signe de « cette solidarité qui demeure seize ans après la fermeture », comme le souligne Laurent. L’autre plaque, installée à l’initiative de l’association en 2014, est fixée sur la cheminée. Le message blanc sur fond bleu est sobre, sans équivoque : « Hommage aux verriers – Victimes de maladies professionnelles non reconnues ». Quelques mots qui rappellent à tout un chacun que le travail peut rendre malade, et même tuer. Le combat des anciens verriers de Givors est loin d’être terminé : il est celui de tous les travailleurs.
- En comparaison avec l’enquête ESTEV « Travail, Vieillissement, Santé », menée auprès de 20 000 salariés par les médecins du travail.
- Pascal Marichalar, Qui a tué les verriers de Givors ? Voir aussi Malo Herry, « Montrer l’invisible : pollutions et victimes », Ballast, n° 6, 2017.
- Située à 55 kilomètres de Givors.
- Réalisée par le Bureau Veritas.
- Communiqué boursier d’avril 2014.
- Si le cas ne figure pas précisément dans la liste des maladies professionnelles, il est étudié par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : CRRMP.
- L’ INRS définit ainsi le travail standard : « 5 jours réguliers par semaine du lundi au vendredi, horaires compris entre 5 et 23 heures, avec 2 jours de repos hebdomadaires. »
- Comme l’a analysé le Cabinet Blondel en 2002 et 2004.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire