Jean Baudrillard, 1929-2007 ; La Société de consommation - Denoël - 1970, page 122
..." La naïveté grotesque des enfants fait peine à voir, surtout si l’on veut bien la comparer à la maturité sereine qui caractérise les adultes. Par exemple, l’enfant croit au Père Noël. L’adulte non. L’adulte ne croit pas au Père Noël. Il vote."
Pierre Desproges; Manuel de savoir vivre à l'usage des rustres et des malpolis / Éditions du Seuil
php
***

Ballast
Édouard Jourdain
Spécialiste de l'histoire de l'anarchisme et de Proudhon, il est l’auteur de « L’anarchisme » (2013) et « Proudhon contemporain » (2018).
25/06/2020
La notion de souveraineté revient régulièrement sur le devant de la scène politique, comme concept brandi afin de restituer au peuple sa faculté de décider de manière pleine et entière — notamment dans le cadre d’une mondialisation qui lui aurait soustrait ses prérogatives. À droite comme à gauche, la souveraineté est ainsi invoquée sur le ton de la réactualisation : voilà qui, enfin, permettrait de redonner le pouvoir aux citoyens. Le politologue Édouard Jourdain, spécialiste de l’histoire de l’anarchisme, objecte ici : est-ce si sûr ? S’appuyant sur les réflexions de Castoriadis et de Proudhon, il oppose à la souveraineté un autre idéal d’émancipation populaire : l’autonomie.
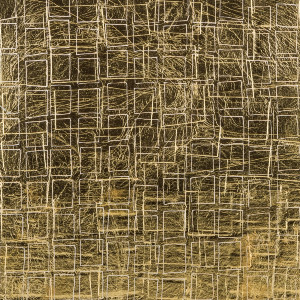
La souveraineté est avant tout un concept théologique. C’est d’abord Dieu qui est souverain, avec les prérogatives que cela implique : il est infaillible et omnipotent. Une puissance absolue, en somme. Mais ces attributs sont progressivement transférés au Pape, puis au Prince, et enfin au Peuple — ou, plus précisément, à l’État. La transition majeure s’opère à la Renaissance, avec notamment l’élaboration juridique, philosophique et politique de la raison d’État, dont on retrouve les origines dans une conception théologique du pouvoir souverain au Moyen Âge. Comme le note le philosophe Michel Senellart, « la pensée moderne, au-delà des ruptures proclamées, plonge ses racines dans la théologie médiévale dont l’oubli, aujourd’hui, constitue le véritable impensé de notre culture1. » Au Moyen Âge, l’État royal se fonde sur la loi, laquelle est l’expression de la justice et préexiste au pouvoir : il peut s’agir de la loi divine ou de la loi coutumière, que le roi doit préserver, legem servare, hoc est regnare — régner, c’est observer la loi. Celui qui ne règne pas selon la loi n’est plus un roi : c’est un tyran — aujourd’hui, au contraire, la loi est l’œuvre du souverain, le fruit de sa volonté. Jean de Salisbury, dans Policraticus, un ouvrage politique fondamental du XIIe siècle, développe même l’argumentation suivante : le prince reçoit des mains de l’Église le glaive afin de faire respecter la loi de Dieu. Le roi est donc subordonné au pouvoir spirituel qui a en charge les âmes, mais il est la tête qui, commandant au corps politique, incarne l’intérêt commun. En cela, l’intérêt d’un corps politique, res publica, représenté par le prince rejoint la loi, le bien commun, c’est-à-dire que la ratio publicae utilitatis ne fait plus qu’une avec la ratio status rei publicae.
Au carrefour de l’argument patristique2 et de l’argument juridique d’origine romaine, le prince comme personne incarnant la chose publique3, Jean de Salisbury énonce le paradoxe suivant : « [L]e prince, bien qu’il soit affranchi des liens de la loi, est cependant l’esclave de la loi et de l’équité, il assume la personne publique et verse innocemment le sang4. » Ce paradoxe se résout dans la mesure où le prince devient l’image vivante de la loi et de la justice. Ici se forme la véritable dimension théologico-politique du pouvoir : le prince n’est pas juste parce qu’il obéit à la loi divine, concept augustinien du rex justus, mais bien parce qu’il l’incarne. En cela, il n’est plus soumis à la loi comme peuvent l’être ses sujets qui ont peur du châtiment, car la loi rayonne à travers lui. L’absolutisme est donc un pouvoir sans limite juridique, il ne peut être jugé, mais pas sans limite morale, dans la mesure où le prince est transcendé par le divin, qui est essentiellement juste.
Cette limite morale finit par disparaître avec Machiavel et les contractualistes modernes : la morale ne doit plus être en adéquation avec des préceptes religieux mais se soumettre aux impératifs de la survie de l’État, garantie par le pouvoir souverain. Cette évolution n’implique toutefois pas une coupure nette dans la modernité. Les premiers théoriciens de la souveraineté, à l’instar de Hobbes et Bodin, demeurent tributaires d’un référent théologique pour eux nécessaire. Dès l’introduction du Léviathan, Hobbes affirme que « la nature, qui est l’art pratiqué par Dieu pour fabriquer le monde et le gouverner, est imitée par l’art de l’homme, qui peut, ici comme en beaucoup d’autres domaines, fabriquer un animal artificiel5 ». De même, pour Jean Bodin, si « le Prince est image de Dieu, il faut par même suite de raison que la loi du Prince soit faite au modèle de la loi de Dieu6 ». Peu à peu, la souveraineté pouvait se glisser dans différents corps tout en gardant les mêmes attributs : ce fut d’abord le corps du prince, puis le corps du peuple. Ce transfert est explicité par l’historien Kantorowicz à travers la formule suivante : « Quand la Nation chaussa enfin les mules pontificales du prince, l’État Absolu moderne, même sans prince, fut alors en mesure de revendiquer, comme une Église pouvait le faire7. »
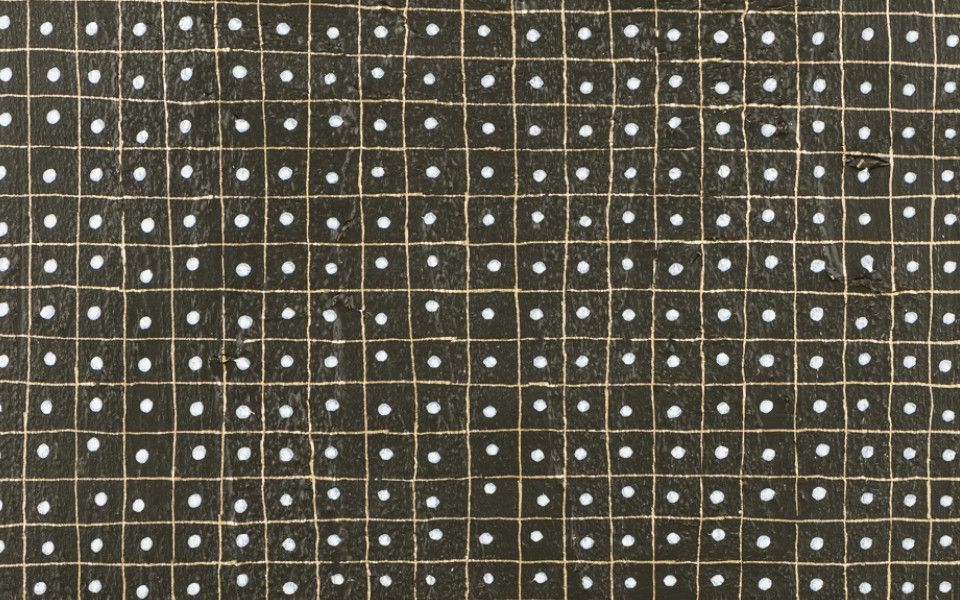
[Giorgia Siriaco | www.gioeucalyptus.com]
Anatomie de la souveraineté
La souveraineté demeure donc toujours la figure de l’Un, c’est-à-dire la négation de la pluralité. Elle ne peut concevoir en son sein un élément qui contesterait son autorité. L’homogénéité lui est consubstantielle et ne saurait être remise en cause. C’est dans la théorie politique de Rousseau que nous retrouvons de la manière la plus aboutie cette idée de l’Un démocratique et souverain : la volonté de l’individu est identique à la volonté générale, qui est celle de la souveraineté — or la volonté générale « n’erre pas ». Elle ne saurait se tromper car elle est l’expression de la souveraineté. C’est donc l’individu ou la minorité qui a tort.
Entre l’individu et la volonté générale, il doit exister un lien direct, de façon à ce que l’expression de la souveraineté soit pure de toute interférence qui chercherait à défendre ses intérêts particuliers. C’est ainsi qu’au nom de la souveraineté, la loi Le Chapelier est promulguée en France le 14 juin 1791 : elle interdit les groupements professionnels, en particulier les corporations de métiers, mais aussi les organisations ouvrières, les rassemblements paysans et ouvriers, ainsi que le compagnonnage. La souveraineté du peuple tend alors à se confondre avec la souveraineté de l’État, dans la mesure où le peuple est pluriel et contradictoire. L’habit de l’Un est à la fois trop grand et trop petit pour lui. Seul l’État, formidable réducteur, violent, de complexité, est à même de le lui faire endosser par la force. Ainsi, dans la théorie politique de Rousseau, le rejet du pluralisme, des droits individuels et des contre-pouvoirs allait jeter le peuple à la merci de la première faction venue proclamant : « Je suis la Volonté générale. »
Nul mieux que Proudhon n’a su pointer cette mystification : « Nous avons été vaincus, parce que, à la suite de Rousseau et des plus détestables rhéteurs de 93, nous n’avons pas voulu reconnaître que la monarchie était le produit, direct et presque infaillible, de la spontanéité populaire ; parce que, après avoir aboli le gouvernement par la grâce de Dieu, nous avons prétendu, à l’aide d’une autre fiction, constituer le gouvernement par la grâce du peuple […]. À peine délivrés d’une idole, nous n’aspirons qu’à nous en fabriquer une autre8. » Le souverain est celui qui n’a de compte à rendre qu’à lui-même : en cela, il est celui qui se pose comme « ipse, le même, soi-même9 ». De la souveraineté du monarque à la dictature du prolétariat, en passant par la souveraineté du peuple en démocratie, le souverain dicte son ordre sans qu’il puisse être contesté. Comme l’écrit Derrida, « l’ipséité nomme un principe de souveraineté légitime, la suprématie accréditée ou reconnue d’un pouvoir ou d’une force, d’un kratos, d’une cratie10. » Le peuple Un, le peuple Dieu, voici une figure qui n’est pas sans poser le problème d’une incompatibilité avec l’hétérogène, l’hétéronome, et tout ce qui ne relève pas de la logique circulaire propre à la souveraineté. Or l’Un ne va pas sans l’exception, sans la possibilité de se soustraire à la loi qu’il proscrit. La souveraineté, le pouvoir de l’Un est sans limite ; il est absolu par nature, au-dessus des lois. Le philosophe Étienne Balibar affirme dès lors : « La souveraineté, qui se définit elle-même comme excès intérieur sur le pouvoir légal, apparaît indissociable de la cruauté, parce qu’elle doit toujours parer à son propre défaut, que ce soit du côté de la loi elle-même, ou du côté du peuple11. » D’où le danger de la dimension subjective de la violence souveraine, toujours en prise avec l’ennemi absolu, avec « la représentation fantasmatique de l’Autre comme menace de mort opérant de l’intérieur de la communauté : comme si un Étranger inassimilable avait pénétré le Soi, ou le Même, qu’il faut en arracher violemment pour le purifier de ce qui le souille, au risque de sa propre destruction, car la mort est préférable à l’adultération12 ».

[Giorgia Siriaco | www.gioeucalyptus.com]
En plus du danger proprement raciste ou xénophobe, que l’on peut retrouver dans les formes de nationalisme et d’impérialisme, et qui se traduit par le rejet de l’Autre du corps politique imaginé comme hermétique ou/et homogène, Balibar concède qu’il est indispensable de penser la violence des révolutions socialistes, « en particulier lorsqu’elles furent légitimées et institutionnalisées à leur tour dans le cadre d’États révolutionnaires, et qu’elles s’étendirent à la liquidation de leurs ennemis intérieurs — processus véritablement suicidaire, suivi d’une longue chaîne d’effets traumatiques, le plus souvent déniés comme tels13 ». La souveraineté est donc toujours confrontée à un ennemi contre lequel, tôt ou tard, elle devra faire la guerre : guerre au-dedans et guerre au-dehors, guerre comme horizon perpétuel au-delà du droit. En cela, tout État est un État voyou. « Dès qu’il y a souveraineté, il y a abus de pouvoir et Rogue State [« État voyou »]. L’abus est la loi de l’usage, telle est la loi même, telle est la logique d’une souveraineté qui ne peut régner que sans partage. Plus précisément, car elle n’y arrive jamais que de façon critique, précaire, instable, la souveraineté ne peut que tendre, pour un temps limité, à régner sans partage. Elle ne peut que tendre à l’hégémonie impériale14. »
La souveraineté du peuple ou de l’État émerge néanmoins avec les droits de l’Homme, dont la dimension souveraine va notamment s’affirmer en droit international. Comme l’a remarqué à juste titre Derrida, la souveraineté est susceptible de déborder le cadre de l’unité politique étatique au nom d’un certain propre de l’Homme — « car l’humanité de l’homme ou de la personne humaine invoquée par les droits de l’homme ou le concept de crime contre l’humanité, par le droit international ou les instances pénales internationales, toutes ces instances pourraient bien être en train d’en appeler à une autre souveraineté, la souveraineté de l’homme lui-même, de l’être même de l’homme même, ipse, ipsissimus, au-dessus et au-delà de, et avant la souveraineté étatique ou état-nationale15. » Souveraineté étatique, souveraineté de l’humanité ou souveraineté personnelle : il existe plusieurs souverainetés qui, parfois, s’opposent — compliquant dès lors l’évaluation, pourtant nécessaire, de ce qui, dans telle ou telle situation, s’affirme comme une souveraineté plus légitime qu’une autre, il convient, par exemple, d’approuver le bien-fondé de l’affirmation de la souveraineté nationale envers une tutelle coloniale. Est-ce pour autant que la souveraineté des droits de l’Homme constitue une contre-souveraineté suffisante à la souveraineté de l’État ?
La matrice commune des droits de l’Homme et de l’État implique le paradoxe suivant : si les droits de l’Homme sont inaliénables, conçus comme indépendants de toute autorité politique afin de pouvoir s’en protéger, alors, sans la protection politique de ces droits, ils demeurent ineffectifs. Ce paradoxe a été clairement analysé par Hannah Arendt en ce qui concerne le problème des réfugiés. Suite à l’afflux massif de réfugiés liés, pour l’essentiel, à la guerre 14–18, les États-nations se virent incapable de fournir une loi à ceux qui avaient perdu leur protection nationale. Dès lors, ils déléguèrent le règlement du problème à la police, entraînant une véritable internationale des polices : « [L]es relations entre la Gestapo et la police française ne furent jamais plus cordiales qu’à l’époque du gouvernement de Front populaire de Léon Blum, gouvernement inspiré pourtant par une politique fermement anti-allemande16. » Paradoxalement, donc, la perte des droits de l’Homme survient « au moment où une personne devient un être humain en général […] ne représentant rien d’autre que sa propre et absolument unique individualité qui, en l’absence d’un monde commun où elle puisse s’exprimer et sur lequel elle puisse intervenir, perd toute signification17 ». Autrement dit, c’est la considération du fait social qui permet à l’Homme de réaliser effectivement l’égalité tandis que la seule supposition de droits innés de l’individu se réduit à une déclaration de principe. Comme le soutient Arendt : « Nous ne naissons pas égaux : nous devenons égaux en tant que membres d’un groupe, en vertu de notre décision de nous garantir mutuellement des droits égaux. Notre vie politique repose sur la présomption que nous sommes capables d’engendrer l’égalité en nous organisant, parce que l’homme peut agir dans un monde commun, de concert avec ses égaux et seulement avec ses égaux18. »

[Giorgia Siriaco | www.gioeucalyptus.com]
La souveraineté ne peut cependant être réellement absolue que si elle arrive à intérioriser ses limites en régulant à la fois les croyances et les processus économiques, ce qui ne peut être qu’un processus tendanciel. Aussi, pour Balibar, « il faut convenir que la souveraineté est elle-même une tâche inachevée, voire impossible. Ou, ce qui revient au même, qu’elle échoue à transformer intégralement les individus en sujets19. » Il demeure alors possible de penser dans cet interstice — où l’on peut aller retrouver des marges de manœuvre pour créer une réelle autonomie, qui ne peut s’imaginer qu’à l’encontre du principe de souveraineté.
Autonomie et fédéralisme
L’autonomie s’oppose à l’hétéronomie. Elle suppose la capacité individuelle, mais aussi collective, de s’autogouverner et de se donner à soi-même ses propres lois. Elle rejette l’idée qu’elles puissent provenir d’une autorité extérieure. Au sens démocratique, elle peut donc être entendue comme la capacité collective à maîtriser, décider et produire des normes propres. Cornelius Castoriadis est sans doute l’un des penseurs qui a le plus développé cette notion ; fort du modèle antique grec, il a appelé de ses vœux un régime où « tous les citoyens ont une égale possibilité de participer à la législation, au gouvernement, à la juridiction et finalement à l’institution de la société. […] C’est en cela qu’on peut l’appeler le projet révolutionnaire, étant entendu que révolution ne signifie pas des massacres, des rivières de sang, l’extermination des Chouans ou la prise du palais d’Hiver20 ». L’autonomie est la fin de l’oligarchie, la réappropriation par le peuple de la chose publique confisquée par une faction qui se prend pour un Tout — qu’elle nomme « souveraineté ».
Toute véritable autonomie est cependant potentiellement tragique : les citoyens peuvent être emportés par la démesure, cette fameuse hubris que redoutaient par-dessus tout les Grecs, voyant en elle un danger pour la Cité. C’est pourquoi l’autolimitation est fondamentale. Elle porte dans son principe une disposition qui va à l’encontre du principe même de l’absoluité de la souveraineté. Dans la perspective d’un gouvernement de soi qui suppose l’autolimitation, c’est sans doute l’exercice de la phronêsis, traduite en latin par prudentia, prudence, qui permet la confrontation à cette dimension tragique. Une véritable démocratie n’est donc possible que grâce à une culture et à une éducation des citoyens ou du peuple. Les procédures démocratiques, rotations, délibérations, élections, sont autant de « pièces d’un processus politique éducatif, d’une paideia active, visant à exercer, donc à développer chez tous les capacités correspondantes et par là à rendre aussi proche que possible de la réalité effective le postulat de l’égalité politique21 ».
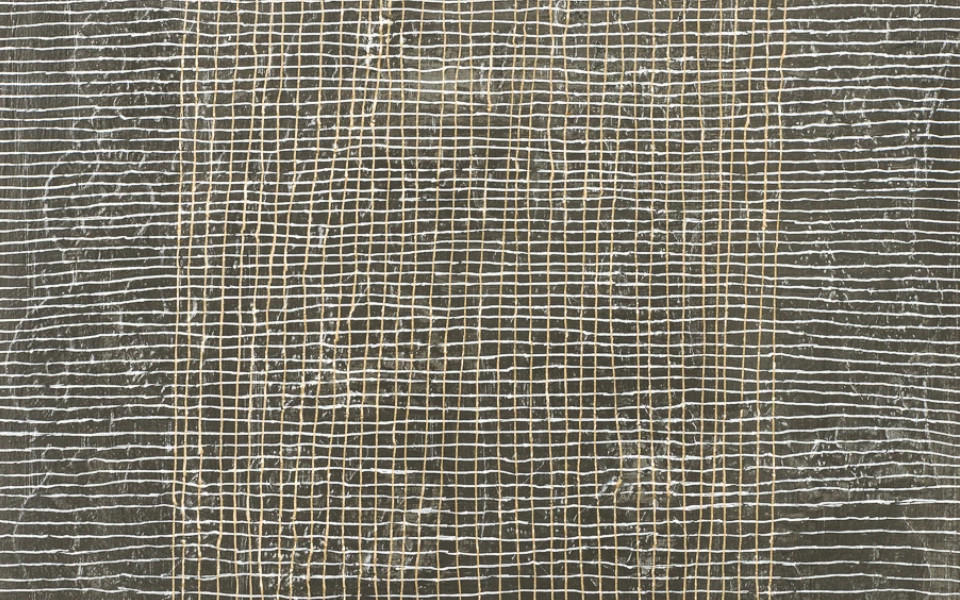
[Giorgia Siriaco | www.gioeucalyptus.com]
L’autonomie suppose la participation générale à la politique et, par conséquent, la création d’un espace public qui cesse d’être l’espace privé de la bureaucratie, des hommes politiques ou des rois… L’autolimitation développée par Castoriadis ne saurait toutefois être efficace sans des dispositifs politiques et juridiques à même de conjurer l’hubris de la souveraineté. Sans ceux-là, les Grecs eux-mêmes été emportés par l’impérialisme — comme en témoigne Thucydide dans sa Guerre du Péloponnèse. Raison pour laquelle, contre la dimension antipluraliste et autoritaire de l’État souverain, il s’agit de penser institutionnellement l’équilibre des forces, d’organiser des manières de voter alternatives au suffrage universel, lequel demeure la caution théologique du pouvoir exécutif et législatif capturés par l’État. Castoriadis a ainsi pointé ce procédé légitimant la souveraineté : « Ces élections elles-mêmes constituent une résurrection impressionnante du mystère de l’Eucharistie et de la Présence réelle. Tous les quatre ou cinq ans, un dimanche, jeudi en Grande-Bretagne, où le dimanche est consacré à d’autres mystères, la volonté collective se liquéfie ou fluidifie, est recueillie goutte à goutte dans des vases sacrés/profanes appelés urnes, et le soir, moyennant quelques opérations supplémentaires, ce fluide, condensé cent mille fois, est transvasé dans l’esprit, désormais transsubstantié, de quelques centaines d’élus22. » A contrario, dans la perspective d’un fédéralisme libertaire dont les grandes lignes ont été dessinées par Proudhon en 186123, cette dimension théologique de la souveraineté est proprement dissoute.
En votant eux-mêmes la loi pour des questions précises, en n’accordant que des mandats impératifs, le collectif peut se faire l’artisan d’un ordre autonome et réel, purgé de toute aliénation transcendante. Chaque collectivité, autonome, doit se prendre en charge et composer avec les autres collectivités de la fédération un ordre qui réponde à sa propre loi, c’est-à-dire à ses besoins et ses aspirations. Dans la fédération, l’unité s’exprime à travers le principe de subsidiarité, où la responsabilité d’une action publique, lorsqu’elle est nécessaire, revient à l’entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. Chaque groupe s’associant avec d’autres, selon ce qui les rassemble, histoire, intérêt, principes,…, formant ainsi une collectivité plus importante. Le fédéralisme libertaire se construit de bas en haut : ce sont les groupes de base, à partir de l’individu, qui délibèrent et décident de la politique à mener dans leur quartier puis dans leur commune, leur département, etc., suivant l’ensemble concerné par la décision à prendre. L’ensemble fédéré se gouvernant lui-même, seul subsiste au sommet de la fédération un organe chargé de coordonner les collectivités grâce à la mise en place d’une comptabilité économique, et une magistrature chargée d’empêcher tout retour à un centralisme gouvernemental. Mais les groupes s’équilibrant dans une fédération qui développe un maximum de liberté et de garanties réciproques, il y a peu de chances pour que ce cas puisse arriver — toute tentative d’absolutisme étant mise en échec par la solidarité des êtres collectifs unis par le pacte fédératif, fondé sur le respect et le développement de l’autonomie de chacun.
Le système fédératif met également fin à la passion comme aux pulsions, autodestructrices, des masses, puisqu’il n’y a plus ni atomisation sociale, ni centralisation politique et géographique. Les communes autonomes ne sont plus subordonnées à la capitale. Dans les termes de Proudhon : « La fédération devient ainsi le salut du peuple : car elle le sauve à la fois, en le divisant, de la tyrannie de ses propres meneurs et de sa propre folie24. » Dans le fédéralisme proudhonien, « le travailleur n’est plus un serf de l’État, englouti dans l’océan communautaire ; c’est l’homme libre ; réellement souverain, agissant sous sa propre initiative et sa responsabilité personnelle. […] Pareillement l’État, le Gouvernement n’est plus un souverain ; l’autorité ne fait point ici antithèse à la liberté : État, gouvernement, pouvoir, autorité, etc., sont des expression servant à désigner sous un autre point de vue la liberté même ; des formules générales, empruntées à l’ancienne langue, par lesquelles on désigne, en certains cas, la somme, l’union, l’identité et la solidarité des intérêts particuliers25 ». En permettant la réalisation dans tous les domaines sociaux de l’autonomie des êtres collectifs, le fédéralisme libertaire signe la fin du règne théologico-politique de la souveraineté, qui a laissé place à la Justice : « Quelle que soit la puissance de l’être collectif, elle ne constitue pas pour cela, au regard du citoyen, une souveraineté… Nous l’avons dit, la Justice seule commande et gouverne, la Justice qui crée le pouvoir, en faisant de la balance des forces une obligation pour tous. Entre le pouvoir et l’individu, il n’y a donc que le droit, toute souveraineté répugne ; c’est déni de la Justice, c’est de la religion26. » De quoi nettoyer la confusion qui, de nos jours, règne trop souvent entre « souveraineté » et « autonomie ».
Illustrations de bannière et de vignette : Giorgia Siriaco | www.gioeucalyptus.com
1. Michel Senellart, Machiavélisme et raison d’État, PUF, 1989, p. 12.
2. Étude de la doctrine, des ouvrages et des biographies des Pères de l’Église.
3. Au XIIe siècle, les glosateurs vont exciper du Digeste (I, 3, §31) la phrase d’ Ulpien : princeps legibus solutus est « Le prince est au-dessus des lois »
4. Jean de Salisbury, Policraticus, IV, 2, cité par Michel Senellart, op. cit., p. 108.
5. Thomas Hobbes, Le Léviathan, Gallimard, 2000, p. 63.
6. Jean Bodin, Les Six livres de la République, Le livre de poche, 1993, p. 113.
7. Ernst H.Kantorowicz, « Mystères de l’État », Mourir pour la patrie et autres textes, Fayard, 2004, p. 125.
8. Proudhon, De la révolution sociale démontrée par le coup d’État, Rivière, 1852, 1936, p. 169–170.
9. Jacques Derrida, La Bête et le souverain, Galilée, 2008, p. 102.
10. Jacques Derrida, Voyous, Galilée, 2003, pp. 31–32.
11. Étienne Balibar, Violence et civilité, Galilée, 2010, p. 125.
12. Ibid., p. 108.
13. Ibid., p. 158.
14. Jacques Derrida, La Bête et le souverain, Galilée, 2008, p. 146.
15. Derrida, La Bête et le souverain, tome 1, 2001–2002, Galilée, 2008, p. 107.
16. Hannah Arendt, L’Impérialisme, Seuil, p. 284.
17. Ibid., p. 292.
18. Ibid., p. 305.
19. Étienne Balibar, Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le Peuple, La Découverte, 2001, p. 276.
20. Castoriadis, entretien paru dans le n° 10 de la revue Propos, mars 1993.
21. Castoriadis, La Montée de l’insignifiance — Les carrefours du labyrinthe, 4, Points, 2007, p. 284.
22. Castoriadis, Figures du pensable, Les carrefours du labyrinthe 6, Points, 2009, p. 189.
23. Proudhon, Du principe fédératif, Tops/Trinquier, 1863–1997.
24. Proudhon, Du principe fédératif, op.cit., p. 110.
25. Proudhon, De la capacité politique des classes ouvrières, tome 1, Monde libertaire, 1977, p. 87.
26. Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, tome 2, Garnier frères, 1858, p. 271.
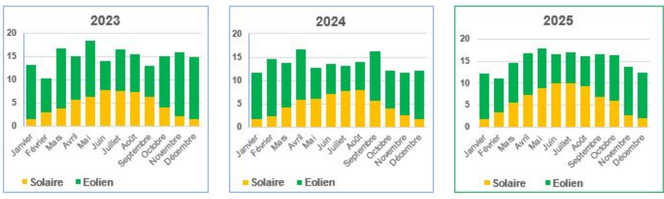
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire