Chaque mot a une définition. Il en va de même pour le "populisme". Sauf qu'aujourd'hui, le contour du mot est rendu flou par l'utilisation que chaque parti, mouvement ou homme politique en fait. Il était temps de "remettre l'église au milieu du village"; expression de vieux, que celles et ceux qui sont nés après le "(I Can't Get No) Satisfaction" des Stones, (1965), ne doivent pas connaître.😏 C'est chose faite. Les Béotiens et les Nuls, vous en remercient Jean-Yves Pranchère.
php
***
Jean-Yves Pranchère : « Le peuple n’est pas le nom d’une unité sociale »
Ballast
2021 01 14

[Tatsuya Tanaka]
Jetons un œil à la presse francophone des derniers jours. Le « discours populiste de Donald Trump », « La démocratie participative, ce populisme chic », « D’où vient le populisme, qui a conduit au chaos américain ? », « Macron, un populisme en cours de décomposition », « Pourquoi le succès du populisme macho auprès des femmes ne se dément pas », « L’Indonésie s’attaque désormais au populisme islamique », « Le vote populiste en France est déjà majoritaire ». Bref, le populisme est partout — et donc nulle part. Retenu « mot de l’année » par le Cambridge dictionary en 2017, il a fait l’objet, à gauche, de vives discussions depuis que plusieurs formations l’ont revendiqué en vue d’affronter l’ordre capitaliste. Deuxième volet de ce dossier consacré au populisme et initié par les chercheurs Arthur Borriello et Anton Jäger : une discussion avec Jean-Yves Pranchère, philosophe, auteur et professeur de théorie politique à l’Université libre de Bruxelles.
Lire le premier volet https://www.revue-ballast.fr/retour-sur-une-decennie-de-populisme-europeen/

[Tatsuya Tanaka]
Nous observons un usage frénétique du terme « populiste ». Le concept nous permet-il de saisir quelque chose de spécifique, ou n’est-il qu’un paravent nous empêchant de penser la réalité politique de notre temps ?
L’inflation sémantique actuelle entretient la confusion et rend l’utilisation du terme de plus en plus difficile. Mais l’abandonner serait sans doute une erreur car il y a un certain nombre de cas où le concept de populisme reste opératoire. Le Mouvement cinq étoiles et celui des gilets jaunes sont assez prototypiques en la matière. La qualification de « populisme de gauche » peut difficilement être refusée à un mouvement comme Podemos. De façon générale, il n’y a pas de raison de récuser a priori le terme de populisme pour des mouvements qui le revendiquent explicitement. Le débat est cependant embrouillé pour deux raisons. D’une part, parce que le « populisme » fonctionne dans le langage médiatique comme un synonyme de démagogie, ce qu’il faut radicalement refuser — on ne peut sur ce point qu’être d’accord avec les analyses d’Antoine Chollet 1 et de Federico Tarragoni. Il ne suffit pas qu’un programme soit démagogique, méprise les médiations de la démocratie représentative ou propose des mesures irréalistes, mais vendeuses électoralement, pour qu’on puisse parler de populisme. Qu’un leader soit populaire et invoque la « volonté du peuple » n’en fait pas un leader populiste pour autant. D’autre part, la deuxième inflation qui doit être fermement combattue, c’est l’utilisation du terme pour stigmatiser tout mouvement démocratique qui porte des revendications qui ne sont pas compatibles avec la doxa néolibérale ou technocratique.
Il faut du reste être extrêmement prudent dans l’usage du terme lorsqu’il s’agit de qualifier le « populisme de droite », autrement dit des leaders qui présentent avant tout des ressemblances, même partielles, avec le fascisme des débuts. Quand on est face à un nationalisme autoritaire, il faut l’appeler par son nom. C’est faire à ces mouvements-là un cadeau indu que de les qualifier de « populistes ». Je ne pense pas que Matteo Salvini ou Viktor Orbán soient populistes — quand bien même le second revendique le terme dans certains discours. Un affect anti-oligarchique est essentiel au populisme : là où manque la dimension d’une défense des droits du peuple, droits qui supposent un attachement au rule of law [règne de la loi. Notion juridique anglaise] ou à l’État de droit, contre des pouvoirs oligarchiques qui attaquent la démocratie, on ne peut pas parler de populisme. On ne devrait pas avoir trop peur, en revanche, d’un usage un peu large du terme « fasciste » — Albert Ogien propose par exemple de considérer Steve Bannon comme fascisant, et je crois que c’est assez juste, même s’il s’agit d’un fascisme inédit, décontracté et pour ainsi dire « postmoderne ».
« Fascisme », c’est un terme dont l’usage répété fait également l’objet de critique…
On hésite à utiliser ce terme parce qu’on tend à se focaliser sur le moment paroxystique du fascisme qu’a été le nazisme après 1933, au risque d’oublier ses formes antérieures qui avaient parfois une dimension anticapitaliste, la Sturmabteilung, la SA, avant 1934, et faisaient un usage rhétorique intense de la volonté du peuple. Cette rhétorique est très frappante dans le premier fascisme italien et joue un rôle dans l’hostilité de Mussolini à Hitler avant la crise éthiopienne, les notes de Mussolini sur Mein Kampf sont vivement critiques. Il faudrait relire ici Camillo Berneri. Garder en mémoire ce qu’a été le premier fascisme, avec ses ambiguïtés et son côté « rebelle », devrait conduire à ne pas disqualifier trop vite l’emploi du mot « fasciste » pour désigner l' Alt-right.[alternative right. Terme désignant une partie de l'extrême droite américaine qui rejette le conservatisme classique ]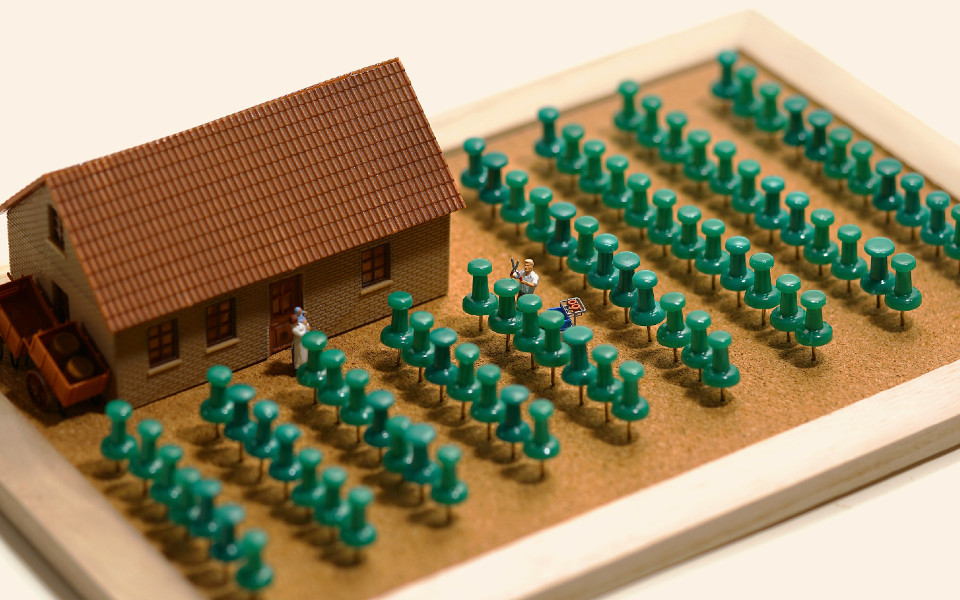
[Tatsuya Tanaka]
Où classer Trump, par exemple ?
Le cas Trump est complexe, mais l’analyser requiert de ne pas confondre le populisme et ce que Patrick Savidan a appelé la « démocratisation de la tentation oligarchique ». Peut-être pourrait-on parler de « massification » ou de « popularisation » du sentiment oligarchique. Chez Trump, comme chez Berlusconi par exemple, la rhétorique anti-establishment présente des traits populistes. Mais elle se distingue du populisme par ses traits ubuesques et « néroniens » — « pagliacistes », comme les nomme Jean-Louis Vullierme. Alors que le populisme se revendiquait de la moralité du travailleur honnête, Trump s’est mis en scène comme un « super-gagnant » qui affirme sa surpuissance dans la transgression grotesque et le mépris des lois. Cet imaginaire est au plus loin de l’égalitarisme populiste qui défend les « gens ordinaires ». C’est pourquoi sa rhétorique complotiste n’est pas dirigée contre des pouvoirs oligarchiques auxquels on voudrait opposer, comme dans la tradition du populisme étasunien, de solides mesures démocratiques et sociales. Elle vise d’abord des couches sociales présentées comme parasitaires qui sont pour les unes des couches défavorisées, privées de pouvoir politique et économique, mais qu’on accuse d’être « assistées », et d’autre part l’establishment intellectuel — comme lorsque Berlusconi opposait « l’Italie qui travaille » à « l’Italie qui bavarde » —, et à travers lui la rationalité critique. Ce déplacement de la cible est tel qu’on ne peut pas parler de mouvement anti-oligarchique. La dénonciation du « deep State » [État profond ] ne vise pas les pouvoirs du capital, mais les structures concrètes de l’État de droit.
Il est d’ailleurs significatif, dans cette rhétorique, que les affects « populistes » qu’elle capte ne sont pas des affects proprement populaires : ce qu’on appelle « le peuple » n’a pas vraiment voté Trump, il s’est abstenu. Le succès de Trump est surtout l’œuvre des petites classes moyennes hantées par la peur du déclassement, peur typique de l’électorat fasciste mais très éloignée du progressisme qui caractérisait normalement les électorats populaires-populistes. C’est un électorat composé de gens qui se vivent, pour le dire familièrement, comme étant « du bon côté du manche » et qui veulent le rester. Ils veulent que soit maintenue une barrière entre eux et les couches populaires les plus basses, les exclus, les pauvres, les immigrés et leurs descendants, etc. ; ils veulent continuer à appartenir aux couches moyennes et au camp des gagnants. Par ailleurs, le racisme et les affects d’hostilité au féminisme et à la délibération démocratique, qui ont joué un rôle dans le succès de Trump, ne sont pas des affects populistes. L’identification aux gagnants, dont Trump est le symbole, qui peut s’arrimer à des sentiments nationalistes, relève d’affects oligarchiques élargis aux dimensions des démocraties de masse et surdéterminés par les mœurs de la société de consommation.
On entend souvent mentionner le rôle joué par le leader et l’organisation verticale des mouvements populistes. Est-ce spécifique au populisme ou s’agit-il d’un trait plus général relatif à la personnalisation de la vie politique dans nos démocraties occidentales ?
Si le rôle du leader était spécifique au populisme, alors il faudrait dire que les démocraties libérales vivent en régime populiste depuis toujours, à l’exception peut-être de la Suisse que sa démocratie directe a protégé contre la personnalisation de la vie politique. On voit ici les limites des définitions déshistoricisées du populisme. Les travaux d’Antoine Chollet sont absolument décisifs sur la question. Une définition du populisme doit être capable de préciser le lien qu’elle entretient avec les mouvements qui ont historiquement imposé ce nom. Ce qui me gêne dans les travaux de Jan-Werner Müller et de Cas Mudde, en dépit du fort intérêt et de la pertinence d’un grand nombre de leurs descriptions, c’est qu’elles sont déconnectées de l’histoire réelle du phénomène, où les populismes étasuniens et russes sont centraux. Un peu comme si on produisait une théorie du socialisme en considérant que tout ce qui s’est passé avant 1980 est non-pertinent.
[Tatsuya Tanaka]
Dans le populisme américain, il n’y a pas de leader. Donc le leader n’est pas essentiel aux mouvements populistes, ni d’ailleurs la xénophobie ou le racisme, rappelons l’alliance entre populistes et républicains noirs à Wilmington, alliance écrasée dans le sang par des émeutes racistes en 1898. Avec le populisme américain, on a un mouvement qui ressemble beaucoup à ce que Claude Lefort appelait la « démocratie sauvage ». Plus démocratique que sauvage d’ailleurs, puisque c’est une organisation sans leader avec un programme progressiste qui va lentement se réaliser : progressivité de l’impôt, transports publics, banques de dépôt, nationalisations, abolition de l’étalon-or, etc. Si l’on regarde ce que demandait le People’s Party à l’époque, c’est peu ou prou le modèle démocratique européen tel qu’il existait dans la période des Trente Glorieuses.
Il reste qu’un autre élément historique me semble décisif pour penser le populisme à partir de son émergence au XIXe siècle, c’est sa différence avec le mouvement socialiste. On pourrait illustrer cette différence par l’opposition entre le cinéma épique d’un Eisenstein et le cinéma typiquement populiste d’un Frank Capra. L’expérience russe mérite ici l’attention : on peut lire le court texte de Lénine contre les populistes, intitulé « Ce que sont les amis du peuple et comment ils luttent contre les sociaux-démocrates ». En Russie, les populistes ont dû soit se fondre dans le mouvement socialiste, soit se définir par opposition à lui — et s’étioler. Aux États-Unis, a contrario, on pourrait dire que le populisme a pu prospérer parce qu’il n’y avait pas la social-démocratie. Quant au péronisme, il était violemment anti-marxiste.
Le cas du populisme étasunien, qui a « démocratisé » le Parti démocrate et l’a transformé en un parti défenseur des classes populaires, ne permet pas d’assimiler le populisme à un mouvement hostile à la démocratie représentative. Il invite plutôt à définir le populisme comme un mouvement qui vise soit à rétablir les normes démocratiques contre des captations ou des dérives oligarchiques de la démocratie, soit à les instituer, comme dans le populisme de la frontière aux États-Unis, qui visait à établir l’État de droit et en mettant fin à la violence oligarchique des grands propriétaires fonciers. Mais le point frappant est qu’il s’agit dans tous les cas d’un mouvement démocratique défensif. Ce n’est pas un mouvement révolutionnaire ou socialiste qui porterait le projet d’une autre société ; il vise à conserver dans son authenticité une démocratie existante, que cette existence prenne la forme d’institutions établies dont on peut invoquer l’esprit fondateur, ou qu’elle prenne la forme de la socialité solidaire de couches populaires par rapport à laquelle les pouvoirs oligarchiques apparaissent comme des forces prédatrices qui viennent détruire un ordre qu’il s’agit de protéger. Il s’agit de défendre un ordre démocratique, qu’il soit institué ou spontané, et non de transformer les rapports sociaux. 
[Tatsuya Tanaka]
Quel est le rôle du peuple par rapport au leader ?
C’est une vieille question — elle est déjà au centre de la pensée de Machiavel. Quel rapport entre la thèse « populiste » qui est au premier plan du républicanisme des Discours sur la première décade de Tite-Live, la liberté tient à la lutte du peuple contre la cupidité des Grands, et la proposition « cynique » du Prince, les Grands doivent être matés par un Prince sans scrupules mais épousant la cause du peuple, ? Le lien des deux livres est-il nécessaire ou conjoncturel ? Un premier point doit être souligné : le populisme « initial » ne requiert pas l’homogénéité du peuple. Le peuple y est simplement, comme chez Machiavel, l’ensemble de ceux qui ne veulent pas être dominés et qui ne veulent pas dominer. Cela correspond à un affect nécessaire de la démocratie. Cependant — et c’est là que commencent les possibilités de dérive de la valeur du terme —, la figure du peuple-travailleur, qui, dans le populisme étasunien, se lie à l’idéal du self-made man, contient en germe un point d’accroche pour un autre type de discours, qui ne serait plus centré sur le refus de la domination des oligarques, mais sur l’hostilité aux « parasites » en tous genres. À partir de l’idéal du self-made man, on peut arriver à un soi-disant « populisme » d’entrepreneurs, dont Berlusconi ou Macron seraient des exemples. L’autre point de départ pour une telle dérive, c’est que, le populisme ayant pour trait caractéristique la défense d’un sens commun démocratique — qui est d’abord un sens du commun, lequel constitue en tant que tel une condition vitale de la démocratie —, il suppose une sorte de confiance dans les croyances partagées et ne requiert pas le travail de la rationalité critique. On retrouve ici la différence avec le socialisme, qui requiert au contraire une production théorique complexe, sous la forme d’une déconstruction de l’aliénation idéologique et du fétichisme de la marchandise (Marx) ou d’un savoir sociologique réflexif (Durkheim). Loin de ces efforts théoriques qui veulent accompagner la rupture des classes révolutionnaires avec l’idéologie dominante, les populistes historiques s’appuient sur l’immédiateté du sens commun. Ils demandent simplement que les oligarques reviennent au sein du peuple et de son sens (du) commun ; il s’agit d’une demande d’inclusion plutôt que d’exclusion, qui se réalise dans l’établissement d’impôts progressifs permettant à la démocratie des libres propriétaires de se développer pleinement. Mais qu’advient-il si le « sens commun » qui sert d’appui à la demande démocratique est celui des libres entrepreneurs qui veulent être imposés le moins possible ?
Et qu’advient-il par ailleurs si le sens commun populaire se lie à un désir d’homogénéité et de puissance nationales ? On ne peut éviter d’évoquer ici une des grandes références historiques des définitions du populisme, référence qui domine chez Ernesto Laclau, qui est le péronisme — où la figure du leader devient centrale. La définition du populisme change parce que la définition du peuple change : celui-ci n’est plus référé à l’idéal des pionniers et des travailleurs appelés à entrer dans les classes moyennes, mais à la plèbe reléguée dans la misère par l’alliance entre des oligarques, les propriétaires fonciers, principalement, et des classes moyennes très étroites. En l’absence d’une large classe moyenne qui est le ressort naturel d’une démocratisation active, le populisme de style étasunien, qui bénéficie des ressorts expansifs des institutions, n’est pas une possibilité. À supposer qu’on accepte de considérer le péronisme comme un modèle de populisme — mais n’oublions pas que ce terme lui est appliqué de l’extérieur et que certains lui reprochent de sous-estimer les traits fascisants du régime — celui-ci apparaît alors comme une solution pour forcer une démocratisation en situation de blocage empêchant la construction d’une démocratie représentative digne de ce nom. L’appui de la démocratisation sociale, qui apparaît rétrospectivement comme le préalable de la démocratie politique, c’est alors l’alliance de l’armée et de la plèbe. Mais dans cette interprétation du populisme sur un modèle « péroniste » idéalisé, il faut noter que le populisme, parce qu’il doit s’incarner dans un leader censé incarner la volonté unitaire d’un peuple rassemblé par la lutte contre ses ennemis, implique toujours le risque d’une dérive autoritaire.
Ces alliances ne conduisent-elles pas à homogénéiser le peuple ?
Dans ce modèle-là, il y a effectivement une dimension antipluraliste, au moins latente. Le peuple n’est plus seulement l’ensemble de ceux qui refusent la domination ; l’organisation de la volonté populaire doit prendre la forme du peuple-nation en lutte contre les corps qui lui sont étrangers. Dans ce modèle-là, les affects populistes sont donc moins démocratiques que dans le populisme étasunien. C’est que ce populisme surgit dans un contexte de très grande violence sociale et qu’il ne s’agit plus tant de défendre la démocratie que d’atteindre le seuil d’égalité nécessaire à l’existence de la démocratie ; par conséquent, la revendication d’homogénéité populaire, l’exaltation nationale, l’hostilité aux « parasites » peuvent devenir actifs et absorber le mouvement. Si dans le cas du populisme étasunien on a affaire à une sorte de « populisme des droits de l’Homme », le danger du populisme latino-américain est la tentation d’abandonner les droits de l’Homme au nom du service du peuple, lui-même conçu en fonction d’une norme d’authenticité aggravée par un imaginaire nationaliste.
[Tatsuya Tanaka]
C’est à partir de là qu’on en arrive à la question des formes contemporaines du populisme. Dans les usages du mot qui prévalent aujourd’hui en Europe, ne sont plus retenus que l’anti-pluralisme et l’anti-élitisme qui découleraient de l’invocation de l’unité du peuple contre l’oligarchie. Il me semble qu’une telle réduction est intenable. Pour qu’il y ait populisme, il faut qu’il y ait une demande égalitaire, même fourvoyée et dévoyée. On ne peut pas faire de l’hostilité au pluralisme démocratique et à l’État de droit le noyau dur du populisme. Il se peut qu’il faille accepter de décrire comme populistes des mouvements droitiers et chauvins ayant une dimension sociale, le PiS polonais pourrait rentrer dans cette catégorie ; mais l’usage du terme suppose qu’il y ait cette dimension sociale ou un côté égalitaire. Ce qui fait qu’une « politique du ressentiment » peut être populiste n’est pas la désignation de boucs émissaires, ce n’est pas donc pas, précisément, le ressentiment lui-même, — c’est le fait qu’elle répond, sur un mode falsifié et mystifié, à une frustration démocratique. Là où la demande et la réponse sont des demandes nationalistes ou, de facto, oligarchiques, il n’y a pas lieu de parler de populisme, sauf à brouiller tous les repères. Une rhétorique anti-élites accompagnée d’un culte du succès peut ressembler au populisme : elle n’en relève pas pour autant. Elle est tout au plus un leurre populiste destiné à élargir son électorat.
Le populisme de gauche contemporain partage-t-il ce type de traits que vous décrivez, ces dérives possibles ?
Ça dépend de plusieurs choses, mais principalement de l’importance qui est accordée au signifiant « gauche ». Plus le populisme se prétend « au-delà de la gauche et de la droite », moins il est prêt à assumer le pluralisme constitutif de la démocratie. Prenons, comme exemples de populisme contemporains, les expériences de Podemos, la France insoumise et Cinque Stelle. Podemos ressemble beaucoup au populisme historique de type US et a accepté de rentrer au gouvernement dans le cadre d’une union de la gauche qui contraint le PS à se faire plus social-démocrate qu’il n’était ; il joue donc le jeu du pluralisme. Le cas du Mouvement cinq étoiles est plus ambigu, et plus encore — surtout depuis la défaite de 2017 — le cas de la FI. C’est un mouvement qui ne cesse d’exploser sous son propre sectarisme. Le problème est ici dans la place que Jean-Luc Mélenchon accorde à la souveraineté nationale, qu’il considère comme l’alpha et l’oméga de la tradition dont il se revendique. Contrairement à ce qu’il prétend, cela implique une rupture avec la tradition socialiste : la souveraineté ne joue de rôle central ni chez Marx, ni chez Durkheim.
Si on se risque à extrapoler, on peut dire que, historiquement, le populisme s’est défini, chaque fois qu’il a fonctionné, comme un vecteur de démocratisation. C’est pour cette raison qu’il tend à ne pas avoir de consistance propre : une fois que le parti populiste américain a démocratisé le Parti démocrate, il disparaît dans celui-ci. Si le populisme réussit à construire un État de droit social, il quitte la scène. On pourrait aller jusqu’à dire que, s’il ne disparaît pas dans son action, c’est probablement qu’il dérape dans l’autoritarisme, ce qu’on pourrait illustrer par le cas du Venezuela, où Chávez n’a pas construit un État social. La question qui se pose est alors : que signifie le fait de miser sur le populisme dans des pays qui conservent l’héritage social-démocrate de l’État social, même abîmé ? Miser sur le populisme, cela suppose le diagnostic suivant : premièrement, nous sommes dans un processus de dé-démocratisation — ce qui est peu contestable — et deuxièmement, puisque les ressources traditionnelles de la démocratie représentative ne suffisent plus à réembrayer le processus de démocratisation et d’extension des droits sociaux, il faut mobiliser des affects populistes pour répondre à la dérive oligarchique. C’est compréhensible, quoique douteux, mais si on mobilise ces affects en renonçant au signifiant « gauche », on commet à mon sens plusieurs erreurs.

[Tatsuya Tanaka]
Lesquelles ?
En premier lieu, on procède à un diagnostic trop pessimiste des ressources démocratiques disponibles et on suppose hâtivement que les sociétés européennes d’aujourd’hui sont comparables aux sociétés latino-américaines du milieu du XXe siècle. Mais surtout, on affirme que pour recomposer la social-démocratie qui a littéralement disparu, puisque, lorsqu’ils existent encore, les partis socialistes sont aujourd’hui tout au plus des libéraux de gauche, il faut régresser en-deçà d’une position sociale-démocrate et mobiliser les foules autour de la seule opposition entre « les gens » et « la caste ». Or, ce faisant, on continue le travail de sape néolibéral ! On participe en fait au travail de dé-démocratisation en abolissant les référents qui organisaient la résistance à l’extension des pouvoirs du capital. Cette idée, présente chez Chantal Mouffe et Mélenchon, d’abandonner la référence à la gauche — le populisme substitue selon eux l’opposition peuple/élite à l’opposition droite/gauche — pour la retrouver ensuite dans un « populisme de gauche », me semble étrange. Si on abandonne la référence à la gauche, on ne la retrouvera pas ensuite. Nous ne sommes pas dans le contexte américain, où la référence populiste conduit des gens comme Bernie Sanders à réhabiliter le terme « socialiste ».
Ce que fait le populisme européen — à l’exception de Podemos —, c’est exactement le contraire : sous prétexte de retrouver un jour la référence socialiste, on la démolit en la disqualifiant, ce qui alimente évidemment la droite. Des gens comme Steve Bannon l’ont très bien compris : l’opposition peuple/élites, en Europe, joue au profit de l’extrême droite. Il n’y a que Marine Le Pen qui soit capable d’articuler ensemble, dans une « chaîne d’équivalence »2, à la fois les gilets jaunes et les policiers qui leur tirent dessus. La démolition des références à la gauche et au socialisme explique d’ailleurs pour beaucoup l’échec de Mélenchon aux européennes. En Europe, le rôle dévolu au populisme — s’il y en a un — devrait être de ramener la social-démocratie à gauche, de rebâtir une social-démocratie qui mérite son nom : un mouvement qui impose des compromis de classe drastiques au capital à travers l’impôt, la redistribution etc. Et c’est cela qui était attendu de Mélenchon : son succès aux présidentielles est dû à ce que l’électorat de gauche a vu en lui le seul à pouvoir occuper la place inoccupée de la social-démocratie — ce qu’il a refusé de faire au soir du premier tour des présidentielles, transformant ainsi sa réussite partielle en échec. Ce qui fait la force de Podemos me semble être de ne pas avoir reculé devant un devenir social-démocrate. D’une part, contrairement à la FI, Podemos est multicéphale et pluriel dans les faits, grâce aux municipalités et à la concaténation de figures qui existent en son sein et qui ont chacune leur individualité forte, à l’instar d’ Ada Colau et de Manuela Carmena. D’autre part, Podemos a accepté l’alliance avec les socialistes.
Revenons sur l’idée que le populisme de gauche favoriserait celui de droite par son abandon de toute référence à la gauche. Cette tendance se joue-t-elle prioritairement sur le terrain discursif — l’abandon des symboles liés à la gauche, drapeaux rouges, poing levé, référence au prolétariat, etc., — ou est-ce précisément la foi excessive des tenants de l’hypothèse populiste en la puissance du discours qui les conduit à négliger le travail, qui était celui des partis communistes et sociaux-démocrates autrefois, d’encadrement organisationnel des masses ?
Pas seulement d’encadrement : de recueil et de construction du savoir populaire. De ce point de vue, je suis assez proche des thèses défendues par Bruno Karsenti et Cyril Lemieux dans « Socialisme et sociologie ». Je pense qu’il y a tout un travail à faire, afin que le mouvement politique soit le producteur d’une connaissance de la société sur elle-même. Mais cela suppose que le peuple soit compris comme société, société de « ceux qui ne veulent pas dominer ». Le passage d’une définition purement négative du peuple à une notion positive, ensuite, suppose tout le travail de la pluralité sociale, de la composition des intérêts, des systèmes de réciprocité, etc. Et de ce point de vue, la limite du populisme — mise à part, encore une fois, l’exception Podemos — est double : elle se situe à la fois sur le plan du symbolique et des réflexes « dégagistes ». Autant le discours anti-oligarchique dégagiste pouvait fonctionner pour des fermiers américains adoptant l’ American way of life dans les zones de la frontière à la fin du XIXe siècle, autant il n’est absolument pas à la hauteur de la terrifiante complexité des enjeux sociaux du capitalisme contemporain — il est beaucoup trop primitif, et je crois que la gauche ne peut pas se permettre de l’employer.

[Tatsuya Tanaka]
La question du rapport du populisme à la technocratie d’une part et au néolibéralisme d’autre part se pose : s’agit-il d’un rapport forcément antithétique ou ces termes sont-ils compatibles d’une façon ou d’une autre ?
Nous sommes piégés entre deux possibilités : ou on purifie le concept de populisme, et une technocratie populiste ne peut pas exister, pas plus que Trump ne peut être qualifié de populiste, ou on accepte l’usage extensif qu’en font les médias et on tente de les prendre à leur propre piège. Dans le second cas, si on admet que le populiste est un acteur portant une rhétorique anti-establishment et méprisant les corps intermédiaires, alors Macron est le populiste par excellence, et l’élection présidentielle française ne s’est jouée qu’entre populistes, à l’exception de Benoit Hamon. À partir du moment où l’on cesse de définir le peuple négativement comme ceux qui ne veulent pas être dominés et qu’on tente d’en donner une définition substantielle, alors effectivement le populisme va pouvoir se décliner dans toute une série de variantes selon la définition qui est donnée du peuple. On pourra donc avoir aussi bien le « national-populisme » que le « techno-populisme », pour lequel le vrai peuple est le peuple de ceux qui sont entrepreneurs d’eux-mêmes, et qu’on trouvait déjà chez Berlusconi, par exemple. Mais c’est pousser loin le stretching conceptuel… Toute la question est là : veut-on jouer la stratégie de « rétorsion » ou la refuser, et préserver la définition « pure » du populisme comme mouvement anti-oligarchique ? Dans les faits, on est un peu obligé de jouer les deux, parce que le sens médiatique du terme est tellement présent qu’on ne peut pas complètement lui échapper. Cela dit, il faut être conscient que, selon qu’on poursuit l’une ou l’autre stratégie, on n’est pas du tout dans le même registre discursif, et qu’accepter de parler une langue que l’on pense fausse pour la tordre de l’intérieur ou pointer ses contradictions nous éloigne inexorablement du registre scientifique. C’est un jeu dangereux.
Quid du rapport au néolibéralisme ?
C’est une question très compliquée. Au sens strict, le néolibéralisme n’est pas un populisme. Il veut transformer les individus en entrepreneurs d’eux-mêmes et remplacer le peuple et la société par le seul marché. En revanche, si on veut jouer la stratégie de rétorsion contre l’usage dominant du terme, bien des phénomènes qui sont qualifiés de « populistes », en Europe de l’Est par exemple, sont en réalité du néolibéralisme. Si on joue ce jeu, il n’y a pas de contradiction : Thatcher était une populiste autoritaire, le néolibéralisme adore utiliser l’apparence populiste de la démocratisation du sentiment oligarchique et le néolibéralisme, en tant qu’ennemi de la démocratie représentative, est un populisme. Mais pour en arriver là, il faut nécessairement accepter une dérive sémantique très importante. La reconnaître et la combattre n’empêche pas de s’inquiéter de la montée de ce populisme confusionniste, prétendument « ni de droite ni de gauche », où peut s’opérer une rencontre entre l’extrême droite et l’extrême gauche. Cela a été le cas des gilets jaunes, qu’on le veuille ou non.
Comment ça ?
Si les gilets jaunes ne sont pas un mouvement néolibéral — au-delà du caractère souvent contradictoire de ses demandes, c’est un mouvement qui réclame un refinancement des services publics par l’État —, c’est quand même un mouvement qui résulte de l’action du néolibéralisme. On peut regarder la base sociale initiale des gilets jaunes avant qu’une phase d’entrisme ne le décale vers la gauche — sans pour autant mettre fin à un certain entrisme de l’extrême droite. Sociologiquement, les gilets jaunes, c’est avant tout la France « périphérique », de la « diagonale du vide » : des gens très endettés et dépendants de la voiture, par conséquent extrêmement sensibles à l’augmentation du prix du diesel. D’une certaine façon, ce sont des personnes qui ont joué loyalement le jeu du néolibéralisme en faisant les choix économiques rationnels qu’il leur proposait : quitter la banlieue pour aller habiter dans un pavillon, s’endetter pour accéder à la propriété, fonctionner comme un auto-entrepreneur. On pourrait dire que ce sont typiquement les sujets que produit la politique néolibérale : des individus « entrepreneurs d’eux-mêmes », désaffiliés, qui n’appartiennent à aucun collectif, ne militent dans aucun syndicat… Lorsque ces individus, après avoir joué le jeu, se voient tirer le tapis sous les pieds, la révolte éclate et prend un caractère populiste, inorganique, sans cadre, sans parti, où tout le monde est le bienvenu pourvu qu’il ou elle ne milite pas pour un parti. Il y a là une sorte d’image inversée du néolibéralisme, comme dans l’ inorganisme du Référendum d’initiative citoyenne (RIC) : c’est une espèce de révolte de sujets néolibéraux contre un néolibéralisme dont ils ne sont pas capables de dépasser les cadres mentaux. Il y a ainsi dialectique, plutôt que complicité, avec le néolibéralisme. D’où les impasses et l’épuisement d’un mouvement dont toutes les demandes étaient adressées à l’État, et pas une seule aux patrons ou au Medef. Thatcher voulait qu’il n’y ait rien entre l’individu et l’État. D’une certaine façon, les gilets jaunes, c’est la révolte de ceux qui ne voient rien entre eux et l’État.

[Tatsuya Tanaka]
Ce qui rend la définition du populisme si difficile est qu’elle dépend de l’identité sociologique du peuple. Les populismes historiques se sont formés dans des situations où « le peuple » était une catégorie sociale identifiable. Dans le populisme russe, par exemple, le peuple est une paysannerie aux mœurs communautaires. Mais que veut dire « populisme » dans des sociétés ramifiées par la division du travail, où le peuple se compose massivement de classes moyennes et d’individus aux statuts sociaux extrêmement diversifiés, autrement dit où le peuple n’est pas le nom d’une unité sociale mais d’une diversité d’intérêts et de mœurs fortement individualisés ? Il est douteux que l’invention de « chaînes d’équivalences » soit une réponse suffisante à cette question qui reste inscrite dans la matérialité des rapports sociaux. Dans son dernier livre, L’Esprit démocratique du populisme, Federico Tarragoni explique que le populisme doit faire son deuil de trois notions : la nation, la volonté générale et la souveraineté. Aller au bout de cette logique devrait conduire à demander que le populisme fasse son deuil du « peuple ». Toutes les difficultés de la pensée du populisme convergent peut-être dans ce paradoxe. Mais s’il est vrai que le populisme ne peut être, en son sens positif, qu’un embrayeur de démocratisation, c’est un paradoxe qui a sa légitimité.
1. Antoine Chollet est enseignant-chercheur à l’Université de Lausanne : il travaille sur les théories contemporaines de la démocratie, le tirage au sort, le temps et le populisme. Il est notamment l’auteur de Défendre la démocratie directe (PUR, 2011) et Temps de la démocratie (Dalloz, 2011).
2. En référence à la pensée de Laclau. Les « chaînes d’équivalence » correspondent aux demandes formulées lors des processus de construction d’une hégémonie politique. Pour qu’une demande devienne hégémonique, elle doit être considérée comme équivalente à d’autres demandes. Pour Laclau, le moment populiste répond aux frustrations liées à la pluralité des demandes en procédant à leur
articulation et leur agrégation.
- Arthur Borriello est politologue et supporter acharné du SSC Napoli. Spécialiste de l'analyse du discours politique, il travaille actuellement sur les populismes sud-européens.
- Anton Jäger est doctorant à l’Université de Cambridge. Il travaille notamment sur le populisme, l’histoire intellectuelle et la question du travail.
Photographies de bannière et de vignette : Tatsuya Tanaka

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire