
Illustration de bannière : Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat, Untitled (Two dogs), 1984
Au départ de ce texte, qu’il faut sans doute situer quelque part entre la spéculation et la rêverie, les mots d’un poète néerlandais. L’auteure, poétesse elle-même, s’en empare pour louer, au fil d’une plume trempée dans la tradition libertaire, les vertus mobilisatrices de l’imaginaire en politique. Sans quoi, « il n’est pas de révolution ». On croisera donc un commandant de sous-marin, des barbares, un abbé, un orage, et même un vieux chien grec.

Le souvenir est-il vraiment « un chien qui se couche où il lui plaît » ? C’est ce que soutient le poète néerlandais Cees Nooteboom, et à sa suite le professeur d’histoire de la psychologie Douwe Draaisma, auteur d’un livre fait pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du temps qui passe et aux mécanismes de la mémoire, Pourquoi la vie passe plus vite à mesure qu’on vieillit. Le souvenir est-il vraiment ce compagnon fidèle qui finit par nous trahir au gré des impératifs de la biologie du cerveau, dévoré par sa vieillesse et félon malgré lui ? Mais, surtout, quelle sorte de chien peut-il bien être, ce souvenir ?
Un qui vous lèche tendrement la main en réclamant des caresses ? Un qui vous mord au mollet pour vous demander de sortir ? Un qui vous prévient à l’approche des méchants, qui vous protège et vous sourit de toute sa gueule affectueusement levée vers vous ? J’aimerais méditer quelques instants, à partir du livre de Draaisma, et de quelques réminiscences liées à Cornelius Castoriadis, sur un sujet qu’il ne traite absolument pas, mais qu’il éclaire involontairement : les rapports ambigus de l’imaginaire, de la mémoire et de la politique. Féconds à première vue, dangereux au second examen mais finalement plus inextricables qu’il n’y paraît.
Féconds, bien sûr : commençons par une intuition — l’imaginaire nous met en mouvement, nous incite à l’action et conditionne parfois le passage aux actes. Pour qui ne supporte ni l’injustice ni les violences plus ou moins dissimulées de la société, la lecture de Charles Dickens ou de Jack London, de Victor Hugo ou de George Orwell, d’Emma Goldman ou de Victor Serge, plus près de nous de Patrick Chamoiseau ou d’Ursula Le Guin, de Maryse Condé ou d’Alain Damasio, joue à la fois comme révélateur et comme détonateur. Ce que l’on pressentait se matérialise sous la forme de personnages plus vrais que nature. Ce que l’on désirait, la fiction, ou la vie muée en autobiographie romanesque, qui devient un réel fictionné pour qui apprend à penser dans les livres, semble le rendre envisageable : l’imaginaire rend le possible imaginable. Or, la politique n’est rien d’autre que l’art de faire passer les rêves de l’état gazeux à l’état révolutionnaire. L’héroïsme n’est peut-être que l’effet d’une boucle de rétroaction : celle qu’exercent nos lectures sur nos espoirs, et à leur tour ces espoirs, déçus ou victorieux, sur les livres qui les racontent.
C’est parce que l’on aime le capitaine Nemo ou le comte de Monte-Cristo que l’on se veut justicier ; c’est d’ailleurs quelquefois parce que l’on a trop lu les histoires de la Révolution française et de 1917 qu’on se prendrait bien pour Saint-Just ou pour Trotsky — négligeant au passage les guillotinés de la Terreur et les morts de Kronstadt. Car la littérature emporte aussi le risque de fabriquer des héros à bon compte, lavant le sang à grande eau et faisant fi de la violence réelle. Sur papier glacé, les assassins qui le furent « pour la bonne cause » passent mieux que les autres, et l’on trouve toujours d’ardents défenseurs de Staline qui feraient mieux de relire Panaït Istrati. Au passage, notons-le, à moins de mourir à temps, il n’est pas facile, dans le monde réel, de finir en héros révolutionnaire innocent, tendre et joyeux. Che Guevara ou Castro nous font rêver à proportion des méfaits que nous choisissons d’ignorer ; ceux qui n’ont su ni fusiller ni gouverner se sont bien souvent fait fusiller eux-mêmes ou enfermer : tout se passe comme si seuls les oubliés de l’Histoire pouvaient se permettre le luxe de ne pas trahir l’idéal… Et pour cause — le pouvoir ne leur échut jamais pour leur brûler les mains.

Jean-Michel Basquiat, Undiscovered Genius of the Mississippi Delta, 1983
Mais revenons à notre affaire. La construction de soi comme « homme révolté » suppose toujours l’existence de modèles, plus ou moins purs, exaltants ou sombres. Robin des Bois ou Arsène Lupin, nous préparant à l’action, nous indiquent qu’il faudra en assumer la part la moins glorieuse autant que la plus excitante. Jusqu’à l’adolescence au moins, nous voulons tous écrire le roman de nous-mêmes en train de changer le monde. Adultes, nous profitons souvent des parenthèses trop rares des « vacances » pour entretenir l’illusion de pouvoir encore participer à quelque grandiloquente aventure. Et il semble bien que nous ne soyons, à la dernière heure de la mémoire, aux derniers jours du sablier qui nous défera, qu’une histoire à raconter aux petits-enfants, qu’une narration plus ou moins réussie, qu’une épopée plus ou moins fantastique. Au mieux, ce conte s’inscrit dans une mythologie collective, celle de l’usine ou du syndicat, du parti ou du club. Même là pourtant, nous avons tendance à croire que seuls les grands hommes, si ce n’est les grandes femmes, peuvent tout bouleverser. L’idée d’une révolution collégiale nous effleure à peine et, quand c’est le cas, nous fait plutôt sourire. On admet volontiers en partageant un café au comptoir du commerce que les hommes ont besoin de chef. L’idée d’une direction provisoire et tournante des affaires publiques n’apparaît pas dans les livres d’histoire. On a beau chercher, on ne trouve pas ; et puisque l’on ne trouve pas, on croit que cela n’a pas existé, ni de raison d’exister un jour.
Ici commence la tâche conjointe de l’imaginaire et de la politique, qu’il nous faut écrire sur les pages blanches de la mémoire historique. D’abord, parce que l’absence apparente ne signifie pas l’inexistence réelle. Les vainqueurs ont toujours escamoté les tentatives des vaincus. L’Histoire est bien plus profonde et large que les livres des historiens officiels des vainqueurs ne nous la montrent. On ne cesse de redécouvrir que nos premières interprétations de la préhistoire, de la naissance des sociétés agricoles et des économies organisées par l’État, par exemple, doivent être intégralement revues à la lumière des fouilles archéologiques. Dans les interstices des empires, ont vécu des individus libres qui échappaient aux carcans de l’autoritarisme, nous raconte James C. Scott dans son Homo domesticus, une histoire profonde des premiers États, éloge anarchiste des barbares et des vaincus. Les barbares n’étaient pas des monstres, mais ceux qui vivaient aux marges des États, prétendant échapper à la domination des premiers comptables. Les vaincus n’étaient pas des faibles, mais ceux qui se souciaient moins d’apparaître dans l’arbre généalogique des maîtres que de manger, d’aimer et de vivre à leur guise. Les plus heureux, en l’espèce, ne sont pas ceux que l’on croit. Les chasseurs-cueilleurs mangeaient bien mieux que les premiers agriculteurs, et l’impôt ne fit d’abord le bonheur que des percepteurs.
Ce que l’Histoire ne nous a pas appris, ce sont toutes les ramifications du possible qu’auraient engendré d’autres circonstances, d’autres choix des communautés humaines, d’autres tournants culturels. Il y a des leçons à trouver dans ce qui fut ; mais il n’y a pas de leçon à recevoir de ce qui n’a pas laissé de trace : seul le vraisemblable, l’uchronie, l’imaginaire peuvent nous aider à deviner ce qui a peut-être été, mais oublié, ou ce qui n’a encore jamais été tenté. C’est pourquoi il n’est pas de révolution sans édification imaginaire de la société désirable, appuyée tant sur la mémoire reconstruite du passé que sur le désir encore vierge de l’avenir. Cornelius Castoriadis l’avait bien vu, qui en appelait à une réinstitution imaginaire de la société, ouvrant la porte aux archipels de résistance infrapolitiques, insistant sur les appels d’air de la pensée radicale — non pas extrémiste, c’est-à-dire butée, intolérante et inapte à la discussion, mais radicale, c’est-à-dire autonome, neuve et ancrée dans des convictions fermes bien que toujours ouvertes au dialogue. Le rêveur n’est pas celui qui ne changera jamais d’avis, il est seulement celui qui assume son droit et sa capacité à penser autrement et à considérer ses propres objectifs comme au moins aussi légitimes que ceux qu’on prétend lui imposer au nom d’un « toujours-déjà-là » politique.

Jean-Michel Basquiat, Untitled
Bâtissant chaque jour dans l’ombre les labyrinthes d’une autre société plus solidaire, pariant sur la force de resurgissement des laves secrètes, bouillonnant au fond des volcans qu’on croyait éteints, les rêveurs politiques ne sont pas des apprentis sorciers mais des enfants de la magie. Ceux qui critiquent la « pensée magique » sont en réalité ceux qui ont renoncé aux pouvoirs instituants de l’imaginaire. Ils réitèrent le geste inaugural des premiers scribes utilisant l’écriture pour enregistrer la propriété des grains ou des terres. Or, à l’heure même où s’élaboraient les premiers alphabets, d’autres hommes et des femmes écrivaient des poèmes d’amour sur des papyrus mangés par le temps. S’il nous reste les tablettes d’argile et la démesure de la pierre, elles ne doivent pas servir à effacer la mémoire plus incertaine des parchemins et du bois, la fragilité des édifices faits pour célébrer le présent plus que pour témoigner de la grandeur. Il y eut toujours deux usages possibles de l’écriture, l’un servant à contrôler pour dominer, voire écraser ; l’autre à chanter pour retenir, voire inventer. L’incantation servait aux prêtres et aux guerriers, mais les artisans et les amoureux savaient eux aussi qu’on peut rédiger des charmes sur des parchemins. Les poètes, toujours funambules, se balançant d’un pied sur l’autre, n’étaient que des voleurs de feu qui transmettent le secret de la parole comme on se refile une braise dans la nuit.
Derrière l’apparent consentement à l’autorité, au sein même des premiers grands États esclavagistes de l’Antiquité, demeurait toujours la potentialité d’un refus forcené de la soumission. C’est l’héritage de ceux-là que nous confie la mémoire défaillante des rébellions, pour que l’imaginaire y supplée. Castoriadis lui-même ne prétend pas savoir quand la révolution devient possible, ce qui la rend non plus seulement imaginable mais inévitable et nécessaire. Il nous rappelle seulement que nous avons le droit d’y croire, et ce faisant de l’inventer à notre mesure. Sur un fond d’éternité, l’événement censé perturber le cours de l’Histoire ne surgit jamais qu’à l’heure où tous ceux qui le croyaient impensable vacillent et contemplent avec un rien de panique la défaite de leurs certitudes. « Agir, je viens », clame le poète Henri Michaux dans l’un de ses plus beaux textes lorsqu’il tente de s’ auto-hypnotiser pour concevoir, de l’autre côté de la détresse, des raisons de renaître, phénix de soi-même, réconcilié, plein comme un œuf — d’ivoire. Est-ce un hasard si ce texte apparaît dans un ensemble intitulé Poésie pour pouvoir ?
Poussant la porte en toi, je suis entré
Agir, je viens
Je suis là
Je te soutiens
Tu n’es plus à l’abandon
Tu n’es plus en difficulté
[…]
Tu poses avec moi
Le pied sur le premier degré de l’escalier sans fin
Qui te porte
Qui te monte
Qui t’accomplit
[…]
AGIR,
JE
VIENS
[…]
Ce chant te prend
Ce chant te soulève
Ce chant est animé de beaucoup de ruisseaux
Ce chant est nourri par un
Niagara calmé
Ce chant est tout entier pour toi
Plus de tenailles
Plus d’ombres noires
Plus de craintes
Il n’y en a plus trace
Il n’y a plus à en avoir
Où était peine, est ouate
Où était éparpillement, est soudure
Où était infection, est sang nouveau
Où étaient les verrous est l’océan ouvert
L’océan porteur et la plénitude de toi
Intacte, comme un œuf d’ivoire.
J’ai lavé le visage de ton avenir.

Jean-Michel Basquiat, Untitled, 1982
Il n’est pas de révolution, intérieure ni politique, sans imaginaire, individuel et collectif : ne se risquent à changer les choses que les hommes et les femmes prêts à devenir des magiciens. AGIR, ILS VIENNENT. Deux formes de métamorphose s’imposent et se complètent alors. Celle de nous-mêmes d’abord, de nos imaginaires colonisés par la puissance de frappe du pouvoir tel qu’il s’exerce sur nos corps et nos âmes, par l’intermédiaire du travail et de la loi. Dans le jeu, dans le sport et dans le voyage, nous quêtons sans cesse de minuscules échappatoires. La mode du développement personnel est le symptôme d’un appétit désespéré pour le dés-abrutissement. Les mondes virtuels nous consolent et nous ligotent. La poésie nous offense un peu, par sa lucidité, puis nous force à nous colleter au monde. Elle dit ce que nous ne savons plus dire autrement, l’effarement et l’émerveillement, les périls de la marchandisation et les extases de la liberté.
Mais cette transformation-là ne peut suffire, car elle est toujours confrontée aux impasses de l’indifférence et de l’égotisme. La curieuse injonction au bonheur de « s’occuper de soi-même » conduit souvent à négliger les autres. Travailler sur soi, comme nous y invitent sans cesse les psychologues, ne sert à rien si c’est pour oublier le monde auquel nous appartenons. La conversion de notre imaginaire personnel doit alors s’accompagner d’une « extroversion aventureuse » qui vient contredire le « repliement maniaque sur soi », pour reprendre ici une formule de Vladimir Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, lequel ajoute : " la sérénité ne se trouve pas dans la conscience confinée, mais dans l’élan de l’intention intransitive » — en un mot, quand tout va mal, sortez de votre vertige narcissique, et plongez dans le monde tête la première."
Même pour les tempéraments sauvages et individualistes, solitaires ou paresseux, « prendre part » est la seule manière de s’inscrire dans ce qui les dépasse. À moins de ne jurer que par l’isolement hautain et l’érudition sèche, seul le rapport à l’autre vient corriger le délire fantasmatique de la toute-puissance autarcique. Rois et reines de nos cauchemars, nous sommes ramenés aux proportions plus congrues mais jubilatoires de la camaraderie par la force de l’amitié, qu’elle soit furtive, amoureuse ou militante : c’est en racontant et en se racontant que l’on s’invente. Tout le reste n’est que farce un peu cynique, non dénuée de charme mais bien dépourvue de tout pouvoir social. On ne crée pas de paradis pour soi seul, on n’habite pas d’île déserte sans espérer secrètement qu’y accostent des pirates généreux ou quelque extra-terrestre plein d’humour. En prison, Monte-Cristo n’est sauvé que par l’abbé Faria, avec lequel il communique avant de devenir l’héritier de son trésor. Tous, nous cherchons des bras dans lesquels nous jeter, la bonté qui répare, la douceur qui restaure.
Or, si nous n’agissons qu’en imaginant, si nous n’imaginons qu’en partageant, il en ressort que seule une éthique de la mémoire, visant à la multiplication des souvenirs doux et communs, permet de cultiver l’empathie. Ce que je désire et que je veux ; que tu veux et que je te donne ; et qu’à ton tour tu me donnes, fabrique à petits pas de nouveaux mondes. Que nous reste-t-il alors à faire, sinon à créer, par l’imagination, des configurations rendant possibles et vivables d’autres futurs ? Cette ascèse de l’imagination est une manière de vivre qui rend à chaque instant sa juste valeur, son propre poids, sa pleine puissance. Ce qui a été n’aurait pas pu ne pas avoir été, mais ce qui sera peut n’avoir pas encore été. L’imaginaire est à la fois politique et poétique. Par la métaphore, l’analogie, la comparaison, les poètes suggèrent des raisons d’être sinon d’agir. La poésie annote le temps, ramasse des étincelles qu’elle condense, entrepose des forces — ainsi de « l’éclair qui dure » cher à René Char ou de la « verticalité » flamboyante des flammes de chandelle chez Gaston Bachelard. À force de concentrer cette force comme un poing qu’on ferme au beau milieu des chantiers et des charniers, la poésie fabrique des textes aussi durs que la pierre, qui deviennent des armes. Fusils de pauvres, dira-t-on, mais de pauvres jubilant peut-être d’avoir repris le contrôle de la seule richesse — leur temps.

Jean-Michel Basquiat, Rice and chicken, 1981
Pas de révolution possible sans imaginaire, c’est-à-dire sans conviction profondément ancrée qu’une aussi petite chose qu’un poème peut changer le monde. Fous et amants l’ont toujours su, mais c’est à tous les autres, à nous tous, qu’il faut désormais le répéter. Par l’imaginaire, qui forge la mémoire et que forge la mémoire, je reprends le pouvoir. Mais qu’en ferai-je ? N’est-ce pas la seule et unique question qui vaille ? Car si ce pouvoir ne consiste qu’à se lever pour prendre un coup de bâton sur la tête et se rasseoir, c’est une bien piètre preuve d’espoir qu’il emporte avec lui, tout aussitôt renfermée dans la boîte à souvenirs des humiliés. Que pourrions-nous donc faire, ici et maintenant, qui agisse dans l’espace-temps des vivants, sur leur propre géographie et leur implacable chronologie ?
« Rien » — sommes-nous parfois tentés de répondre, défaits par notre propre nudité, las de chercher, penchés sur le berceau des neuf vies d’un chat qui nous fixe dans les yeux, nous défiant comme narguent les immortels. « Rien », murmure un vieil homme édenté qui mâche de la coca au fond de la montagne. « Rien », dit la femme aux reins parfaits qui soulève vers le ciel son poids d’enfants et de seaux d’eau. Les puits se vident et se remplissent, les baobabs périssent et les arbres morts au fond de la mer deviennent fossiles. Un jour, la pierre corallienne sert à rebâtir des forteresses pour les canons et des palais pour les conquérants.
Mais non.
Quelque chose en nous qui relève de l’enfance refuse d’abdiquer. Voici que le chien de Diogène nous intime l’ordre de nous souvenir. À quel moment avons-nous renoncé à consacrer notre vie à aimer ? À quelle heure impalpable avons-nous choisi de ne plus tenter de devenir ce que nous nous étions promis d’être ? Quel prix avons-nous payé au réel, quel affreux pragmatisme nous a sommé de lâcher prise, quelle évidente tricherie a transformé le pacte, tu travailleras pour manger, en esclavage, tu mangeras pour travailler? La mémoire est un chien qui ne se couche jamais sur ordre. On la siffle, elle n’obéit pas. On la gronde, elle aboie. On la caresse, elle tend les oreilles. Elle vieillit plus vite que nous, et nous ne la retenons que par la laisse des histoires : « Viens donc là, que je te raconte toutes les premières fois dont je me souviens. » L’heure de sommeiller ne vient qu’avec celle de renoncer à toutes les surprises. Que quelque chose se passe ! n’importe où, n’importe quoi ! — implorons-nous au bord de la tombe. L’ennui refroidit nos os. « Le ralentissement biologique objectif crée une accélération subjective, processus auquel la cadence des horloges physiologiques prend part », raconte Draaisma dans son livre. Il nous semble soudain que le monde a mille ans. Que plus rien ne peut l’ébranler puisque nous sommes las nous-mêmes de nous efforcer. Le cycle de la révolte et de l’amour a des allures de roue démente. Il nous faut d’urgence un orage dans le sablier. Des grains de sable dans la mécanique du désir, des étincelles dans la mer, des rebelles plein les livres, des poèmes plein la rue : des révolutions plein la mémoire.
Dès lors que nous croyons que tout a déjà été tenté, plus rien ne mérite de l’être. Comment nous sauver de cette illusion de l’accomplissement ? Sommes-nous déjà « au bout de notre temps » ? Pas si le temps n’a pas de bout ! Ni flèche ni sens. Il va l’amble comme un vieux cheval pas encore fou. Nous restons sur le bord de la rivière à le regarder passer. Comment rembarquer dans le radeau des vivants ? Comment pagayer dans le sens du vent qui n’est pas toujours celui du courant ? Comment faire en sorte que les mots ravivent le désir, que le désir rallume l’espoir, que l’espoir raffermisse nos résolutions ? Voici peut-être la grande question révolutionnaire de notre époque — ce qui nous provoquera à l’action sera-t-il l’effondrement de tous les repères, en somme, nous ne changerions pas de monde avant d’y être obligés, ou notre capacité à recréer de l’exultation en lieu et place de la résignation ?

Jean-Michel Basquiat, Skull, 1984
Dans la seconde hypothèse, il nous faudra mobiliser l’imaginaire, et donc la mémoire de nos rébellions, comme jamais. Le romantisme révolutionnaire n’a pas forcément à payer le prix de la violence, persuadé à tort que seuls les autres, riches et méchants par définition, le débourseront. Il peut être lucide et déterminé — à ne pas faire couler le sang, mais à changer le monde quand même, sans oublier d’assumer la violence défensive qui n’est jamais qu’une violence imposée par les autres. Celui qu’on veut écraser par principe avant même qu’il ait le temps et le droit de changer le monde, n’aurait-il pas le droit de se défendre et de détourner l’arme pointée sur sa tempe ?
Le romantisme de la révolution est un lyrisme de l’utopie. Il sert à nier la malédiction qu’on lui secoue sans cesse sous le nez : « Toi, toi qui veux agir, souviens-toi des morts, qui sont morts pour rien… et tais-toi ! » Non, car nous nous en souviendrons, des morts, et qu’ils ne sont pas toujours morts pour rien mais pour que d’autres ne meurent pas, ou moins vite, ou moins mal ; et nous nous souviendrons des vivants aussi, et de tout ce qu’il convient de faire pour que rien ne se répète tout à fait de la même manière. Qui a dit que tout changer devait forcément signifier tout abîmer ? Qui refuse de se souvenir des surréalistes : « Transformer le monde, a dit Marx ; Changer la vie, a dit Rimbaud : ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un. » Position politique du surréalisme, 1935, André Breton? Qui a décrété que tout réinventer commencerait par tout détruire ? Bien au contraire, le chant des rêveurs est un hymne de bâtisseur. Les magiciens ne brûlent pas tout ce qu’ils touchent, ils rallument la flamme où elle allait se coucher. Le vent qui passe n’emporte pas tout.
Le souvenir n’est pas un chien comme un autre. Il agit comme un chien de Diogène, celui qui nous rappelle sans cesse à l’ordre de la liberté, refuse les cadeaux des rois et les colliers trop serrés. Sur l’agora, quand Alexandre le Grand rencontre le philosophe et lui dit : « Demande-moi ce que tu veux et tu l’auras », Diogène gêné par l’ombre de l’empereur lui répondit : « Ôte-toi de mon soleil ! » Un chien jappe ici comme un bienheureux dans notre mémoire. Plein d’entrain, il veut que nous nous souvenions de l’insoumission joyeuse et de la lumière grecque. Si notre mémoire est une construction de l’imaginaire, il faut la nourrir d’instants rêvés et réalisés. Toute la tâche de la politique est là, non pas dans l’engloutissement du désir écrasé par le réel, mais dans la transmutation du songe en occasion d’action. Nous n’obtiendrons peut-être jamais tout ce que nous voudrions obtenir, mais il nous appartient de réduire l’écart entre ce que le cœur ordonne et ce qu’il atteint. Poétique et politique avancent ainsi de front dans l’ordre du langage et dans celui des actes. La mémoire des vaincus nous oblige. La morale de l’imaginaire nous engendre. Les livres fomentent des révolutions et les révolutions commencent avec des livres qui se souviennent de ce que nous allions oublier.

Jean-Michel Basquiat, Zing Zulu, 1986
Quid alors, me direz-vous et vous auriez raison, des révoltes illettrées ? Faut-il avoir lu pour sentir battre dans ses veines le tambour de la justice ? Non, bien sûr, mais encore faut-il avoir préservé en soi la faculté de se raconter des histoires, dont on fera peut-être un jour des livres. Chaque vie n’est qu’une longue histoire dont le fil qu’on déroule fabrique les pelotes de l’avenir. Or, il est mille façons possibles d’enrouler comme de dérouler, de jouer avec les balles et de se suspendre aux arbres à chat de la mémoire. Les épopées ne figurent pas qu’entre les lignes des plus forts volumes, elles nous sont aussi contées le soir par des vieillards plus érudits que des bibliothécaires ou par des parents qui réinventent à l’infini les contes de leur propre enfance. Les chansons et les films, les mythes et les tatouages, les rites et les masques montrent à leur manière les choses qu’il ne faut pas oublier — le vrai livre n’est pas toujours où l’on croit et il en est de plus secrets qui se dissimulent dans la matière même des légendes.
Reste que notre capacité d’invention est à la mesure de notre don d’affabulation : la politique sans l’imaginaire ne serait plus qu’une affaire de pouvoir cru et brutal, de loi de la jungle et de survie des plus forts ou des plus rusés. Dès lors qu’il est question de révolte, donc de justice, les mots que l’on invoque fabriquent les histoires que l’on désire répéter à ceux qui les activeront à leur tour pour en faire des armes et des poèmes. Pitié, douceur et tendresse se tissent dans les replis du réel, se méfient du plein soleil et des cris de guerre, se réfugient entre les draps des lits de l’enfance ou de l’amour. C’est au même endroit que naissent les livres et les hommes, les femmes et les mots, qu’ils soient écrits ou transmis oralement, chantés ou gravés, dans l’encre ou dans le sang. C’est au pied de ce lit-là qu’on trouvera souvent couché, pantelant mais joyeux, le chien de Diogène.
php
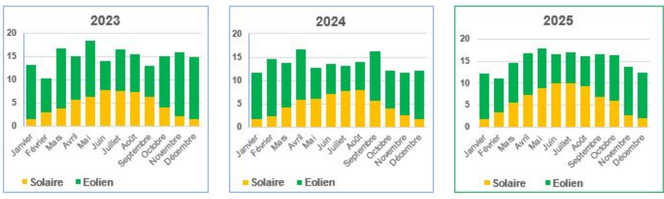
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire