Quelque soit la destination choisie pour émigrer, il
n'est pas inutile de rappeler quelques généralités couramment admises
quant aux raisons qui poussent l'être humain à se déraciner (1).
Une migration humaine est le changement de lieu de vie d'individus. C'est un phénomène aussi ancien que l' humanité.
Les relations privilégiées qu'entretenaient la France avec ses
anciennes colonies ont entrainé des flux migratoires qui sont restés
modérés.
Les migrations sont souvent qualifiés d'économiques ou de politiques.
Quand on a énoncé ces principes, et en tant que Haut-Marnais, le pays
de destination qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est la
Nouvelle France, c'est-à-dire le Canada, l' Acadie et la Louisiane, de
1534 à 1763, avec pour personnage principal la langroise Jeanne Mance [co-fondatrice de Montréal, fondatrice et administratrice de l’Hôtel-Dieu
de Montréal]
. Puis,
au XIXe siècle, le Mexique avec nos voisins chanitois [habitants de
Champlitte, Haute-Saône] partis fonder Jicaltepec, dans la région
de Vera Cruz, et s'implanter à San Rafael, de 1833 à 1862.
Si des Français se sont installés en Cochinchine en 1862-1863, il semble y avoir eu très peu de résidents d'origine haut-marnaise, mis à part quelques religieux. Le principal pays d'émigration qui a concerné nos compatriotes du XIXe siècle, c'est l' Algérie. En 1830, Charles X conquiert Alger, mais l'émigration haut-marnaise ne commence que vers 1845 avant d'être organisée en 1848 pour coloniser la Mitidja (2). C'est de l'émigration choisie et organisée. Elle attirera au moins 12 284 Haut-Marnais. Cette donnée quasi-officielle résulte des secours financiers et des avances effectués par les communes ou les villes aux émigrants à destination de l' Algérie. Sur ces 12 284 personnes aidées financièrement, 5 736, soit plus de 45%, concernent le secteur de Langres, donc le sud haut-Marnais.
Plaine de la Mitidja vue depuis le Mausolée royal de Maurétanie Yelles, CC BY-SA 3.0
À la lecture de ces quelques statistiques, on voit qu'il n'est pas inutile de limiter la portée des généralités énoncées en préambule, ce
qui se vérifie également lors de l' étude des raisons qui poussent nos
compatriotes à partir parce que les migrations peuvent être à la fois
économiques et politiques, comme nous le verrons un peu plus loin.
Concernant les Etats-Unis, ce n'est pas de l' émigration organisée. Dès
lors, il y a très peu de documents aux Archives départementales. Ceci
n'a rien de surprenant puisqu'il est couramment admis que ce sont des
Allemands et des Alsaciens-Lorrains qui sont massivement partis s'y
installer au XIXe siècle. D'autre part, aucun livre sur l' histoire de
la Haute-Marne ne parle de départ groupé vers les Etats-Unis si ce n'est
Jean Carnandet [bibliothécaire de la ville de Chaumont], en 1860, dans
sa Géographie historique de la Haute-Marne (3), qui écrit qu'à Serqueux,
40 personnes ont quitté le pays en 1853 pour aller en Californie, au
moment de la ruée vers l'or.
En étudiant les passeports
conservés aux Archives départementales de Haute-Marne, on s'aperçoit que
quelques-uns sont délivrés à des marchands ou à des notables, pour des
voyages d'affaires ou des voyages d'agrément. Sur les 35 passeports
délivrés en moyenne chaque année, on voit bien que les villages du sud
haut-marnais sont surreprésentés, notamment vers 1830-1835 et vers
1850-1855. Les passeports n'incitent pas à croire qu'il y ait pu avoir
une réelle émigration dans le but de s'établir aux Etats-Unis, et encore
moins une émigration de nécessité.
Essayons donc, à partir
d'extraits biographiques et plus généralement de tranches de vie, de
comprendre les différentes raisons qui poussèrent nos compatriotes à
franchir l' Atlantique.
I - Une immigration de nécessité
Définissons tout d'abord ce que sont une colonie et un colon. À la définition du mot "Colonie" correspondent deux sens :
- Territoire occupé par une nation en dehors de ses propres frontières.
Elle l'administre et le maintient dans un état de dépendance ; en
anglais : colony.
- Ensemble d'individus d'une même nation et
qui vivent à l'étranger dans une même région, une même
ville ; en anglais : community.
Notons que si les Américains emploient des termes différents pour chaque sens du mot colonie, la première
définition ne peut pas être envisagée puisque la France n'a jamais
occupé les Etats-Unis au XIXe siècle (4). Le second sens est non
seulement en adéquation avec le sujet traité, mais il est en parfaite
corrélation avec la définition d'un colon qui est " une personne qui a
quitté son pays pour aller exploiter une terre, faire du commerce, etc.,
dans une colonie", ou un " descendant de ces émigrés installé à demeure
dans ce pays et cohabitant avec les autochtones".
Pour utiliser le terme américain, étudions quelques communautés haut-marnaises et haut-saônoises installées aux Etats-Unis.
Frenchville
Les navires débarquaient généralement leurs passagers à New York. Les
Alsaciens-Lorrains s'établissaient dans cet état, ainsi que dans celui
voisin de Pennsylvanie, c'est donc évidemment dans cette région que nous
y avons trouvé des colons originaires de nos contrées. Margaret Mignot,
une généalogiste américaine, avait effectué tout un travail de
recherches portant sur ses ancêtres possiblement originaires de Paris,
de Picardie, de Lorraine et de l' est de la France. Or, ceux-ci avaient
des noms à consonance haut-marnaise ou franc-comtoise ; d'ailleurs, son
nom de jeune fille était Billotte. Or, c'est en Haute-Saône que le nom
est le plus répandu, variante Billiotte. Plubel, c'est un nom de
Fayl-Billot et de sa région, et Hugny, Lieigey, Picard, Roussey,
Fauconnier, Nodier, Denis, Voinchet, Rougeux, rien que des patronymes
locaux. Nos supputations se vérifièrent rapidement puisque nous
trouvâmes les actes correspondants aux ancêtres de la généalogiste dans
les registres paroissiaux et d'état civil des départements de
Haute-Marne et de Haute-Saône. Des membres de ces familles sont donc
partis en 1834 rejoindre d'autres de leurs compatriotes émigrés dès
1830-1831 qui s'appelaient Roussey, Plubel, Coudriet et Renaud. Tous se
sont installés à Frenchville en Pennsylvanie. Frenchville, un écart de
la commune de Covington dans le comté de Clearfield, à peu près au
centre de l' état de Pennsylvanie qui se trouve dans l'est américain,
juste en dessous de New York.

Un
aperçu de l'ancienne Frenchville où je suis né se trouve dans un court
article intitulé "American Gallic - The Mystery of Frenchville" qui a
paru en 1974 dans le Today Magazine du Philadelphia Inquirer. La
Frenchville d'aujourd'hui est assez différente. Voir :
http://engr.case.edu/merat_francis/flm/Frenchville/Frenchville_Today.pdf
Une vue de Frenchville aujourd'hui, 2015. Georgie lennon8705 CC BY-SA 4.0
Vers 1830, dans la région où allaient s'implanter les premiers colons,
c'est-à-dire le comté de Clearfield, il y avait 4 800 habitants sur une
surface d'environ 3 000km2. Si on rapproche ceci avec la Haute-Marne qui
a 6 200km2, cela ferait 9 900 habitants. Le plus gros contingent de
colons est arrivé en 1834. Il y avait plus d'une centaine de personnes
dont le plus âgé avait 82 ans. Tous venaient du sud haut-marnais et du
nord de la Haute-Saône. Ils ont tous été regroupés à Frenchville, appelé
ainsi parce qu'ils étaient tous français.
Pourquoi
partaient-ils? En 1832, les enfants étaient nombreux et nos campagnes
étaient surpeuplées. Un courant d'émigration entrainait vers l' Amérique
le surcroît de population. Ces colons avaient acheté des terres à un
financier américain qui leur donnait ainsi la possibilité de vivre comme
ils l'avaient toujours fait dans le pays de leurs ancêtres. Un parent
resté en Haute-Marne écrit (5) :
"les débuts furent excessivement
pénibles. Tout leur manquait, jusqu'aux vivres qu'il fallait se
procurer au loin. Ont eu faim bien des fois lorsque les rivières
débordées interceptaient les communications."
Petit à petit, les pionniers achetèrent du bétail et construisirent des fermes qui devinrent rapidement prospères.
"Les pépins, les noyaux et les greffes, emportés ou envoyés de France, devinrent bientôt des arbres de plein rapport."
Mais le territoire n'était pas favorable à la culture de la vigne dont
le rendement était faible, contrairement au sud haut-marnais, cantons de
Laferté, Varennes, Fayl-Billot, ou nord saônois, Amance,
Vitrey-sur-Mance...,.
Margaret Mignot, qui avait parfois mal
interprété les lieux d'origine de ses ancêtres, se heurtait à une
deuxième difficulté : l'américanisation des patronymes outre-atlantique.
- Billiotte est devenu Billott
- Bronoël est transformé en Brunwell
- Coudriet/Condret
- Denis/Dennis
- Gormont/Gormount
- Grossaint/Grossein, Grosurt
- Lecomte/Lecont
- Plubel/Plubell
- Rousselot/Russlow
- Viard/Veard
- Liegey/Leiga ou Leigey
- Rollée/Rolley ou Rollet, Roliet, Roby
- Hugueney/Hugini, Hugnot, Hugury
- Fauconnier/Vallimont
La
lecture de ces noms n'apporte aucun commentaire particulier, si ce
n'est le dernier. Fauconnier devient Vallimont. L'américanisation
logique aurait dû être Falconer. Les descendants actuels avancent deux
versions, relativement peu crédibles. La première proviendrait du fait
que quelques locaux auraient, en raison de la prononciation, vulgarisé
le nom de Fauconnier en "Fucking ay" à son arrivée à Frenchville. Ce qui
une fois traduit relève plus de l'insulte que d'un patronyme facile à
porter. La seconde hypothèse remonterait à une époque au cours de
laquelle un membre de la famille Fauconnier aurait travaillé pour le roi
de France. Il aurait formé des faucons à la chasse. Ainsi lui serait
venu son patronyme Fauconnier. Au moment de la Révolution française, son
nom aurait alors été changé pour éviter toute analogie avec le roi
auquel on venait de couper la tête. C'est d'autant moins vraisemblable
que les Fauconnier étaient implantés dans le sud de la Haute-Marne
depuis plusieurs générations et qu'ils faisaient partie des basses
classes de la société. De plus, le nom de Vallimont est apparu pour la
première fois au départ du Havre puisque Fauconnier figure sous ce
patronyme sur la liste des passagers du bateau Attica. Ce nom est-il un
pseudonyme, et Fauconnier avait-il quelque chose à cacher? Le mystère
demeure.
Le premier colon qui décède à Frenchville est Irénée
Plubell, en 1833, à l'âge de 55 ans. Comme il n'y avait pas d'église, la
messe d' enterrement fut dite dans sa maison, selon le rituel du
diocèse de Langres, car les pionniers avaient emporté dans leurs bagages
quelques ouvrages religieux. Quant au cimetière, il fut créé sur une
parcelle de terre, de deux acres, donnée à la collectivité par un colon
nommé François Lamotte. En 1840, une église en bois rond fut construite
non loin du cimetière. Elle fut frappée par la foudre en 1863. Un lieu
de culte en pierre fut alors bâti par les habitants du lieu en 1870 et
consacré trois ans plus tard.
Cimetières à Frenchville, Clearfield County, Pennsylvania, USA
- Gillingham cemetery
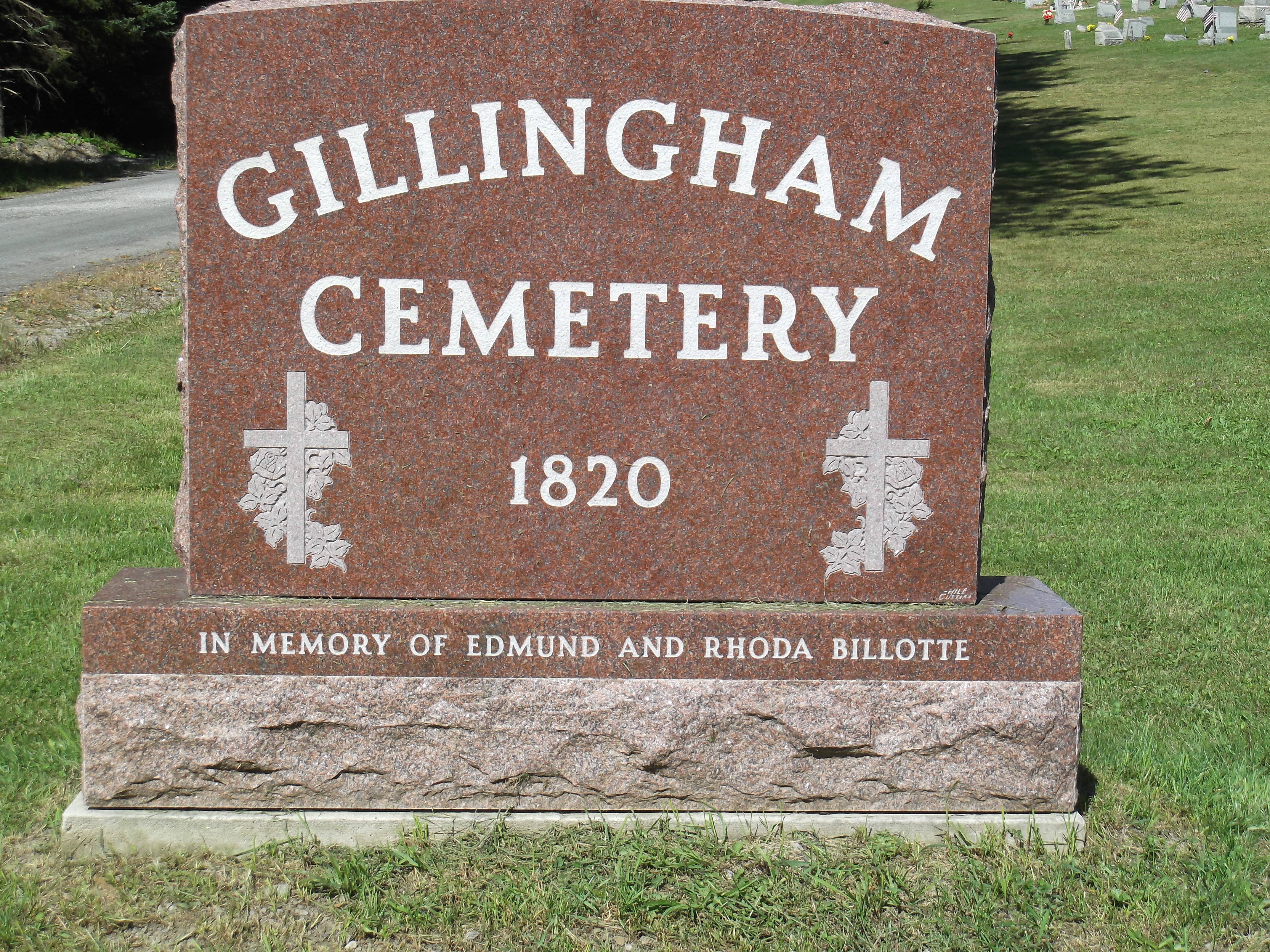
Photo : Jamie Price
- Saint Mary of the Assumption Cemetery ; également appelé Frenchville
Cemetery. "Il est situé sur le côté nord de la route de Frenchville
(route de canton 638) à environ 0,1 miles à l'ouest de son intersection
avec Dales Drive. "

Ici, vous trouverez la liste des noms des personnes enterrées. Sa réalisation a été achevée au cours de l'été 1978. Elle est conservée par la Clearfield
Historical Society. L'auteur ou les auteurs en sont inconnus. Avec l'aimable autorisation de Sue et
Tom Moore.
Photo : Eillen
St. Mary of the Assumption Parish
64 St. Mary's Lane , Frenchville , PA 16836 
Il permettait d'accueillir près de 200 personnes. Quand l'église fut
achevée, une fête paroissiale fut organisée sous la forme d'un
pique-nique rassemblant toute la communauté "frenchvilloise". Les années
passant, les habitants ont continué à se réunir, et à collecter des
fonds. Ceci leur a permis d'obtenir assez d' argent pour construire le
clocher de l' église en 1890. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'
aujourd'hui encore, le Picnic a toujours lieu chaque troisième week-end
de juillet.

Chaque troisième week-end
de juillet, le Picnic annuel de Frenchville
À suivre...
Didier Desnouveaux, Émigrés bassignots et comtois aux Etats-Unis de 1830 à 1870, les Cahiers haut-marnais, n° 293, 2019/02, pp. 15-20.
1. Cette communication, prononcée lors du colloque "Étrangers en Haute-Marne, Haut-Marnais à l'étranger" organisé par les Cahiers haut-marnais le 9 décembre 2012, emprunte de larges extraits à l'ouvrage Keskidees, émigrés bassignots et comtois aux Etats-Unis, 1830-1870, co-écrit par Didier Desnouveaux et Lionel Fontaine et publié par le Club Mémoires 52 en 2011.
2. Arrière-pays d' Alger.
3. P. 456.
4. À l'exception de la Louisiane, et seulement jusqu'en1803. Même dans la Louisiane du XVIIIe siècle, qui représentait un tiers des Etats-Unis actuels, le nombre de colons français, et volontaires, est resté très limité.
5. A. Mulson, Histoire de Pierrefaite, avec Ouge, ancienne succursale, Montesson, annexe, Langres, Rallet-Bideaud, 1898.
php




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire