Jean-François Bouthors
06/07/2016
La Villa Méditerranée accueille cet été à Marseille, à deux pas du Mucem, à côté du Fort Saint-Jean, l’une des expositions des Rencontres de la photographie d’Arles qui ont choisi, cette année, d’étendre leurs manifestations dans plusieurs villes du « Grand Sud ». Elle présente le travail commencé il y a dix ans par l’Autrichien Alfred Seiland, à qui le New York Time Magazine avait confié la mission d’étudier les vestiges de l’Empire romain encore visibles au xixe siècle. Depuis lors, Seiland n’a cessé d’arpenter le territoire que Rome unifiait en Europe et dans le pourtour méditerranéen. Il est même allé jusqu’à Las Vegas pour recueillir les traces imaginaires de l’Imperium romanum qui contrôlait alors une grande partie du monde connu et dessinait un espace euroméditerranéen aujourd’hui si troublé. L’Empire s’est défait sous les coups des « barbares », c’est-à-dire des étrangers venus de l’autre côté du limes dont l’énergie conquérante était plus forte que la Rome fatiguée d’elle-même et de ses querelles. Il s’est défait, mais par bien des aspects, sa présence n’a pas disparu, tant s’en faut. Elle est historique, culturelle, architecturale, mentale… Elle fait plus qu’affleurer, puisqu’à bien des égards, elle forme une partie du décor dans lequel nous nous mouvons, elle participe encore pour une part qui n’est pas infinitésimale, à la structuration l’espace qu’avaient quadrillé ses viae romanae.C’est ce que montrent les cent photographies en couleurs, de grands formats, qui ont trouvé place dans la partie haute du grand porte-à-faux que constitue le bâtiment inauguré en 2013 – superbe geste architectural de l’Italien Stefano Boeri, qui l’a voulu comme une « porte d’entrée » sur la mer.
Le visiteur est évidemment frappé d’emblée par la puissance des images, la force des couleurs, la construction des lignes, mais ce qui finalement le requiert, c’est l’espèce d’étrangeté qui s’impose de photographie en photographie. Alfred Seiland cultive sur des registres variables – l’humour, l’anecdote, la nostalgie – le décalage entre le présent et le passé, non pas comme deux temps séparés, mais associés l’un dans l’autre – comme deux cordes d’un instrument qui vibreraient ensemble pour faire sonner leur écart.
Nombre des endroits photographiés par Alfred Seiland, au sud de la Méditerranée ne sont plus accessibles dans des conditions raisonnables de sécurité, et c’est une des premières remarques qui s’imposent. Dans cet espace qui fut jadis celui de la Pax Romana, qui connaissait encore, il y a quelques années, sous des régimes qui pour beaucoup n’avaient rien de démocratique, une forme de tranquillité qui permettait au voyageur de circuler sans grand risque, l’insécurité, la violence, la terreur règnent désormais. Comme s’est effondré l’Imperium romanum, l’ordre qui prévalait en gros depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a été brisé. Pourtant, les ruines que le photographe cadre dans son viseur font plus que nous renvoyer à l’assertion de Paul Valéry : « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles ». Elles témoignent d’une permanence à la fois physique et spirituelle de ce que nous rangerions facilement, avec le poète, dans la catégorie des mondes disparus. C’est peut-être d’ailleurs pour cela que les islamistes furieux de Daech s’emploient à non seulement massacrer les vivants qui ne se plient pas à leur interprétation de la « loi de Dieu », mais aussi à saccager les vestiges qui témoignent d’un autre rapport au monde, aux autres et à la transcendance, capable de résister à leur violence aussi bien qu’à leurs discours enflammés.
Seiland présente plusieurs photographies de Palmyre. L’une montre trois visiteurs devant une arche de la rue à colonnades. La majesté somptueuse de la porte, l’arrière-plan immobile de la montagne, la petitesse des personnages installent une présence puissante et imposent un silence contemplatif. Le passé affirme son existence, prenant à contre-pied la célèbre méditation d’Augustin dans ses Confessions. Impossible de dire qu’il n’est plus : il est bien là et informe le présent, au sens où il lui donne de l’intérieur, du dedans, une forme… Une autre a saisi comme autant de fantômes, sept colonnes prises dans une tempête de sable. Et c’est ici, l’effacement inexorable qui se fait sentir, avec cette légende qui apprend au visiteur que si de pareilles tempêtes qui usent terriblement les pierres se font désormais plus fréquentes, c’est en raison d’un trafic routier croissant… Le présent ronge la présence du passé, peut-être plus sûrement, et certainement plus imperceptiblement que les fureurs politiques…
L’aqueduc de Carthage, bordée par une autoroute dont le photographe a fixé, par un long temps de pause, le trafic au déclin du jour, avec ce pylône d’acier, qui porte une ligne électrique emmène le regard vers un point de fuite presque métaphysique, tandis que la plage de Gai, sur le bord du lac de Tibériade, auquel se réfèrent si souvent les évangiles, prend l’allure d’une peinture de David Hockney, l’artificialité absorbant tout d’un coup ce qui semblerait plutôt devoir évoquer l’éternité. C’est cette fois-ci le présent qui prend figure d’irréalité.

Le Péloponnèse est rattaché au continent par l’isthme de Corinthe, large de seulement 6 km dans sa partie la plus étroite. Afin d’épargner à ses navires le trajet long de 400 km jusqu’au cap Malée, un voyage onéreux et dangereux, l’empereur romain Néron a entamé une percée de la langue de terre. Son décès en 68 après J.-C. met un terme à cette ambitieuse entreprise. Ce n’est qu’en 1893, sous la responsabilité des ingénieurs hongrois István Türr et Béla Gerstner, qu’il est entrepris de créer une liaison maritime entre le golfe Saronique et le golfe de Corinthe. Les parois du canal de Corinthe s’élancent à une hauteur de près de 80 mètres, à un angle compris entre 71 et 77°, la largeur du lit du canal est d’environ 24,6 mètres au niveau de la mer. Cette traversée – véritable progrès notamment pour les plus petits navires – est aussi une aventure à part entière. Au vu de son importance économique, le canal de Corinthe, qui avait subi de nombreux dommages dus à l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale, a été restauré et remis en service dès 1948. Bien que ses dimensions ne permettent le passage qu’aux navires de taille réduite et que le contournement du Péloponnèse ne soit plus ni trop long ni dangereux pour les bateaux à moteur, le canal est encore aujourd’hui utilisé par environ 11 000 ferrys et bateaux de plaisance. Il attire de plus les adeptes du saut à l’élastique. Depuis l’un des cinq ponts, on peut faire un saut de 40 mètres environ dans le canyon – de quoi procurer un frisson unique.
À Rimini, les cohortes de transatlantiques et de parasols, alignés au cordeau sur les plages désertées par les vacanciers la nuit évoquent immanquablement l’ordre mécanique des troupes de César installées à Ariminum après avoir franchi le Rubicon, avant de marcher sur Rome, mais à Capri, c’est plutôt la colonisation touristique qui ravale à la modestie, pour ne pas dire à l’anonymat, les vestiges des fastes de Tibère.
L’ancienne Ariminum, sur la côte Adriatique, avait une grande importance stratégique puisqu’elle était le passage-clé vers la Gaule cisalpine ainsi que la fin de la Via Flaminia. César choisit Ariminum comme point de départ quand, contre tous règlements statutaires, il décida de franchir le Rubicon avec son armée durant l’hiver 49 après J.-C. – marquant ainsi le début de la guerre civile. Sous Auguste, la ville fut reconstruite avec un système de rues orthogonal et une grande partie de ce réseau rectiligne existe encore sous les routes modernes. Dans les années 1960, la plage de 15 km de long sur l’Adriatique était connue sous le nom du « Grill teutonique » ; plus tard il fut connu comme la baignoire des touristes russes allant de bar en bar. Aujourd’hui, en juillet et en août, un million d’étrangers rejoignent les 150 000 résidents permanents du lieu de naissance de Federico Fellini. Cependant, pour des raisons de sécurité, il est interdit d’aller sur la plage pendant la nuit.
Ainsi, au fil de la succession d’images dont les contrastes ne sont pas simplement graphiques, et dont les légendes étoffées nourrissent intelligemment la lecture, Alfred Seiland donne un singulier relief à cette permanence de l’imperium. Il opère, au sens même de la technique photographique, une révélation d’une image qui nous resterait cachée s’il n’avait pris le temps d’arpenter ces paysages. Mieux encore, il s’est intéressé au besoin que nous avons eu de les recomposer, de les reproduire, de les maquetter, de les conserver, de les « emballer », de les réinventer comme des formes dont notre esprit, dont notre mémoire, dont nos regards avaient besoin. En ce sens, son travail est le signe que l’archéologie n’est pas simplement la description des strates historiques qui se sont empilées au fil du temps, comme un savoir objectif et extérieur, mais la traduction d’une construction complexe qui nous habite et dont les vestiges nous avertissent.
Alfred Seiland : « Imperium Romanum ». Grand Arles Express. Exposition à la Villa Méditerranée, esplanade du J4, 13002 Marseille. Du mardi au dimanche (10 h-18 h), jusqu’au 18 septembre (www.villa-mediterranee.org)
php

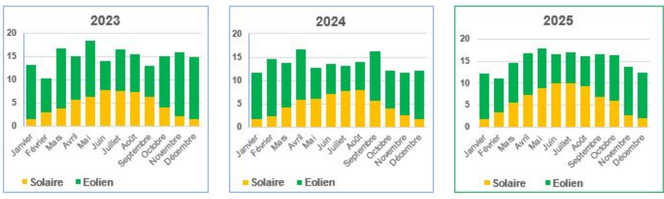
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire