Portrait de Philippe Pelletier : Cyrille Choupas, pour Ballast

Entretien inédit pour le cienite de Ballast
« Géographie et anarchisme sont historiquement reliés par une histoire peu connue mais essentielle », avance ainsi Philippe Pelletier, auteur de vingt livres et membre de la Fédération anarchiste. Nous retrouvons le géographe dans un café de la capitale. Cheveux blanchis par une petite soixantaine d’années et blouson en cuir noir. L’homme, familier du Japon et lecteur attentif du communard Élisée Reclus, cultive quelque méfiance à l’endroit des décroissants, des technocritiques et des militants antispécistes ; notre rédaction héberge plusieurs d’entre eux trois : l’occasion d’en discuter.

Pourrait-on dire que la géographie est une discipline anarchiste ?
Si je me considère comme géographe libertaire, ou géographe anarchiste, je conteste en revanche l’idée d’une géographie libertaire en tant que discipline. C’est un objet de discussion entre nous au sein du Réseau des géographes libertaires. La finalité et l’usage qu’on fait de cette géographie est libertaire — elle essaie de l’être, en tout cas. Mais comme la plupart des savoirs, d’un point de vue épistémologique et méthodologique, elle a un fond disciplinaire utilisable par tous. Imagine-t-on une chimie marxiste ? Cela n’aurait pas de sens. Ceux qui ont essayé la génétique marxiste, Lyssenko et compagnie, se sont plantés. Ce qui veut dire qu’il y existe aussi le risque de sur-idéologiser le savoir. C’est une vraie question, pas facile, car on sait bien qu’il y a de l’idéologie partout… Par exemple la question de l’objectivité/subjectivité — qui est une vieille tarte à la crème : je préfère parler d’honnêteté/malhonnêteté. On peut affirmer des convictions, un cadre ou un héritage sans toutefois être dans la fermeture automatique. Penser librement, c’est cela. Si on revient à la géographie faite par les géographes libertaires, cela veut dire qu’il peut parfaitement y avoir des choses qui nous déplaisent, sur un plan historico-politique, mais il nous faut malgré tout en parler.
Vous avez des activités d’écriture qui s’apparentent à de la vulgarisation politique : est-ce que vous liez celles-ci à votre activité de chercheur ?
Ce n’est pas facile ; c’est une alchimie. Tout dépend des personnes et donc de leurs caractères et tempéraments, mais aussi, sur un autre plan, des situations institutionnelles, de l’époque et des pays… Ici, on ne fait pas la même chose qu’au Japon, par exemple. Aucune recette n’étant établie, il y a une forme de bricolage, un bricolage de plus en plus revendiqué dans certaines disciplines : en sociologie, en anthropologie, mais aussi en géographie. En ce qui me concerne, je suis engagé depuis très longtemps dans le mouvement libertaire, mais je suis aussi connu pour travailler sur le Japon. Comme géographe, lorsqu’on travaille sur un pays comme ce dernier, on s’intéresse à différents aspects qui ne sont pas forcément politiques ni militants, bien que cela implique de s’intéresser à des problématiques très politiques : les risques, le rapport à la nature, le nucléaire, le rapport à l’histoire… Un certain nombre de personnes ont été surprises de me voir m’intéresser à Reclus et à l’anarchisme. Je pense qu’elles m’ont mal lu ! (rires)
Ils ne s’y attendaient pas en lisant vos travaux géographiques…
Voilà ! Effectivement, il n’y avait pas le drapeau noir sur toutes les pages ! (rires) En revanche, on y trouvait une sensibilité, un certain regard… Mais aller plus loin en brandissant une étiquette, c’est s’enfermer plus qu’autre chose ; l’objectif, c’est l’émancipation, donc une forme de libération. Mon intérêt pour Élisée Reclus s’est développé dans un contexte de sortie du marxisme, de crise des grands récits, de nouvelles problématiques liées à l’écologie et un ensemble d’impasses tant sur le plan intellectuel que politique — je l’ai fait de manière délibérée. Un nouveau champ s’ouvrait pour les géographes libertaires, qui pouvaient reprendre cet héritage pour devenir passeurs. C’est marrant : dans l’académie, il faut rendre des rapports sans arrêt, surtout pour la recherche ; parfois, je mentionne mes contributions sur la géographie des anarchistes, parfois pas. Je m’en fous. Il y a des collègues qui me disent « Tu as sorti ça, tu devrais le mettre ! ». Prêcher dans le désert ne m’intéresse pas. C’est également une volonté de créer les conditions d’une écoute. L’autre difficulté est que j’ai des positions assez fermes sur un certain nombre de points qui soulèvent la discussion, parfois le rejet.
Est-ce qu’être un chercheur engagé mais surtout explicitement anarchiste peut créer des difficultés dans le monde académique ?
Personnellement, non. Je ne l’ai jamais caché, mais ne l’ai jamais brandi. Surtout, je pense que j’ai été extrêmement sérieux et rigoureux dans mon travail sur le Japon, qui m’a fait reconnaître. L’exigence personnelle de sérieux donne une légitimité. C’est ce qui importe, surtout qu’on accole toujours à la figure de l’anarchiste les qualificatifs « violent », « chaotique », pour le rendre illégitime à porter un projet humain et social émancipateur. C’est quelque chose qu’il faut combattre — pour ça, il faut s’en donner les moyens. L’engagement ne suffit pas. Il est difficile d’être à la fois honnête intellectuellement et avec soi-même. La psychologie a montré que l’engagement, aussi sincère et désintéressé qu’il soit, charrie des ressorts plus complexes — notamment ce que la psychologie appelle des « bénéfices secondaires ». Contrairement à ma génération de soixante-huitards, l’actuelle a moins d’états d’âme sur le fait de savoir si c’est vraiment de l’engagement, ou non…
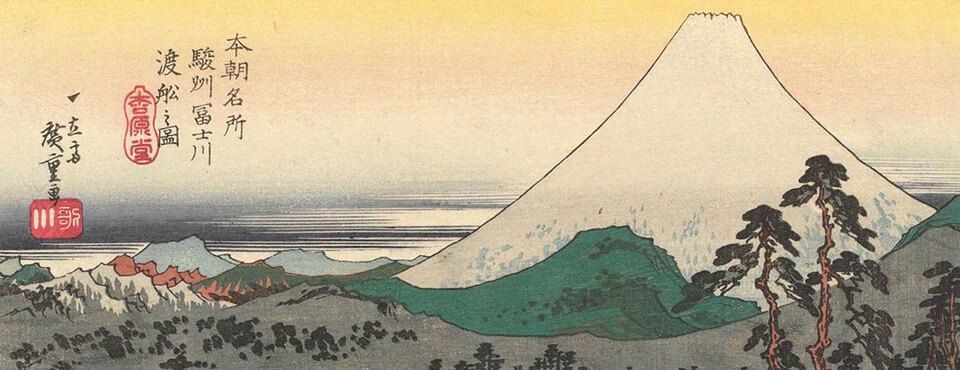
Extrait d’une estampe d’Utagawa Hiroshige
Reclus est parfois cité comme précurseur de l’écologie politique, comme un écologiste avant l’heure1. Qu’en pensez-vous ?
Il y a une difficulté, celle de l’identification de précurseurs. En sociologie comme en philosophie, ça a été travaillé : c’est une notion extrêmement glissante, risquée. Définir des précurseurs est une forme de téléologie de la pensée : tout ce qui en relève est extrêmement problématique, pour ne pas dire dangereux. Le mouvement social se condamne alors dans l’ici et maintenant, puisqu’il y aurait logiquement une préfiguration d’un futur quelque part. Or ce n’est pas vrai ; tout est à construire. C’est toujours difficile de revenir en arrière, de savoir quelles personnes seraient de potentiels précurseurs ou pas. On peut le faire, mais il y a un risque. En plus, il est encouru à mauvais escient dans le cas de Reclus. J’ai travaillé là-dessus, notamment lorsque John Clarke a sorti un livre sur Reclus : il m’est tombé des mains tant il sort des énormités. Il y a des choses qu’il ne comprend pas. Ce qu’est le socialisme, notamment le socialisme en France au milieu du XIXe siècle. Il décontextualise, il projette la société du XXe siècle sur ce qu’on pouvait penser à l’époque de Reclus. Ce n’est pas pertinent. Comme Reclus a travaillé sur les questions non pas d’environnement mais de milieu, de nature, et sur ce qu’on n’appelait pas encore des pollutions mais des dégâts de la déforestation, on pourrait se dire assez facilement, par paresse intellectuelle voire par récupération politique consciente ou inconsciente, que « c’est un écologiste », un « pré-écologiste » ou un « proto-écologiste ». Sauf que Reclus est de la même génération qu’Ernst Haeckel, le fondateur de l’écologie. Reclus l’a lu, le connaît bien, et n’adopte pas l’écologie de Haeckel. Il adopte en revanche la mésologie — la science des milieux — et la géographie sociale. Au moment où la géographie vidalienne parle de géographie humaine, il décide de parler de géographie sociale — alors que tous les naturalistes basculent vers l’écologie de type biologique d’ Haeckel, Reclus n’utilise pas ce terme et le critique. On est obligé de tenir compte de ces choix. La question est donc : l’écologie de Haeckel a-t-elle à voir avec l’écologisme contemporain ? Ma réponse est oui, et je compte le démontrer à nouveau. Sauf que cette relation est compliquée et n’est pas linéaire. Sur ces questions environnementales — les ressources, le climat, les pollutions, etc. —, qui sont à mon avis les grandes questions du XXIe siècle autant qu’un enjeu pour le capitalisme, il y a fatalement un lestage idéologique extrêmement fort. Tout est possible dans les interprétations, les relectures de l’Histoire et les oublis. Ce qui est assez affolant, en particulier chez les militants qui s’intéressent à ces questions, c’est qu’ils ne connaissent pas vraiment l’écologie urbaine — abusivement nommée, en fait, parce que c’est de l’écologie humaine — ni l’école de Chicago… Est-ce que ça a un rapport ou pas ? La réponse est encore oui ! L’écologie factorielle2, des années 1960, est-ce que ça a un rapport ? C’est oui à nouveau. Pourquoi Jouvenel parle d’écologie politique dans les années 1950 ? Est-ce que ça a un rapport avec l’écologie biologique ? C’est oui, à nouveau.
Dans L’Imposture écologiste ou Climat et capitalisme vert, vous vous en prenez à l’usage de la peur et du catastrophisme, l’instrumentalisation de la science et la complaisance avec le capitalisme…
Le plus important en la matière, c’est que ceux qui s’engagent sur ces thématiques prennent conscience de ce dont ils parlent : il est évident qu’il faut se battre pour un meilleur cadre de vie, mais comment le définit-on ? Que faut-il mettre en avant ? Des critères biologiques de type « biodiversité » ou, au contraire, des problématiques de type « esthétique » (le paysage, etc.) ? Est-ce qu’il ne faut pas remettre en avant la question des pollutions, celle des sols et de l’atmosphère, dont on parle moins ? Derrière la question du climat, il y a l’enjeu extrêmement fort du nucléaire — ce que je pense avoir montré dans Climat et capitalisme vert. Dans les années 1970, quand j’ai commencé mes études de géographie, j’étais assez proche du Parti socialiste unifié, dans lequel il y avait déjà une sensibilité écologiste. Les Amis de la Terre s’étaient montés, il y avait le combat anti-nucléaire de Creys-Malville et le mouvement de la non-violence… J’ai vu beaucoup de copains être attirés par le mouvement écologiste (mais avec une forme de naïveté, y compris sur le plan tactique), c’est-à-dire par le choix électoraliste, en disant des choses qu’on a déjà entendues dans le cadre du mouvement socialiste au XIXe siècle : « Nous, on n’est pas comme les autres. » Je caricature un peu, mais c’était : « On est animés de bonnes intentions », « On se fera pas manger par l’appareil d’État »…
Il y a peu de bouquins, et de bouquins militants, sur un bilan des Grünen en Allemagne — c’est pourtant la meilleure étude de cas. Tout est parti du mouvement « réalo », les réalistes, qui disaient, contre les « fundi », le courant écologiste fondamentaliste : « On veut construire un parti anti-partis et on est pour la rotation des mandats. » En tant que jeune militant libertaire, je me disais : c’est d’une naïveté abyssale, ça ne marchera pas. Et ça n’a pas marché. On les a tous eus, y compris Cohn-Bendit ! Au bout d’un moment, ils te disent « Je maîtrise les dossiers, ça fait deux ans que je suis dessus, je ne peux pas passer la main, on va perdre en efficacité… Je reste à ma place, mais ne vous inquiétez pas, je ne prendrai pas le pouvoir ». Après, il y a une spirale : on participe à nouveau aux élections, on fait des listes, et on sait très bien que pour être élu, il faut édulcorer le programme. Les gens le savent de plus en plus : il suffit de voir le taux d’abstention. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas participer aux élections — ce n’est pas tout à fait ce que je dis —, mais l’histoire des Grünen a parfaitement montré le résultat. Le mouvement écologiste dans les années 1970, c’était l’anti-nucléaire et le pacifisme : qu’est-il devenu ? À partir du moment où Joschka Fischer, ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne réunifiée, a dit oui aux bombardements par l’Otan de Belgrade, c’en était fini du pacifisme écolo. Aujourd’hui, l’armée française peut aussi se déployer partout, défendre Areva… Où est le pacifisme ? Il a disparu. Quand ils se sont retrouvés haut placés dans l’appareil d’État, les Grünen en ont suivi la logique. Je n’ai pas trouvé de travaux en français qui racontent cela clairement, qui montrent d’où ils sont partis et où ils sont arrivés. Pourtant c’est extrêmement instructif.

Extrait d’une estampe d’ Utagawa Hiroshige
Vous parlez là de l’écologie de gouvernement, mais bien des militants écologistes défendent des formes de radicalité en rupture : la décroissance, les initiatives locales, l’en-dehors !
Qu’est-ce qu’on veut ? Quelle est la finalité ? Je ne suis pas primitiviste ; je me méfie toujours des groupes qui sont viscéralement opposés à une forme du monde moderne, et en particulier à la technique, à la technologie. Lors du salon du livre à Saint-Étienne qui s’est déroulé il y a un an et demi — bardé d’appareils dernier cris et d’une assistance le portable à la main —, il y a eu des prises de parole, à la tribune de la table ronde, sur le registre « La technologie nous opprime ». C’est un langage de curé : « Faites ce que je dis, pas ce que je fais. » Fonder un combat social là-dessus, c’est le faire sur une hypocrisie et une contradiction majeure. Bien sûr que la technologie pose problème. Mais quelle société veut-on ? Prenons la décroissance : de quoi parle-t-on ? Certains pays, par exemple, ont besoin d’adduction d’eau, de tout-à-l’égout, d’assainissement, peut-être de faire croître la production. On me rétorquera « Oui, mais ce n’est pas la même croissance ». On rentre dans la confusion…
Un fab lab [de l’anglais « laboratoire de fabrication », ndlr] grenoblois a été incendié il y a quelques mois : l’incendie a été revendiqué comme un acte antitechnique via un site Internet. Des textes de la part de groupes anarchistes ont, par la suite, condamné l’opération. Comment l’entendez-vous ?
Il faut se demander à quoi correspond ce type de mouvement. Est-ce que ce sont des formes de réaction pure ? Souhaite-t-on un retour, mais un retour vers quoi ? Vers l’idée un peu arcadienne d’un âge d’or qui aurait été perdu ? Ce sont des postures qu’on peut aussi observer parfois dans le mouvement anarchiste. Prenons François Jarrige, historien et auteur d’un livre sur les milieux naturiens un peu anarchistes de la fin du XIXe siècle : son introduction est assez significative puisqu’il y compare le mouvement naturien de la France de la fin du XIXe et du début du XXe avec la décroissance actuelle. Très vite, on ne peut qu’acter l’échec du mouvement naturien, qui s’est borné à des communautés avec leurs rites culinaires et leurs modes de socialisation particuliers. Aujourd’hui, si des gens ont envie de faire une communauté, de manger certaines choses et pas d’autres, de méditer, ce n’est pas un problème : je suis pour la liberté. Mais quel est le sens de ces pratiques en tant que projet social ? Est-ce que ma voisine de pallier est intéressée par ça ? Je ne sais pas.
Il se trouve que ce sont notamment dans ces mouvements naturiens du XIXe qu’on aperçoit l’apparition des premières communautés végétariennes, voire végétaliennes. Vous avez coordonné deux ouvrages sur la cause animale et l’anarchisme : étrangement, ils ne louent pas le véganisme ni l’antispécisme !
Je distinguerais l’antispécisme du véganisme. On va en rester au véganisme. Comme beaucoup de causes, il y a de vraies problématiques, de vraies préoccupations : tout ce qui relève de l’élevage industriel ou des méthodes d’abattage constitue un abaissement de la dignité humaine. Ce sont des méthodes barbares. Après, il y a la question de la consommation de la viande — et entre les deux, la question de tuer. Je respecte ceux qui ont fait un choix de vie et qui s’y conforment, même si ce n’est pas forcément facile. Je ne suis pas puriste, je trouve même ça relativement cohérent. Je ne suis pas un carnivore, je ne mange pas non plus végétarien. Comme j’ai vécu longtemps au Japon, le poisson était incontournable. J’ai parlé dans deux de ces livres du « Tu ne tueras point ». C’est une vraie question philosophique qui ramène à des thématiques religieuses et politiques : ce « Tu ne tueras point » signifie que, dans un processus révolutionnaire, on est forcément pour la non-violence — ce qui n’est pas simple… Je ne suis pas sûr que le mouvement végane se place dans cette interrogation-là en cas de situation révolutionnaire : est-ce qu’on tue ou est-ce qu’on ne tue pas ? Ce n’est pas leur problème. Mais pour moi ça l’est. Reclus est effectivement le plus proche de ces thématiques-là ; il est allé assez loin, y compris dans sa réflexion sur l’animal. Son texte sur le végétarisme est très clair : il dit qu’il ne s’agit pas d’ériger ce choix en doctrine, en dogme à imposer aux autres. On est dans une démarche libertaire de respect des choix individuels des uns et des autres. Si je respecte le végétarien, le végétarien respecte le carnivore. L’autre question est celle du mode de production. Pour moi, l’idée que le changement va venir d’une addition de changements individuels est une idée libérale, pour ne pas dire néolibérale. Il est vrai que, contrairement à ce qu’on peut raconter, l’anarchisme — Rudolf Rocker le dit très bien — est un mélange de socialisme et de libéralisme. Spencer, libéral britannique et évolutionniste, pense que la société mature va arriver à une société sans État. On peut le critiquer sur tout un tas d’autres points — je ne suis pas spencerien du tout —, mais l’idée qu’une addition de micro-révolutions individuelles va mener à la révolution, c’est du libéralisme. Je défends un socialisme libertaire : c’est le mouvement collectif, social, qui fait la force et amène le changement.

Extrait d’une estampe d’ Utagawa Hiroshige
L’éthique peut paraître individuelle, mais si on considère dans cette perspective que tous les choix ne se valent pas, cela complique les choses : comment articuler éthique et socialisme ?
Ici, le fondement le plus important va au-delà de la simple tolérance ; c’est le respect d’autrui qui nous pousse à adopter une position de compréhension possible, y compris avec des personnes qui ne partagent absolument pas nos valeurs. C’est le Japon qui m’a fait comprendre cela. Je suis né en France, j’ai été élevé dans une tradition catholique pas spécialement croyante. Je suis arrivé au Japon avec des schémas dont je n’avais même pas idée qu’ils étaient pré-construits. Il faut être dans l’empathie. Dans le mouvement social, ça doit être un peu pareil : à partir du moment où on dresse des frontières entre nous sur un grand nombre de choses, c’est foutu. Tout ce qui a trait à l’intime (la nourriture et le sexe, pour le dire très rapidement) constitue un « agent dissolvant ». J’ai vu trop de groupes ou de personnes se dissoudre et se faire du mal sur ces sujets-là, en oubliant les points de convergence pour privilégier telles ou telles attitudes qui relèvent beaucoup de l’intime. Si la société était mûre pour brasser ces sujets, il n’y aurait pas besoin de faire une révolution ! Ce n’est pas le cas. On a des poids dans nos têtes et nos comportements ; nous pensons en être libérés : ce n’est pas vrai. C’est pareil pour la nourriture : si on met des exigences, qui sont souvent de type quasi-religieuses, des interdits, on se met des barrières.
Vous parlez « intimité » mais on peut vous répondre « politique ». Pour certains espaces, l’anarchisme est collectivement indissociable du véganisme. Le terme véganarchisme, issu de l’anglais veganarchism, a d’ailleurs été forgé sur cette base.
Ce sont des débats qui traversent le mouvement anarchiste : on peut prendre anarcha-féminisme, on peut prendre ce qu’avait relevé Murray Bookchin avec la mise en balance d’un lifestyle anarchism [mode de vie, ndlr] et de l’anarchisme social. Je connaissais un ancien militant cégétiste, anarchiste, stéphanois et métallo (mort depuis), qui avait occupé l’usine de Creusot Loire en mai 1968 avec le drapeau noir. Il avait la moitié de sa famille anarchiste et l’autre communiste. J’étais étudiant et je commençais à m’intéresser à l’anarchisme. Il avait lu une revue qui avait fait un numéro thématique « Anarchismes », avec un s, et me disait : « Ça, ce n’est pas possible ! Si on commence à découper comme ça, on est foutus ! » On peut faire anarcha-quelque chose, végano-bidule, mais je pense que c’est une forme de clivage.
On est anarchiste ou on ne l’est pas, alors ?
Ce n’est même pas ça… Franchement, je m’en fous : on rentre dans une posture religieuse. C’est en termes de doctrine, pas de dogme. Dans la doctrine anarchiste, il y a des choses convergentes : la pensée libre, une forme de matérialisme, le refus de l’État et de la domination. Après, on peut injecter tout ce qu’on veut mais on s’éloigne en chapelles, et la chapelle se dresse contre l’autre chapelle. En réalité — et c’est là qu’on retombe sur la géographie —, le cœur du problème est quand-même l’émancipation individuelle, qui n’est possible que par l’émancipation collective, et réciproquement. L’individu est au centre. Or l’individu est situé. Moi, je suis de tel genre, je suis né à tel endroit et à telle époque, j’ai été éduqué comme-ci, j’ai lu des choses comme ça, je suis dans tel pays. Je ne suis pas la même personne que celui qui est né au nord de la Côte d’Ivoire, par exemple, dans une autre religion, etc. Il ne me viendrait pas à l’esprit, et ce serait dangereux, de lui dire : tu fais comme ci et pas comme ça.
Le regard que l’on porte, par ailleurs, sur les traditions socialistes, anarchistes et communistes est souvent européo-centré, voire franco-centré.
Effectivement… Si je prends l’exemple du Japon, que je connais moins mal que les autres, il y a une histoire extrêmement riche. Tout bêtement, un gros travail de connaissance, de traduction, de circulation des savoirs est à faire. Mais le mouvement anarchiste japonais s’est cassé la gueule. Il faut en analyser les raisons pour en tirer les leçons. Pareil en Argentine : il est extrêmement intéressant parce qu’il était peut-être le plus radical. Ils ont été piégés par leur radicalité sur le long terme. Au moment du coup d’État de la junte militaire, ils ont dit « C’est un problème entre bourgeois, on ne va pas intervenir. » Ils se sont payés la dictature militaire puis Perón. Pour le mouvement anarchiste japonais, c’était encore plus compliqué car ils ont eu le militarisme, la guerre, les maos, les bolcheviks… ça fait quand même beaucoup. Surtout, il y a eu 1968 : un réveil de l’anarchisme avec de nouvelles générations, de nouvelles thématiques et la création de l’Internationale des fédérations anarchistes, dont le premier congrès s’est tenu à Carrare, ville italienne de mineurs traditionnellement anarchiste. Il y avait des délégations venues de plusieurs pays : Espagne, Argentine, Italie bien sûr, Japon et France. La France avait deux délégations en réalité : la Fédération anarchiste historique qui sortait d’une phase très compliquée (donc affaiblie) et le mouvement du « 22 mars », avec Cohn-Bendit. Il s’est rendu (tristement) célèbre au moins pour deux choses. Premièrement, quand les anarchistes cubains en exil ont voulu prendre la parole, ils se sont fait interrompre par Cohn-Bendit et ses camarades — il y a des témoignages audio — qui criaient « CIA, CIA, CIA ! ». En gros, ils accusaient les anarchistes cubains d’être à la solde de la CIA… C’était à l’époque de Castro, Che Guevara, et « Viva la Revolución »… Deuxième chose, le mouvement du 22 mars et Cohn-Bendit ont dit « Il y en a marre de ces organisations anarchistes ringardes » — ils n’avaient pas complètement tort sur ce point —, « Dissolvons les organisations anarchistes » ! Il n’y a qu’une seule délégation qui a reçu le message et a décidé de l’appliquer : la japonaise. Ils ont dissout la fédération anarchiste japonaise qui se trouvait à l’époque à peu près dans toutes les villes du pays. Dix ans après, plus rien.
Il n’y a pas de relève ?
Plus rien, le reflux de la vague. Quand le mouvement post-soixante-huitard a commencé a reflué, il n’y avait rien qui fédérait un minimum — une revue, une radio, n’importe quoi. Aucune structure, aucun réseau, peu importe le mot, qui pouvait lier, organiser. Je pense que c’est l’un des enjeux de la nouvelle génération, avec les nouveaux outils, de repenser leschoses différemment.
Notes
1.Voir Jean-Didier Vincent, Élisée Reclus — Géographe, anarchiste, écologiste, Flammarion, 2014.
2. « Vers la fin des années 1950, l’introduction en géographie de l’analyse factorielle a procuré aux chercheurs les outils quantitatifs nécessaires à l’obtention d’une interprétation plus fine et détaillée de cette structure. Appelée écologie factorielle lorsque appliquée à l’étude spatiale de variables tirées du recensement, cette méthode d’analyse permet le regroupement des variables qui possèdent des caractéristiques communes. Chaque regroupement ainsi constitué est considéré comme une des multiples expressions des ségrégations socioécologique propres aux espaces dans lesquels nous habitons. » Gilles Viaud, Cahiers de géographie du Québec, Volume 50, n° 141, décembre 2006.
php

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire