6/12/2018
Remarques à partir de La société ingouvernable de G. Chamayou
À propos de : Grégoire Chamayou, La société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire, Paris, La Fabrique, 2018.
On pourra lire un chapitre de l’ouvrage ici : « Aux sources du libéralisme autoritaire ».
L’un des grands mérites de The Long Twentieth Century, le magnifique ouvrage de Giovanni Arrighi sur la longue durée du capitalisme global, est de montrer le rôle constituant des crises dans les dynamiques historiques. C’est en effet dans les périodes de forte crise – nous dit Arrighi – que se déterminent des mutations sociales majeures ; c’est dans ces moments de grande turbulence qu’advient le passage d’un « cycle systémique d’accumulation » à un autre ; et c’est notamment dans ces phases de transition que s’opèrent des bouleversements dans les relations géopolitiques existantes.
Mais c’est aussi – pourrions-nous ajouter – dans les conjonctures de profonde instabilité que les rapports sociaux de production et la forme de l’État traversent des transformations retentissantes. 1929 en administre la leçon : fin du laissez-faire, pilotage public de l’investissement, reconnaissance/intégration des syndicats et des partis ouvriers dans l’État capitaliste et institution de mesures de solidarité sociale.
À cet égard, la crise qui a frappé les sociétés européennes et nord-américaines à partir de la fin des années 1960 et qui a culminé en 1973 ne fait guère exception : fin du keynésianisme fordiste, financiarisation et tertiarisation de l’économie, reconfiguration des instances souveraines et modulation en un sens work– et warfariste de l’État-providence, avec la précarisation et l’ insécurisation de masse en contrepoint de la nouvelle percée des processus de mondialisation.
L’ouvrage récent de Grégoire Chamayou, La société ingouvernable, dresse une fresque théorique hautement instructive du cadre socio-historique à l’intérieur duquel les capitalismes occidentaux évoluent depuis plusieurs décennies. Ce qui est toutefois plus remarquable encore dans cette œuvre de reconstruction de l’idéologie et de la réalité dominantes, c’est la précision et la richesse avec lesquelles Chamayou montre comment ces déplacements pluriels ont répondu à une stratégie mise en œuvre par les classes dominantes pour répondre aux menaces des mouvements sociaux de l’époque. Le libéralisme autoritaire comme réaction à la société ingouvernable : voilà comment nous pourrions résumer cet épisode de la lutte des classes.
En décortiquant une longue série de « textes de combat », l’auteur trace « l’histoire par en haut » des armes critiques et pratiques élaborées pour sortir les régimes capitalistes issus de la Seconde Guerre mondiale de leur crise systémique – c’est-à-dire à la fois économique, sociale et politique. Les difficultés croissantes à gouverner le cycle productif, à dompter les tensions et à maîtriser les antagonismes ont en effet poussé les classes dirigeantes à s’engager dans un tournant autoritaire. La concrétisation, pluri-décennale, de ce passage s’est faite à coups de « processus d’ insularisation et de verticalisation de la décision souveraine », jusqu’à ce que l’autorité de l’État parvienne à « se délester des pressions de la ‘‘volonté populaire’’ » tout en réorganisant le monde à sa propre image.
Une telle restructuration d’ensemble des rapports sociaux a en effet été conduite sous l’égide d’un double mouvement, contraire mais complémentaire, qui a contribué à accentuer encore davantage les rapports de force en faveur de ceux qui sont au sommet de la pyramide sociale. Si « c’est pour mieux se renforcer que l’État doit se limiter », la consolidation de sa présence dans certains domaines est allée de pair avec son désinvestissement dans d’autres sphères. La combinaison et les actions réciproques entre ces trajectoires variées ont alors débouché sur un « autoritarisme socialement asymétrique », fondé sur des dispositifs de gouvernance dont le pouvoir affecte les instances mêmes qui les ont créés – États inclus.
« Fort avec les faibles, faible avec les forts », le libéralisme autoritaire cherche à forger de nouvelles formes de contrôle et de discipline pour réimposer le commandement là où régnait le chaos. À cet égard, l’entreprise capitaliste, à la façon d’une boite noire, abrite les éléments de vérité aptes à décrypter les changements en cours depuis les années 1970. Le point d’Archimède autour duquel pivote l’argumentation de Chamayou concerne en fait cette cellule.
Cœur pulsant de toute société capitaliste, l’entreprise était devenue le moteur névralgique des luttes et des comportements d’insubordination de l’époque, avant que les contestations ne débordent de ses murs en engloutissant d’autres lieux, des foyers domestiques jusqu’aux espaces métropolitains en passant par les institutions en charge de la reproduction sociale (églises, écoles, hôpitaux, prisons, asiles, etc.). Que faire – se demandent alors les capitalistes et leurs intellectuels organiques – pour rétablir la paix sociale ? De quelle manière amadouer la conflictualité qui mine la productivité du travail et menace le maintien du taux de profit ?
Comme nous le rappelle Chamayou, l’art de gouverner ne se limite pas à la simple édiction de règles ou à la promulgation de lois ; gouverner c’est « faire de la tactique et de la stratégie ». En tant que figures pragmatiques, capables de piocher dans les ressources des milieux militaires, partidaires et marchands et de les amalgamer entre elles, ces hommes d’action ont tout d’abord tenté de comprendre quelles étaient les bases matérielles et idéologiques sur lesquelles s’appuyait le refus du statu quo, pour essayer ensuite de les démanteler une à une en articulant rapports de force, instruments à disposition et fins à court, moyen et long terme. Repliement temporaire, donc, mise au point du plan de contre-attaque et lancement de l’offensive ou encore, diagnostic, pronostic et thérapeutique à appliquer à ce corps malade qu’est la société en crise de gouvernabilité.
Cela peut apparaître une évidence, surtout après un petit demi-siècle de réaction néolibérale, mais le quasi plein-emploi et les droits sociaux – ces bribes de démocratie réelle arrachées de haute lutte tout au long des années 1960 et de la première partie des années 1970 – ne faisaient pas exclusivement fonction de dispositifs de contrôle biopolitique voués à contenir les revendications et à subjectiver les individus conformément aux normes sociales en vigueur. Ces « avancées tactiques » constituaient aussi une pré-condition difficilement négligeable pour pouvoir dire non à nombre d’injonctions concernant les rôles et les activités socialement attribués. Si les travailleur.ses, les femmes et les jeunes se révoltaient contre les prescriptions imposées par le salariat et son welfare, cela n’empêche pas qu’ils savaient comment en faire un contre-usage afin de valoriser leurs besoins et désirs, plutôt que le capital.
Ces deux pierres angulaires du capitalisme d’antan devaient alors être consciencieusement détruites, car – au bout du compte – elles avaient à la fois nui et servi la cause : pensées par Keynes et ses acolytes comme des mesures de stabilisation de la demande effective et de domestication du travail vivant, la diminution du chômage et l’augmentation du salaire direct et indirect ont aussi fourni, entre autres choses, un relais matériel aux luttes.
Parmi les différentes solutions envisagées par la « contre-réforme néolibérale », il en est une en particulier qui a rapidement conquis les esprits des capitalistes, des politiciens et de l’intelligentsia d’establishment : la gouvernance financière. Dispositif le plus performant dans l’alignement des conduites tout au long de la chaîne du commandement, des PDG et chefs d’État jusqu’aux petits managers et représentants de l’administration publique, le cours des marchés financiers a été érigé en méta-régulateur de dernière instance – une sorte de gouvernement des gouvernants et des gouvernés, qui, à mesure qu’on descend dans l’échelle sociale, a su réaménager et durcir les normes du contrôle et de la discipline.
La valeur des titres boursiers est ainsi devenue l’opératrice d’une « mesure de police à déclenchement automatique », qui a fait rage non seulement sur les minima démocratiques, mais aussi sur les conquêtes sociales et ce qu’ils impliquaient, tant en termes d’affrontement que de normalisation. Ce ne sont désormais plus les patrons d’entreprise et les hommes charismatiques qui dictent la ligne, mais l’anonymat apparent des indices de la bourse – où l’énorme centralisation du grand capital, d’ailleurs, est beaucoup plus accrue que dans n’importe quel autre secteur. L’œuvre d’ingénierie socio-politique renfermée dans ce projet constituant laisse alors entrevoir la construction d’une architecture institutionnelle qui vise à alléger les pressions multiples subies par le capital.
Le nec plus ultra de la domination abstraite et de la reproduction impersonnelle du système – l’éther de la sphère financière – se révèle en fait être le fruit empoisonné d’une mauvaise rencontre entre la théorie et la pratique néolibérales. Ce qui expose au grand jour la dialectique toujours à l’œuvre entre la productivité de la conflictualité sociopolitique – de laquelle est issu ce nouvel arrangement institutionnel – et la contrainte objective des structures économiques – l’inertie de leur reproduction. Loin de se fonder sur un mécanisme naturel, l’ordre nouveau a été disposé à partir des présupposés de l’ancien, afin de se débarrasser des difficultés qu’il avait rencontrées le long du chemin.
C’est donc dans ces « petits détails » macro-historiques que se cache le diable, à savoir le cerveau et les muscles des classes dominantes. Car seule l’« analyse concrète d’une situation concrète » peut expliquer les déplacements intervenus pour réparer le monde du capital, ou, pour le dire avec Marx, seule la prise en considération des contre-tendances à la baisse tendancielle du taux de profit livre les coordonnées socio-économiques à l’intérieur desquelles nous sommes obligés (bon gré mal gré) de penser et d’agir politiquement.
On peut donc regretter qu’après une généalogie ponctuelle et stimulante des procédures de gouvernance de la firme, de son environnement et de l’État, Chamayou s’arrête au seuil de notre présent. Ce face à quoi nous nous retrouvons depuis une décennie, c’est en effet une autre crise systémique – c’est-à-dire à la fois globale et structurelle – du capitalisme, intimement liée à la précédente (ou, dans le langage d’ Arrighi, la « crise terminale » du cycle d’accumulation hégémonisé par les États-Unis, alors que celle des années 1970 représentait sa « crise initiale »).
Bien qu’il s’agisse d’un processus vaste et complexe, l’installation du néolibéralisme a connu deux moments forts : le premier, suite à la crise de la moitié des années 1970 et le deuxième, après la crise déclenchée en 2008, qui a ultérieurement radicalisé et renforcé les rapports sociaux néolibéraux, en accélérant et en aiguisant encore plus les dynamiques à l’œuvre depuis plusieurs décennies. Si la crise des années 1970 a déterminé un saut de paradigme, la crise de 2008 a catalysé des tendances de moyen terme, en impliquant un changement interne au paradigme – le passage à une nouvelle phase, plus dure et mortifère, du néolibéralisme.
Cet « usage capitaliste des crises » s’est déplié selon deux axes, qui se greffent parfaitement aux considérations développées dans La société ingouvernable, et dont la montée ahurissante de régimes autoritaires partout dans le monde dans un contexte post-crise est non seulement l’expression la plus visible, mais constitue en outre l’occasion la plus favorable d’une aggravation ultérieure de la situation, à savoir : l’extension et l’intensification des logiques d’exploitation et de domination. Bien évidemment, une analyse théoriquement solide et empiriquement documentée du capital après la crise enclenchée en 2008 nécessiterait un ouvrage en soi.
Néanmoins, les idées-forces élaborées par Chamayou pourraient être prolongés en suivant les deux lignes directrices de son ouvrage.
Côté entreprise, malgré un léger ralentissement de la tendance, les processus de délocalisation continuent à produire précarité et chômage, sous-emploi et surexploitation, en allongeant les journées de travail pour les un.es et en intensifiant les rythmes pour les autres. L’émergence d’abord, et la croissance rapide ensuite de plateformes telles que Amazon, Uber, Deliveroo, etc., est à cet égard symptomatique de la dégradation qui atteint l’hétérogénéité des conditions et des relations de travail à l’œuvre sous nos latitudes.
Côté État, l’approfondissement des logiques sécuritaires et policières parallèle à la décomposition du marché du travail et de l’État social, a fini par soutenir à son tour l’essor des autoritarismes à l’échelle globale. À ce propos, les années post-crise ont donné lieu à un double mouvement.
Dans un premier temps, la critique de la mondialisation a trouvé dans les protestations sociales qui ont caractérisé le cycle des occupations de places une expression radicalement progressiste, voire révolutionnaire : des printemps arabes jusqu’au mouvement brésilien, en passant par la Grèce, l’Espagne, les États-Unis, la Turquie, etc., des mobilisations puissantes ont vu le jour, en inventant des formes d’auto-organisation qui ont été à même de secouer les systèmes politiques en place.
Cette brève mais intense séquence a ensuite été mise à l’écart par la montée inquiétante de l’extrême droite dans de nombreux contextes nationaux, du Sud-est asiatique à l’Amérique latine, en passant par le Moyen-Orient, l’Europe entière, la Russie, les États-Unis, etc.[1].
Une telle montée des autoritarismes ne se bornera pas à augmenter la puissance effrayante des appareils répressifs d’État sans opposer le moindre barrage à l’effritement des couches moyennes et à la néo-prolétarisation de masse. Cette marée noire clivera encore plus la composition de classe selon les lignes du genre et de la race, en creusant davantage les tensions immanentes aux groupes sociaux qui subissent de plein fouet les contrecoups de la crise. Cependant, la lutte contre ces formes d’oppression, loin de se limiter à la sphère des droits civiques, peut non seulement s’attaquer à la violence d’État, mais investir aussi les racines de la division sociale du travail – socle matériel de la (re)production des inégalités et de ses processus d’assujettissement.
Pour conclure, l’ouvrage de Chamayou termine avec un chapitre sur la micropolitique et la production de subjectivités, dans lequel est mise en avant toute l’importance pour l’implantation du néolibéralisme de la création de dispositifs à l’intérieur desquels les individus peuvent agir de façon convenable. Contrairement à toute vision pastorale ou conscientisante de la politique, les néolibéraux, en tant que bons (contre)révolutionnaires, se focalisent sur les comportements, les postures et les attitudes des sujets. Transformer les pratiques pour changer les idées et les modes de penser, ou mieux : transformer les conditions de la pratique pour faire en sorte que les sujets se conduisent autrement. À nous de relever le défi et d’apprendre de l’ennemi, exactement comme il a su et n’a pas cessé de le faire depuis maintenant trop longtemps !
Notes
[1] A cet égard, nous nous permettons de mentionner un colloque – focalisé sur l’Amérique latine et les mouvements féministes et des migrants – qui aura lieu à Nanterre, le 24-25 janvier 2019, et auquel participera notamment G. Chamayou : cf. sur le blog du laboratoire Sophiapol « L’État autoritaire : crise du néolibéralisme, violence politique et némésis du capital ».
php
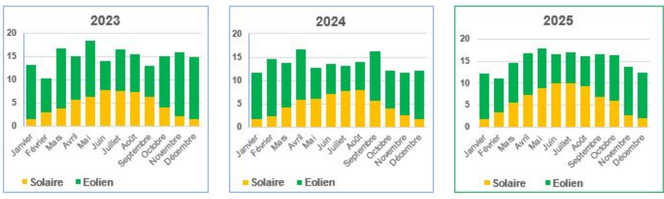
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire