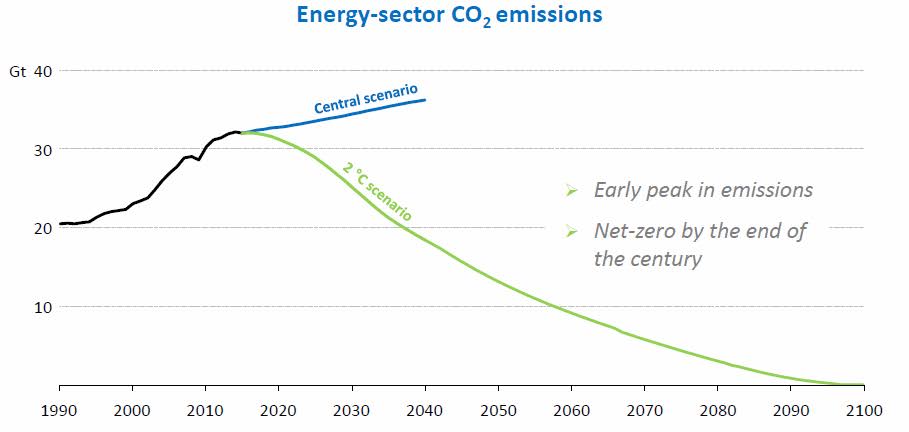Thibault Le Texier
 Dans Le maniement des hommes (La Découverte, 2016), Thibault Le Texier
avait étudié la rationalité managériale, en la distinguant au passage
de la logique économique et de la logique étatique. Son nouveau livre,
intitulé sans équivoque Histoire d’un mensonge et consacré à la fameuse « expérience de Stanford »
(Zones, 2018), classique de la psychologie sociale depuis près d’un
demi-siècle, traite apparemment d’un sujet tout à fait différent –
quoique finalement pas sans rapport… Il s’agit toujours, sous un autre
angle, de s’intéresser au pouvoir. Et c’est détonnant.
Dans Le maniement des hommes (La Découverte, 2016), Thibault Le Texier
avait étudié la rationalité managériale, en la distinguant au passage
de la logique économique et de la logique étatique. Son nouveau livre,
intitulé sans équivoque Histoire d’un mensonge et consacré à la fameuse « expérience de Stanford »
(Zones, 2018), classique de la psychologie sociale depuis près d’un
demi-siècle, traite apparemment d’un sujet tout à fait différent –
quoique finalement pas sans rapport… Il s’agit toujours, sous un autre
angle, de s’intéresser au pouvoir. Et c’est détonnant.
 Contretemps (CT) : Avant d’être
l’histoire d’un mensonge, d’une fraude scientifique, le livre est
l’histoire d’une déception : la tienne. Ton intention de départ n’était
pas de faire un livre critique, mais un documentaire sinon bienveillant,
du moins réellement intéressé par cette « expérience ». Peux-tu revenir
là-dessus ? Quel est ton état d’esprit quand tu te rends à Stanford
pour y dépouiller les archives ? Nourris-tu déjà quelques doutes, même
vagues, ou pas encore?
Contretemps (CT) : Avant d’être
l’histoire d’un mensonge, d’une fraude scientifique, le livre est
l’histoire d’une déception : la tienne. Ton intention de départ n’était
pas de faire un livre critique, mais un documentaire sinon bienveillant,
du moins réellement intéressé par cette « expérience ». Peux-tu revenir
là-dessus ? Quel est ton état d’esprit quand tu te rends à Stanford
pour y dépouiller les archives ? Nourris-tu déjà quelques doutes, même
vagues, ou pas encore?
Thibault Le Texier (TLT) : Oui, c’est vrai, au début j’ai pris
l’expérience pour argent comptant. Elle était très crédible : elle était
validée par le monde académique depuis quarante ans, elle était reprise
abondamment dans les médias,
Philip Zimbardo
(le scientifique qui a conduit l’expérience) était prof émérite à
Stanford, il avait été président de l’Association américaine de
psychologie, etc. Et puis je ne me suis pas intéressé à l’expérience
avec ma casquette de chercheur, mais avec ma casquette de réalisateur.
Je n’étais pas dans une approche académique ou épistémologique, et mes
producteurs encore moins. Ensemble on parlait financements, mise en
scène, traitement des images, jeu des acteurs, vécu des spectateurs.
Il y a cette injonction permanente, dans le cinéma, à parler aux
émotions des spectateurs et pas à leur cerveau. Les films sont souvent
juste une succession de gros plans sur des visages. C’est le contraire
de l’approche objective, rationnelle, mesurée, sourcée, référencée, où
tu cherches des constantes et des généralisations intéressantes. Quand
tu écris un scénario, il faut au contraire aller à fond dans le cas
particulier, le ressenti, le subjectif, les sentiments. Il faut exprimer
ton point de vue sans te soucier qu’il soit fondé sur autre chose que
lui-même. L’expérience m’a d’abord attiré pour ça : elle me laissait la
liberté d’exprimer mon point de vue. Et je pense que c’est une des
raisons de son succès. C’est un support de projection à la fois très
lisse et très contrasté : tu peux lui faire dire facilement ce que tu
veux, et en même temps tu peux lui faire dire des choses extrêmes.
Donc j’avais ce projet de documentaire, je voulais raconter la
version officielle. Mais je voulais la raconter en donnant la parole aux
gardiens et aux prisonniers. À quoi ils pensaient pendant
l’expérience ? De quoi ils avaient parlé ? Qu’est-ce qu’ils avaient
ressenti ? La version officielle n’en disait quasiment rien. Et puis
Zimbardo avait déjà tellement raconté son histoire, je ne voyais pas
l’intérêt de lui tendre un micro pour la millième fois. C’est pour ça
que j’ai voulu aller à Stanford, dans les archives de l’expérience.
CT : Comment et quand découvres-tu le pot-aux-roses ? Très
vite, dès que tu lis les premiers documents, ou est-ce plus progressif ?
TLT : J’avais des doutes depuis que j’avais lu
The Lucifer Effect
[ouvrage publié en 2007 dans lequel Zimbardo relate en détail son
expérience et trace de nombreux parallèles avec Abu Ghraib]. Plusieurs
fois, dans ce livre, il laisse entendre qu’il ne s’est pas contenté
d’observer l’expérience et qu’il y a participé gaiement. Mais je restais
convaincu que l’expérience était solide. C’est en commençant à
dépouiller les archives que j’ai déchanté. Elles sont tellement
éloignées de la version officielle que j’ai tout de suite trouvé des
récits contradictoires : des gardiens qui disaient qu’ils n’avaient fait
qu’obéir aux expérimentateurs et qu’ils jouaient tout le temps la
comédie, des prisonniers qui décrivaient leurs conditions de vie
surréalistes. Mais je ne voulais pas y croire, c’était trop gros.
Et puis très vite je suis tombé sur l’expérience du Toyon Hall [menée
dans un dortoir par des étudiants, cette expérience a servi de modèle à
Zimbardo], je suis tombé sur les témoignages de David Jaffe, l’étudiant
qui a dirigé cette expérience pilote, j’ai découvert les rapports des
assistants de Zimbardo, qui mettaient le doigt où ça fait mal. À partir
de ce moment-là, il n’y avait plus aucun doute : l’expérience était
bidonnée. Et pourtant j’avais toujours du mal à le croire. Comment
était-il possible que personne n’ait découvert le pot-aux-roses en
quarante ans ? Pourquoi Zimbardo avait rendu publiques des archives qui
montraient sans ambiguïté sa supercherie ? Pourquoi il n’a pas détruit
au moins les documents les plus accablants ?