le 18 avril 2016
Commentaire :
-Labeur (n) : un des procédés par lesquels A gagne des biens pour B.
-Consulter : rechercher l'approbation d'autrui pour un projet déjà bien arrêté.
-Distance : la seule chose que les riches soient prêts à accorder aux pauvres, en souhaitant qu'ils la gardent.
-Singe : animal arboricole qui se sent également très à l'aise dans les arbres généalogiques.
-Érudition : poussière tombée d'un livre dans un crâne vide.
-Sénat : groupe de gentlemen d' un certain âge chargés de hautes responsabilités et de sombres méfaits
-Diagnostic (n) : l'art de déterminer l'état financier du patient, afin de savoir à quel point le rendre malade.
Extraits de "le dictionnaire du Diable" 1911
php
L’histoire de la littérature est partielle et quelquefois partiale : elle délaisse les écrivains qui n’ont jamais pu soumettre leur voix à la publication, et condamne parfois certains auteurs importants à l’oubli. Ambrose Gwinnett Bierce est de ceux-là : une sorte de chaînon manquant de la littérature américaine du XIXe siècle, aussi méconnu qu’important pour comprendre son époque. Fantôme à l’œuvre foisonnante et hétéroclite, tour à tour journaliste, topographe, écrivain et pamphlétaire, il a – de Jack London à H.P. Lovecraft – inspiré un bataillon d’auteurs qui se sont bien gardés de nous rappeler son bon souvenir. Notamment auteur d’un « Dictionnaire du diable », celui que l’on surnommait « l’homme le plus méchant de San Francisco » était redouté pour son verbe, sa colère et son obscure lucidité. Fasciné par la Faucheuse, Bierce en fit la rencontre au Mexique, à l’aube de la Grande Guerre, aux côtés de Pancho Villa. Voici l’histoire des multiples vies et morts du premier des grands écrivains américains.
“Bitter Bierce”, le premier des écrivains maudits de l’Ouest

Irrécupérable. Voici sans nul doute l’adjectif qui siérait le mieux à Ambrose Bierce (1842-1914) – très tôt surnommé “Bitter” Bierce, ou Bierce “l’amer”, “le Mordant” – si l’on devait l’enfermer dans une boîte. Voici peut-être aussi la raison pour laquelle on l’a laissé suspendu au croc des pestiférés du Panthéon littéraire. C’est que l’homme n’a rien fait pour se faire des amis, passant sa vie à torpiller dans tous les sens ses contemporains, leurs faits, leurs gestes et leurs paroles, armé de sa plume de bretteur, tenant ses couilles, au chaud, dans le creux de sa main.
L’aigreur et le mordant du personnage trouvent certainement leur source dans une vie personnelle au goût acariâtre et une époque qui, déjà, tendait la joue pour se prendre une claque. Né en 1842 au cœur d’une famille de pionniers puritains dans un petit bourg de l’Ohio, Ambrose Bierce est le dixième enfant d’une famille qui en compte treize. Sa jeunesse, marquée par la rudesse des conditions de vie d’un rêve américain under construction, est rythmée par les épopées d’Homère, les poèmes de Byron et les éructations d’un père amateur de whisky. Rapidement, le jeune homme cherche à fuir le domicile familial pour embrasser une vie plus rocambolesque. Après quelques difficultés à trouver un emploi stable, il s’engage à Warsaw, au Kentucky Military Institute, qui brûle quelques mois plus tard. Bierce décide de rester dans la bourgade et devient garçon de saloon : il commet alors ses premiers écrits, sans penser au conflit armé qui allait bientôt enflammer les États-Unis.

En 1861 éclate la guerre de Sécession : l’occasion rêvée pour un jeune homme en quête d’aventure qui n’attendait que de se voir proposer un destin rocambolesque. Ambrose Bierce part in extremis se frotter aux méandres des champs de bataille en Virginie, aux côtés des unionistes du Nord. Parti comme un touriste, l’écrivain en herbe découvre rapidement la boucherie absolue, et abandonne progressivement ses velléités romantiques dans les Cheat Mountains pour se confronter au sang, aux larmes et à la sueur. Il découvre alors les tréfonds de l’âme humaine et observe tantôt la lâcheté, tantôt l’héroïsme, au cœur de gigantesques charniers fratricides qui lui font gagner une amère lucidité et perdre ses lambeaux de foi en l’humanité. Blessé à la tête lors d’une bataille et capturé par un confédéré étrangement hospitalier – épisode dont il réalisera plus tard une nouvelle –, il termine la guerre à 23 ans, décoré du grade de capitaine et de nombreuses idées noires.
Fondatrice pour Ambrose Bierce et sa plume acide, l’expérience de la guerre de Sécession reste gravée comme un stigmate dans ses travaux littéraires et journalistiques. Il lui dédie d’ailleurs trois recueils de nouvelles sous le titre En plein cœur de la vie, mêlant histoires de soldats et tranches de vie de civils, sous une forme réaliste et désabusée, adoptant parfois une sécheresse rappelant l’écriture des faits divers. L’humour, aussi noir que possible, n’y est jamais loin, comme dans cet extrait de la nouvelle Le coup de grâce, publiée dans le premier recueil :

« […] “Capitaine, le colonel vous ordonne de porter votre compagnie à l’entrée de cette ravine et de tenir la position jusqu’à ce qu’on vous rappelle. Je n’ai pas besoin de vous dire combien ce mouvement est dangereux, mais si vous le souhaitez, je suppose que vous pouvez abandonner votre commandement à votre sous-officier. En fait, on ne m’a pas demandé de vous suggérer cette transmission de pouvoirs ; c’est tout au plus un conseil de ma part, que je vous fais à titre gracieux.”
À cette mortelle insulte, le capitaine Madwell répondit avec sang-froid :
“Major, je vous invite à participer à notre mouvement. Un officier à cheval ferait une excellente cible, et il y a un bon moment que je pense que tout irait mieux si vous étiez mort.”
Le sens de la répartie se pratiquait dans les cercles militaires dès 1862. »
La guerre a transformé Ambrose Bierce en “Bitter” Bierce. Elle en a fait un redoutable pessimiste et elle lui a fourni une obsession, celle de la mort, qui constitue la colonne vertébrale de son œuvre. Dans tous ses récits, l’auteur lui fait une place de choix, qu’il s’agisse de raconter un parenticide, une exécution du haut d’un pont, une résurrection ou de fiévreux cauchemars nocturnes. Il lui arrive parfois même de se lancer dans des réflexions quasi-anthropologiques sur le sujet.
De cette fascination vient sans doute la réputation sulfureuse que le personnage se traîne depuis cent cinquante ans. De là vient aussi le caractère meurtrier de son écriture qui, dépourvue de métaphores et d’enjolivements, reste néanmoins celle du premier grand styliste de l’humour noir américain. Un précurseur fantomatique, oublié, même par André Breton qui ne l’a jamais cité dans son Anthologie. Ambrose Bierce était pourtant décrit par certains de ses contemporains américains comme le premier grand écrivain des États-Unis.
Une plume majeure de la littérature fantastique

Le talent littéraire d’ Ambrose Bierce s’est toujours illustré dans de petites lucarnes, jamais dans des œuvres au long cours. Comme si son regard désabusé sur les choses ne pouvait s’attarder trop longtemps sur un sujet, au risque de le plonger dans la folie. Ainsi, la plus longue œuvre qu’il ait laissée à la postérité est une traduction d’un magnifique conte allemand intitulé Le moine et la fille du bourreau, œuvre originale écrite par Richard Voss, avec laquelle il a pris de grandes libertés jusqu’à la faire sienne.
L’humour au vitriol et les sombres ambiances des nouvelles réalistes de Bierce se retrouvent dans d’autres de ses méfaits écrits, notamment ceux dans lesquels il a consacré du temps à raconter les destins surnaturels et les funestes hallucinations de ses personnages. Regroupées sous des titres aussi divers que Contes noirs, Fables fantastiques ou De telles choses sont-elles possibles ?, les histoires fantastiques de l’auteur représentent la part la plus importante de son œuvre. Souvent racontées à la première personne du singulier, elles résonnent comme de petites scènes horrifiques tournées caméra au poing, en faisant la part belle à la psychologie et aux songes hérétiques d’individus déraisonnables. Au gré des pages, on rencontre un sacré bestiaire : une machine ayant pris le contrôle de son inventeur, un « club des parenticides » voué à déterminer les moyens les plus optimaux d’exterminer un proche, de lugubres apparitions nocturnes, des fonctionnaires corrompus à tire-larigot, des soldats perdus, et même un Ésope « revu et corrigé ». Le tout, comme de bien entendu, dans une ambiance systématiquement macabre.

Howard Phillips Lovecraft, maître de l’horreur
Derrière l’outrance de l’imaginaire, nul auteur n’avait avant Ambrose Bierce aussi bien décrit la réalité à travers le prisme de la fiction. Parfois, la folie se mêle à l’atmosphère macabre pour devenir la pierre angulaire de ses récits : une folie contemporaine, créée par une modernité de plus en plus rationnelle, laissant l’individu en proie à ses démons, à ses doutes, à ses malheureuses intuitions. Parfois même, la parapsychologie s’invite au banquet maléfique de l’auteur.
Certaines des nouvelles de Bierce peuvent être qualifiées de pré-lovecraftiennes, à l’exemple de Cette satanée chose. Dans cette histoire, un individu en proie à des hallucinations se pose la question de l’inconnu et des domaines encore vierges d’études scientifiques, jusqu’à une terrible conclusion : « […] Je ne dors presque plus. C’est terrible, insurmontable ! Si ces stupéfiantes aventures sont bien réelles, je vais devenir fou. Si elles sont le fruit de mon imagination, c’est que je suis déjà fou. »
Journaliste sous le signe du Diable
Aussi torturés que puissent être ses récits, Ambrose Bierce était toutefois un homme qui avait la tête sur les épaules, ce qui lui permis de se réaliser dans une autre vie littéraire : celle du journalisme. « Mon programme est une calme désapprobation des institutions humaines en général, y compris toutes formes de gouvernement, la plupart des lois et coutumes, et l’ensemble de la littérature contemporaine », aimait-il à déclarer. Satiriste à l’extraordinaire virulence, il est loin de ne se faire que des amis dans les médias de son époque. En fin de compte, il ne s’y fait même pas d’amis du tout. On raconte que Mark Twain, son presque voisin de pallier à San Francisco, qui entama lui-même une carrière de journaliste à la même époque, prit grand soin d’éviter de croiser son chemin. En effet, le pessimisme lucide du personnage l’amène à tirer sur toutes les cibles – capitalisme, trusts des chemins de fer, notables américains, violence, racisme, bêtise humaine –, tantôt par amusement, tantôt par conviction et parfois par désespoir, mais toujours en visant dans le mille, avec pour souci de redonner une voix à tous les opprimés. Si l’on devait encapsuler sa pensée en une seule punchline, on pourrait choisir celle-ci : « Ne vous fiez pas à l’humanité sans garanties supplémentaires, cela vous jouerait quelque vilain tour. Cultivez un goût pour les vérités dégoûtantes. Et, finalement, le plus important de tout, efforcez-vous de voir les choses comme elles sont et non comme elles devraient être. »

Sa carrière est une vaste fanfaronnade : elle le trimballe de la West coast à la East coast, où il est régulièrement acclamé, et même jusqu’en Europe, où il fonde un journal – La Lanterne – qui publiera seulement deux numéros sous le haut patronage de l’impératrice Eugénie. En 1887, William R. Hearst, magnat de la presse et fils du milliardaire George Hearst, lui demande d’écrire dans le journal de la côte Ouest The Examiner. “Bitter” Bierce accepte sous certaines conditions : une liberté totale, un très bon salaire et un emploi à vie. Il obtient gain de cause et écrira de féroces éditoriaux, n’hésitant pas à crucifier son propre journal lorsqu’il juge cela nécessaire. Il restera à la rédaction de l’ Examiner quasiment jusqu’à la fin de sa vie, en continuant parallèlement à écrire des nouvelles.
Comme si le destin avait voulu le punir de son âpreté, l’intégralité des écrits journalistiques de Bierce partirent en fumée lors d’un séisme à San Francisco en 1906. Malgré la disparition à jamais de ce trésor, nous disposons encore du Dictionnaire du diable, sorte de compilation d’aphorismes sous forme de définitions qui peuvent nous donner une idée du ton impertinent et moqueur de ses articles. Cette œuvre écrite en vingt-cinq ans – la plus célèbre d’ Ambrose Bierce à ce jour – représente la quintessence du génie cynique et humoristique de son auteur. D’Abdication à Zoologie, des centaines de mots y ont droit à leur taillage de costard, comme le montrent les exemples suivants, piochés dans la garde-robe :
« Aborigènes n.p. Personnes de moindre importance qui encombrent les paysages d’un pays nouvellement découvert. Ils cessent rapidement d’encombrer : ils fertilisent le sol.
Éloquence n. Art de convaincre les imbéciles par la parole de ce que le cheval blanc d’Henri IV est effectivement blanc. Cela inclut le talent de prouver que le cheval blanc est également de n’importe quelle autre couleur.
Émancipation n. Changement de tutelle de la tyrannie d’autrui au despotisme de soi-même.
Fiancé p.p. Par un anneau à la cheville, relié à une chaîne et à un boulet.
Fiancée n. Jeune personne qui a une belle perspective de bonheur derrière elle.
Frontières n. en géographie politique, ligne imaginaire entre deux nations, séparant les droits imaginaires de l’une des droits imaginaires de l’autre.
Malfaiteur n. Facteur principal dans le progrès de la race humaine.
Médire v. Faire le portrait d’un homme comme il est, quand il n’est pas là.
Occident n. Partie du monde qui se trouve à l’Ouest (ou à l’Est) de l’Orient. Elle est principalement habitée par les Chrétiens, puissante sous-tribu des Hypocrites, dont les principales activités sont le meurtre et l’escroquerie qu’ils se complaisent à appeler “guerre” et “commerce”. Celles-ci étant également les premières activités de l’Orient.
Surmenage n. Trouble grave qui affecte de hauts fonctionnaires publics quand ils veulent partir à la pêche. »
Dans son Dictionnaire, le lexicographe du diable ne s’est pas contenté de redéfinir une série de mots : il a également créé de toutes pièces un certain nombre de fausses citations, rédigées par une flopée d’auteurs fictifs, afin de recréer tout un système de références qui dépendaient toujours de sa plume imaginative. Comme disait l’autre, « le Diable se cache dans les détails » : pour parfaire son travail de satiriste, Ambrose Bierce n’en a négligé aucun.
« Ne vous fiez pas à l’humanité sans garanties supplémentaires, cela vous jouerait quelque vilain tour. Cultivez un goût pour les vérités dégoûtantes. Et, finalement, le plus important de tout, efforcez-vous de voir les choses comme elles sont et non comme elles devraient être. »
« Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. »
La vie et l’œuvre d’ Ambrose Bierce sont auréolées de mystère : il était logique qu’il en soit de même pour sa mort. En effet, le lexicographe du diable, fasciné qu’il était par la thématique de la disparition, n’aurait jamais accepté de partir dans l’au-delà en laissant au monde le souvenir conventionnel de sa carcasse étendu sur un lit. Né avec ce que l’humanité a de plus crasse durant la guerre de Sécession, il était logique qu’il termine son existence sur un cheval, un revolver à la main, des gouttes de sueurs perlant sur sa barbe blanche.
C’est après s’être rendu sur les champs de bataille de sa jeunesse pour la dernière fois qu’ Ambrose Bierce prend la décision de livrer son dernier combat. En 1913, il quitte définitivement les États-Unis pour rejoindre le Mexique. Dans ses dernières lettres, il explique à ses amis qu’il part rejoindre les troupes de Pancho Villa et se plonger au cœur de la Révolution mexicaine. « Ah, être un gringo au Mexique ; ça, c’est de l’euthanasie », furent ses derniers mots écrits, et on n’eut plus aucune trace de lui à partir de l’année 1914, à l’aube de la Première Guerre mondiale. Ainsi se termine la vie de Bitter Bierce, dans le flou fantasmatique du dernier geste désespéré, comme bon nombre de ses personnages de fiction.

Bien évidemment, par sa portée romanesque, une telle fin ne pouvait rester lettre morte trop longtemps. C’est ainsi que l’écrivain mexicain Carlos Fuentes (1928-2012) décide en 1985 de rendre un dernier hommage à Ambrose Bierce, sous la forme d’un court roman baptisé Le vieux gringo. Dans ce livre transposé plus tard au cinéma, il tente d’imaginer les derniers jours de celui qu’il surnomme le « général indien » et qui vit ses dernières heures en compagnie de Miss Harriet, institutrice partie elle aussi au Mexique. Entre la spéculation biographique et l’hommage littéraire, Carlos Fuentes ne cache pas toute la tendresse qu’il éprouve pour ce vieil homme qui, après une vie bien remplie et la lecture de Don Quichotte, ne souhaite que trouver une mort héroïque. Et lorsqu’il décide de placer des tirades dans la bouche de son personnage, celles-ci se révèlent d’une troublante vraisemblance :
« Mon nom symbolisait la froideur antisentimentale. J’étais le disciple du diable, sauf qu’en réalité je n’aurais même pas accepté le diable comme maître. Dieu encore moins, que j’ai diffamé par quelque chose d’encore pire que le blasphème : en jetant la malédiction sur tout ce qu’Il a créé. […] Je voulais simplement dire que vous pouvez sans doute comprendre la défaite d’un homme qui avait cru être maître de son destin, cru qu’il pouvait modeler le destin des autres à travers le journalisme de dénonciation et de satire, affirmant sans hésiter être ami de la Vérité, non de Platon, tandis que mon seigneur et maître de la presse canalisait ma colère pour la plus grande gloire de ses intérêts politiques et du volume de ses ventes, volume tout aussi important que celui de ses comptes en banque. Ah ! Quel idiot j’ai été, miss Harriet. Mais c’est pour ça qu’on me payait, pour être l’idiot, le bouffon de service, payé par lui, mon Seigneur et Maître en ce pays. »

Carcosa, ville mythique imaginée par Bierce, ici représentée dans la saison 1 de True Detective
Ambrose Bierce fait aujourd’hui partie de ce que l’on pourrait appeler le Panthéon maudit de la littérature américaine. Personnage oublié, il erre tel un fantôme dans de nombreuses œuvres de la culture populaire. Il est clair que Lovecraft a poussé certaines de ses intuitions jusqu’au bout dans ses pages, avec à sa suite de nombreux auteurs célèbres comme Stephen King ou Alan Moore. Sur le plan cinématographique, on trouve notamment sa trace dans un large défilé de films d’horreur, et plus récemment dans la première saison de True Detective qui met en scène une de ses créations, la ville de Carcosa, en référence à la somptueuse nouvelle Un habitant de Carcosa. Mais rarement on se souvient vraiment de son nom, secrètement attaché à jamais aux plus grandes heures de l’Histoire des États-Unis. Peut-être est-il enfin temps de l’exhumer.
Une courte biographie et quelques citations de l’auteur
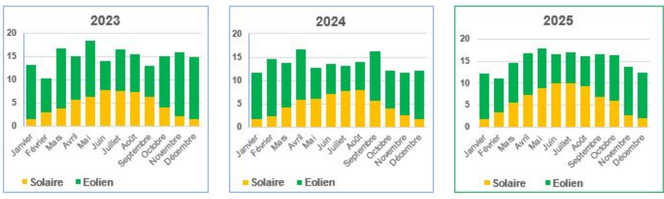
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire