30/05/2019
Commentaire : "Ce n'était pas le destin qu'il poursuivait mais le sort qu'il fuyait"
Jérusalem, Alan Moore, p171
php

Les théories sur l’effondrement imminent de notre civilisation, qui se diffusent de plus en plus largement, tirent leurs racines d’un catastrophisme intimement lié à l’histoire de l’écologie politique. Loin d’une incitation au fatalisme, ce catastrophisme pourrait être un outil précieux de mobilisation. C’est en tout cas ce que défend le chercheur Luc Sémal dans son dernier ouvrage, Face à l’effondrement (PUF, 2019).
En quelques mois, la thématique du risque d’effondrement de notre civilisation s’est imposée avec une ampleur inédite dans l’espace public, portée en France par les « collapsologues ». Les alertes des scientifiques, les mobilisations citoyennes et les relais médiatiques – Usbek & Rica y consacrait le dossier de son magazine à l’automne 2018 – ont contribué à démocratiser ces théories qui pointent l’inévitable épuisement des ressources, les risques d’emballement climatique et d’effondrement de la biodiversité, la fragilité de notre système économique et financier ou les multiples pollutions. Autant d’éléments déclencheurs d’une très plausible réaction en chaîne qui conduirait, selon elles, à la fin de notre civilisation thermo-industrielle.
Cette pensée de la catastrophe germe sur un terreau qui n’a jamais été aussi fertile : impuissance politique devant les défis écologiques, incrédulité vis-à-vis des capacités de la technique à nous sortir de l’ornière, remise en cause même du progrès humain… Il n’en faut pas plus pour que l’horizon collectif s’assombrisse. Mais quid du passage à l’action ? D’aucuns diront que l’idée d’effondrement revient à accepter l’échec, à attendre patiemment l’apocalypse dans une forme de résignation morbide. On oppose souvent au catastrophiste l’optimiste, qui serait dans une disposition d’esprit plus orientée vers l'action. L’un baisse les bras, tandis que l’autre se retrousse les manches. Luc Semal réfute cette vision binaire. Maître de conférence en science politique au Museum national d’histoire naturelle, chercheur au Centre d’écologie et des sciences de la conservation, il vient de publier un nouvel ouvrage, Face à l’effondrement (PUF, mars 2019). Avec un regard historique et sociologique, il y explique à quel point la pensée catastrophiste peut se révéler mobilisatrice.

Les théories de l’effondrement occupent une place croissante dans la pensée écologiste contemporaine. Militants et politiques annoncent désormais sans complexe l’effondrement de notre civilisation industrielle. Or, selon vous, ce n’est pas entièrement nouveau : le catastrophisme est même consubstantiel de l’écologie politique depuis ses débuts…
Luc Sémal : La pensée politique verte émerge au sortir de la seconde guerre mondiale sous la double pression de la prolifération nucléaire et de la dégradation des conditions écologiques. Surtout, dès le tournant des années 1960-1970, la question des limites à la croissance se pose explicitement, et avec elle celle de l’effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. Quelques pionniers comme Paul Ehrlich [biologiste notamment auteur de l'ouvrage La bombe P en 1968, qui met en garde contre les dangers de la surpopulation, ndlr] ou Dennis et Donella Meadows, co-auteurs du célèbre rapport au Club de Rome en 1972, résument par ce terme leurs inquiétudes quant à une possible rupture, un possible point de basculement se dessinant à l’horizon. Si Ehrlich insiste encore essentiellement sur la question démographique, les Meadows et leur équipe esquissent déjà une perspective plus systémique : le risque d’effondrement ne résulte pas seulement de la croissance démographique, mais aussi, voire surtout, de la croissance des consommations de ressources, des pollutions, de l’industrialisation, de l’artificialisation des espaces… Cela posait déjà un horizon, une perspective.
Cette perspective catastrophiste a perduré sous des formes diverses jusqu’à aujourd’hui. Elle a connu un certain reflux dans les années 1980 et 1990, une époque où l’enjeu écologique s’institutionnalise. Alors que la croissance verte et le développement durable s’imposent, les théories deviennent plus « continuistes », plus consensuelles et moins dissonantes que ce qu’on pouvait lire ou entendre auparavant. C’est seulement dans les années 2000 que les approches catastrophistes ont regagné en vigueur, dans des mouvements comme ceux de la décroissance en France ou des Transition Towns en Angleterre. Ces mouvements traduisent à ce moment-là une perte de confiance en la rhétorique rassurante du développement durable. Et aujourd’hui, cette désillusion paraît se diffuser plus largement. La collapsologie, de nos jours très débattue, n’est donc pas qu’une mode récente. Elle s’inscrit plutôt dans la lignée d’une inquiétude existentielle propre à l’écologie politique depuis ses origines : le déclin ou l’effondrement de la civilisation thermo-industrielle comme conséquence possible, probable ou certaine de la catastrophe écologique globale déjà amorcée.
Vous préférez parler de catastrophisme plutôt que de théorie de l’effondrement. Pourquoi ?
Le terme d’effondrement est intéressant, mais piégeur : il éveille beaucoup de mythes et de fantasmes. Il fait écho à une longue histoire intellectuelle, celle des réflexions sur la naissance et la mort des civilisations, et évoque des images hétéroclites allant la chute de Rome à Mad Max en passant par l’Ile de Pâques. Mais ces parallèles n’ont pas toujours beaucoup de sens selon moi. Je pense plutôt, comme l’historien John McNeill, que le caractère inédit de la situation limite la pertinence des comparaisons historiques. Le désastre qui s’amorce prend une forme radicalement nouvelle. Surtout, le terme d’effondrement fait penser à un évènement unique que l’on pourrait dater, alors qu’on a plutôt affaire à un processus, une trajectoire catastrophique : une longue série de contraintes matérielles croissantes et de seuils d’irréversibilité dont le cumul laisse présager une rupture plus grave, mais de nature difficile à préciser. Nous vivons « une » catastrophe qui est kaléidoscopique, mais aussi globale et irréversible, qui nous conduit vers un monde au climat réchauffé, aux ressources raréfiées, à la biodiversité appauvrie…

Mel Gibson, dans le décors post-apocalyptique de Mad max 2 (George Miller, 1982)
Les théories de l’effondrement s’enchâssent là-dedans. C’est ça finalement l’écologie politique : une conscience très forte des contraintes et de la finitude qui peuvent s’imposer ou qui vont s’imposer à nous. Mais l’écologie politique, c’est aussi la volonté d’agir en conséquence, à la fois pour limiter la casse et pour proposer d’autres pistes d’émancipation, d’autres aspirations collectives.
On reproche souvent aux « catastrophistes » un discours désengageant, démobilisateur. Ils seraient d’incurables pessimistes, auraient une fascination perverse pour le désastre. Or vous expliquez que le catastrophisme est plutôt un efficace levier de mobilisation démocratique. Pourquoi ?
Quand j’interroge des militants, peu sont positivement optimistes quant à l’avenir. C’est plutôt une forme d’inquiétude qui domine… Et pourtant ils s’engagent. C’est ce paradoxe-là qui m’intéresse en tant que chercheur. On dit que l’angoisse, la peur ou l’inquiétude sont démobilisatrices, mais cela me semble une idée reçue invalidée par le terrain, ou du moins à nuancer au regard du terrain. Depuis les années 1960-1970, la perspective catastrophiste fait partie de l’écologie politique, et donc les mobilisations écologistes sont confrontées à l’angoisse, l’inquiétude ou la peur. Et c’est de plus en plus vrai, à mesure que les horizons écologiques s’assombrissent. Dans les Transition Towns, l’idée centrale est de reconstruire la résilience locale afin d’encaisser le double choc du pic pétrolier et du réchauffement global sans sombrer dans le chaos : l’angoisse est là, ce serait absurde de le nier. Mais elle s’articule avec de la délibération débouchant sur des actions concrètes et positives – créer une monnaie locale, faire des jardins partagés, organiser des circuits courts, etc.
En fait, ce mouvement britannique des Transition Towns et le mouvement français de la décroissance ont été deux incarnations emblématiques de la perspective catastrophiste dans les années 2000. Et on y parlait déjà du risque d’effondrement. Mais loin d’être démobilisatrice, cette perspective a ouvert des espaces de délibération et a permis l’émergence de projets politiques, sans s’enfermer dans le simple constat fataliste que tout va s’effondrer. Alors aujourd’hui que les angoisses écologiques se radicalisent, que le développement durable n’est plus porteur d’espoir pour grand-monde et que la crainte de l’effondrement se diffuse, ce sont des mouvements comme ceux-là qui pourraient nous inspirer pour préparer l’après-pétrole et l’après-croissance.
Justement, à quoi pourrait ressembler aujourd’hui la transition écologique dans une perspective d’effondrement ?
Depuis ses débuts, l’écologie politique se projette vers l’avenir grâce à deux grands idéaux-types : la transition, qui implique tant bien que mal une dimension de maîtrise, et l’effondrement, qui serait un échec total de l’humanité. Mais notre marge de manœuvre se situe peut-être désormais entre les deux, dans une forme de « transition en catastrophe » : une transition qui serait engagée non par pure vertu ou par pure anticipation, car malheureusement il est trop tard pour ça, mais sous la pression des faits et des désastres. Et c’est vrai qu’aujourd’hui on peut avoir l’impression que les choses s’accélèrent, que la perspective catastrophiste devient moins marginale qu’avant, avec le succès de la collapsologie ou le dynamisme de mouvements comme Extinction Rébellion. Mais c’est ambigu : nous vivons aussi un moment curieux, où il semble plus facile de parler d’effondrement que de décroissance.

Illustration par © Eve Barlier
Dans ce contexte, je pense qu’il faudrait savoir parler d’effondrement, mais sans sombrer dans la sidération. La décroissance a cela d’intéressant qu’elle se conçoit depuis le départ comme une trajectoire en tension entre le destin et le projet. Le destin, c’est là où on n’a pas le choix : nous sortirons tôt ou tard des fossiles, d’une manière ou d’une autre, et c’est l’idée qui ressort par exemple des écrits de Georgescu-Roegen. Le projet, c’est la marge de manœuvre dont on dispose quand même : sortons-en de manière civilisée plutôt que barbare, selon les mots d’André Gorz. Car on peut encore construire un projet de décroissance, ou de descente énergétique créative, autour de notions comme la résilience, l’autonomie, la solidarité, la relocalisation, etc. Un projet écologiste plutôt classique donc, mais assez radical et bousculé par la pression des événements.
Vous insistez aussi sur la nécessité de répartir plus équitablement les efforts…
Pour que ce type de proposition puisse être audible, il faut en effet insister sur le caractère politique de la répartition des efforts qu’imposerait cette transition. La séquence politique des derniers mois en atteste. On ne peut pas espérer légitimer des taxes carbones qui pèsent sur tout le monde, notamment les plus pauvres, si dans le même temps on envoie des signaux tels que la suppression de l’ ISF. La transition ne peut être acceptable que si elle est perçue comme justifiée et équitable. Il me semble qu’elle est de plus en plus perçue comme justifiée. Mais elle n’est pas perçue comme équitable, ne serait-ce que parce que les hyper-riches échappent ostensiblement à tout effort de sobriété. Le paradoxe de la pensée catastrophiste, c’est qu’en faisant le deuil de la croissance infinie, elle renouvelle notre regard sur ce genre de problèmes, et nous aide à entrevoir ce que pourrait être une démocratie écologique dans un monde fini.
SUR LE MÊME SUJET :
> Un emballement catastrophique du climat possible dès 2°C de réchauffement
> Changement climatique : les 8 apocalypses à venir
> Rob Hopkins : « On ne sapera le capitalisme qu'en lui opposant une merveilleuse alternative »
> Qui sont vraiment les collapsologues ?
> « Qu’une société très injuste se casse la gueule, ça ne me dérange pas »
> L'effondrement, nouvelle religion de l'humanité ?
> « Une fois qu'un écosystème s'effondre, on ne peut plus revenir en arrière »
Image à la une : Luc Sémal, chercheur au Museum national d'histoire naturelle et au Centre d'écologie et des sciences de la conservation.
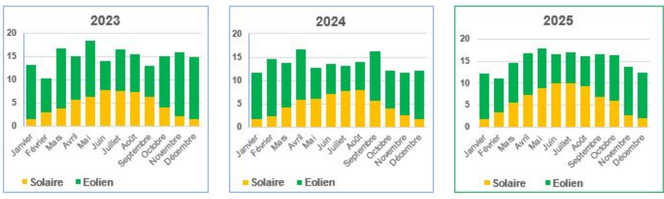
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire