Ce livre est une longue suite d'un entretien fictif avec François Bondy (avec son accord), ami d'enfance de l'auteur, narrant les années où Romain Gary servait dans les Forces françaises libres puis ses débuts dans la carrière diplomatique. Romain Gary est l'auteur qui pose les questions et qui apporte les réponses.
Annotations: php

Extrait
(...) «Je n'ai pas une goutte de sang français mais la France coule dans mes veines», aime rappeler Romain Gary.
Annotations: php

Extrait
(...) «Je n'ai pas une goutte de sang français mais la France coule dans mes veines», aime rappeler Romain Gary.
...Qui avait vingt ans, j'ai quitté la Carrière pour être libre, ensuite nous nous sommes mariés et nous avons eu un fils, nous vécu ensemble neuf ans».
«Je mettais rendu avec un ou deux collaborateurs, en expédition dans l'île du Soleil, au milieu du lac Titicaca. La Bolivie était alors, comme elle est encore aujourd'hui, en état de révolte chronique. C'étaient les grandes années de Lechin (1), chef syndicaliste des mineurs boliviens qui se baladaient avec des bâtons de dynamite enfoncés sous la ceinture. Par mesure de sécurité, la circulation était interdite la nuit sur toutes les routes. Nous prenons le bac et nous arrivons dans l'île du Soleil. Il faisait très chaud et j'avais soif. Je prends une bouteille de bière, je fais sauter la capsule et je bois au goulot… Je sens une déchirure dans la gorge, et en regardant le goulot de la bouteille, je m'aperçois que celui-ci s'est fendu et que j'en avais avalé la moitié, deux centimètres et demi de verre pointu. C'était la perforation intestinale garantie sur facture. Il n'y avait pas de téléphone et il n'y avait pas les moyens de quitter l'île pendant douze heures, avant le rétablissement de la circulation et des communications, le lendemain matin. Un de mes collaborateur me regarde et me dit : «Merde, c'est dommage pour le Goncourt.» Je m'assieds par terre, pas tellement content et j'attends les premières douleurs pendant que le guide bolivien se marre par politesse, parce que c'était le genre de gars que la mort faisait rigoler, c'était nerveux chez lui. Finalement, le restaurateur de l'endroit suggère une solution : il y a dans l'île une sorcière célèbre par ses guérisons miraculeuses. Je dis, va pour la sorcière. On m'amène alors une créature incroyable, vieille et ricanant, malodorante, et qui m'a tout de suite inspiré confiance parce qu'elle avait une si sale gueule qu'il était en effet évident qu'elle avait de bons rapports de cousinage avec le Destin. Elle s'en va et elle revient avec deux kilos de mie de pain et une bouteille d'huile absolument ignoble et m'invite à avaler le tout et ce fut atroce mais je me suis tapé consciencieusement les deux kilos de mie de pain fraîche et la bouteille d'huile et je me suis couché, en essayant de ne pas dégueuler et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, des fois que je n'aurais pas le Goncourt. Je n'ai pas eu les moindres douleurs et lorsque je suis rentré à La Paz, à l'hôpital, on m'a retiré le verre sans trop de dégâts, entouré d'une sorte de pâte protectrice faite d'huile et de mie de pain. Comme quoi, il ne faut pas cracher sur les sorcières. Quelques jours plus tard, les journaux boliviens annonçaient en première page : «Premio Goncourt aqui», le prix Goncourt ici, donnant ensuite la nouvelle proprement dite en petits caractères à l'intérieur».
«Au retour de Los Angeles, j'ai eu droit à une belle compensation. De Gaulle m'avait invité à déjeuner —il y avait là trois ou quatre personnages, si on veut des témoins… Le général me demande : «Qu'est-ce que vous comptez faire à présent, Romain Gary?» Je réponds que je suis au frigidaire : c'est ainsi qu'on appelle au Quai les diplomates sans affectation. Et il me dit : «Voulez-vous travailler avec moi?» Il n'a mentionné aucune fonction précise mais le seul poste disponible auprès de lui à ce moment-là était celui de conseiller diplomatique. Bon, le poste de conseiller diplomatique du général de Gaulle, ça fait énorme, vu de l'extérieur, mais en réalité, c'était sans contenu, de Gaulle avait à peu près autant besoin d'un conseiller diplomatique que la Suisse d'un supplément de montagnes. Au moment où j'ai répondu, il, était trop tard, parce que j'avais l'air d'avoir réfléchi quelques secondes, et c'était impensable. C'était déjà perdu… Un poste de conseiller auprès de de Gaulle, c'était la certitude d'une carrière faite. Et pour un amateur de la nature humaine, quel poste d'observation! Et puis, pouvoir parler avec le vieux à peu près tous les jours… J'ai répondu : «Mon général, je veux écrire…» J'en ai été malade pendant plusieurs jours».
«En mai 1974, j'aurai soixante ans. Et mon avenir se présente. C'est tout. Mes histoires posthumes ne m'intéressent pas. D'ailleurs, je ne risque rien. Je connais un truc. Le jour où je ne pourrais plus faire l'amour aux femmes, je leur gratterai le dos. Elles adorent ça. Toute ma vie, j'ai entendu : Gratte-moi le dos.» Alors, quand tout le reste sera parti, je leur gratterai le dos».
«Mon éditeur américain et Gallimard m'ont garanti une rente, quelque soit la vente de mes livres, je ne suis pas obligé de publier, en ce sens que je peux mettre mes manuscrits de côté pour les publications posthumes. J'ai complété ça par le journalisme et le cinéma. Pendant quelques années, j'ai beaucoup écrit dans les journaux et hebdomadaires américains, et je continue, mais moins. J'ai eu pendant deux ans un billet d'avion en blanc, tous azimuts, me permettant de courir n'importe où lorsqu'il y avait urgence, c'est-à-dire lorsque j'avais l'impression que j'étais ailleurs. J'écris ou je dicte sept heures par jour dans n'importe quelles conditions et n'importe où, je ne pourrais pas supporter le monde sans ça. Évidemment, j'éprouve le besoin de revenir de temps en temps, avoir quelques habitudes, quelques bistrots où je peux me situer dans une petite continuité quotidienne, m'asseoir. Mais ça me reprend aussitôt, et lorsque j'appelle Lantz, qui, me représente à New York, il me demande : «Où voulez-vous courir?», et il me trouve toujours un reportage, un récit à faire, souvent dans les quarante-huit heures. J'ai fait aussi de la chirurgie de scénario. J'ai cavalé une fois au Kenya pour refaire en trois jours un scénario qui avait été écrit pour la Norvège en hiver. Parfois, on m'appelait au dernier moment, alors qu'ils étaient déjà à mi-film, et qu'ils découvraient soudain un trou, une vraie connerie, et c'était très bien payé pour quelques jours de travail. Un jour, le nouveau directeur du moment d'un grand journal français m'invite à causer. Il me propose de refaire un grand reportage, un vrai truc, avec ma peau à l'appui. On parle frais, et on me propose des miettes. Et le patron en question de conclusion : «Pour vous, les reportages, n'est-ce-pas, ce sont des vacances?... Un homme charmant. D'ailleurs, nous nous sommes quittés très poliment. Heureusement, il y a Lantz à New York. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Il y a cinq ans, j'ai été malade, j'ai cru que j'allais crever, alors j'ai voulu revoir les éléphants en Afrique. Je lui télégraphie. Dix jours après, je recevais de Ralph Graves, le patron de Life, une commande pour un grand papier… sur les éléphants. Je ne sais pas ce que je ferais sans Robert Lantz, c'est mon père et ma mère».
«La paix de l'esprit, ça ne m'intéresse pas du tout, la sérénité, le détachement, la communion avec l'univers, je ne vois pas ce que ça peut offrir à un homme qui a toujours aimé ici. La tranquillité… Je serai assez tranquille quand je serais mort, c'est fait pour ça… J'avais un pilote dans mon escadrille, Bordier. Quand il mettait ses gants, avant de monter en avion, il regardait le ciel, les étoiles, puis il disait, avec satisfaction : «La nuit sera calme.» On revenait chaque fois en morceaux, après avoir perdu des équipages, mais il répétait toujours, très content, derrière sa petite moustache : «La nuit sera calme.» Et puis, il n'est pas revenu, lui non plus… Je crois que c'était un type qui rêvait de tranquillité… Ça m'arrive, évidemment, ça m'arrive…».
«L'île Maurice, c'est le Club Méditerranée habituel, même là où il n'y en a pas, c'est toujours le même «paradis tropical», des Caraïbes à Tahiti, un mélange de Noirs, d'Indiens, de Chinois et de cocotiers. Coraux, mer émeraude, sables blancs, du charter, quoi. C'était la veille de mon départ. Je logeais dans-tout-ce-qu'il-y-a-de-bien, avec bungalow au clair de lune, hôtesses de l'air grand charme, en escale, romance des îles grand format, toute la crème chantilly exotique. Au bout de l'allée qui menait à mon bungalow il y avait des taxis pour les clients du palace. La veille de mon départ, je laisse ma voiture dans le parc, je me dirige vers mon bungalow, et je vois une silhouette qui s'approche de moi dans le noir. C'était un des chauffeurs, un Indien obèse, avec des fesses comme deux immenses sacs à merde, inouï, il devait être une curiosité locale. Il me demande si je veux une fille «qui fait tout». Je dis non. «J'en ai une de seize ans», me glisse-t-il. J'ai dit non merci. J'allais passer lorsque le chauffeur me lance : «J'en ai une de dix ans. Une petite de dix ans, mais bien dressée, un vrai petit singe, a little monkey.» Je m'arrête. Ça devient intéressant. Je partais le lendemain, ayant raté complètement mon reportage et voilà que je touchais enfin le fond de la couleur locale. J'ai dit oui. On pouvait voir? Il m'a montré ses dents dans un sourire clair de lune. Fier, de bien connaître les hommes. Oui, on pouvait voir, on pouvait tout ah!-ah!-ah! Mais il fallait aller chez les parents, et déjà il me mettait le bras sur l'épaule, familièrement, entre frères salauds. On est monté dans son taxi et on y est allés. […]. Je savais que je ne pouvais rien tirer de la petite, qui était trop jeune pour parler vraiment, j'ai donc dis que je prenais les deux, l'aînée et la cadette. J'ai payé d'avance et le chauffeur nous a ramené tous les trois dans mon bungalow. […]. J'ai expliqué à l'aînée qui j'étais, et pourquoi je les avais fait venir, elle ne s'est plus arrêtée de parler jusqu'à trois heures du matin. Évidemment, les parents n'étaient pas des parents, les mômes n'étaient pas des sœurs, elle m'a expliqué que ça enchantait les clients, ça, d'imaginer que c'était deux sœurs qui faisaient ça entre elles. […]. Mais ce qu'il y avait de bouleversant, d'effrayant, c'était l'isolement et l'ignorance. Exemple : je dis à la môme que je suis français. Français? Elle a eu un sourire radieux. Alors vous pouvez m'obtenir un visa pour … la Chine? Oui, pour la Chine. Et c'est là que je suis entré dans le désespoir. Car cette môme-là était Mao, et ce n'était même pas de la politique. Elle imaginait qu'en Chine on pouvait vivre sans travailler et être payé par l'État pour être heureux. Elle me l'a expliqué en détail, avec du rêve plein les yeux, assise dans mon bungalow, pendant que sa «sœur», dix ans, écoutait le transistor, après s'être fait depuis un an en moyenne de trois ou quatre Sud-Africains et Australiens par soirée. […]. Ce qu'il y avait de déchirant, d'irrésistible, c'était le rêve —et le besoin de savoir. Et c'est là que je suis rentré dans le Roman. Parce que, en présence de cette fille, de ce rêve, de cette sommation, pour répondre à ses questions, pendant trois heures, je me suis vu transformé en maoïste. Pendant trois heures, je lui ai donné à croire, à boire et à manger. […]. Il y avait devant moi une fille qui avait du rêve plein les yeux, et rien d'autre, aucun autre espoir, aucune possibilité de s'en sortir, l'abandon total. Détruire ce rêve, c'était encore pire que de prendre les deux «sœurs» et «allez, toi ça, et toi ça». Et c'est ainsi que, vers trois ou quatre heures du matin, j'ai été invité à assister le lendemain à la réunion d'une «cellule maoïste» dans la brousse. […]. Je me suis assis sur l'autel, sous l'étoile, et ils se sont accroupis autour de moi, et pendant deux heures, j'ai répondu à leurs questions sur Mao, j'ai fait de mon mieux. Je leur ai donné à espérer. Sans cynisme, sans double jeu, sans ironie. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas un mot de ce que je disais, ils ne possédaient pas l'abc politique nécessaire. Ils écoutaient la musique, c'est tout. Une mélodie d'espoir. […]. Je me souvenais du chauffeur qui m'avait offert la fillette de dix ans. J'ai acheté une planche de contre-plaqué et des clous très minces, d'un centimètre et demi de longueur. Le soir, je suis allé dans l'allée des taxis pendant que les chauffeurs faisaient causette dans les cuisines du palace. J'ai mis ma planchette sur le siège du salaud, la pointe des clous vers le ciel, vers Dieu et la justice, là où il n'y a ni l'un ni l'autre. Puis je suis rentré dans mon bungalow à cent mètres de là. Je me suis couché, laissant la porte ouverte, et j'ai attendu le bonheur. Quand le sac à merde c'est posé de tout son poids sur les clous, il a poussé de tels hurlements que… enfin, c'était pour moi la paix de l'esprit, la béatitude, la sérénité, quoi, une sorte de sainteté même. […]. Il faut avoir vingt clous s'enfonçant jusqu'à la tête dans ta crudité pour mettre comme il avait fait, ce salopard, toute son âme dans sa voix…».
«Je mettais rendu avec un ou deux collaborateurs, en expédition dans l'île du Soleil, au milieu du lac Titicaca. La Bolivie était alors, comme elle est encore aujourd'hui, en état de révolte chronique. C'étaient les grandes années de Lechin (1), chef syndicaliste des mineurs boliviens qui se baladaient avec des bâtons de dynamite enfoncés sous la ceinture. Par mesure de sécurité, la circulation était interdite la nuit sur toutes les routes. Nous prenons le bac et nous arrivons dans l'île du Soleil. Il faisait très chaud et j'avais soif. Je prends une bouteille de bière, je fais sauter la capsule et je bois au goulot… Je sens une déchirure dans la gorge, et en regardant le goulot de la bouteille, je m'aperçois que celui-ci s'est fendu et que j'en avais avalé la moitié, deux centimètres et demi de verre pointu. C'était la perforation intestinale garantie sur facture. Il n'y avait pas de téléphone et il n'y avait pas les moyens de quitter l'île pendant douze heures, avant le rétablissement de la circulation et des communications, le lendemain matin. Un de mes collaborateur me regarde et me dit : «Merde, c'est dommage pour le Goncourt.» Je m'assieds par terre, pas tellement content et j'attends les premières douleurs pendant que le guide bolivien se marre par politesse, parce que c'était le genre de gars que la mort faisait rigoler, c'était nerveux chez lui. Finalement, le restaurateur de l'endroit suggère une solution : il y a dans l'île une sorcière célèbre par ses guérisons miraculeuses. Je dis, va pour la sorcière. On m'amène alors une créature incroyable, vieille et ricanant, malodorante, et qui m'a tout de suite inspiré confiance parce qu'elle avait une si sale gueule qu'il était en effet évident qu'elle avait de bons rapports de cousinage avec le Destin. Elle s'en va et elle revient avec deux kilos de mie de pain et une bouteille d'huile absolument ignoble et m'invite à avaler le tout et ce fut atroce mais je me suis tapé consciencieusement les deux kilos de mie de pain fraîche et la bouteille d'huile et je me suis couché, en essayant de ne pas dégueuler et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, des fois que je n'aurais pas le Goncourt. Je n'ai pas eu les moindres douleurs et lorsque je suis rentré à La Paz, à l'hôpital, on m'a retiré le verre sans trop de dégâts, entouré d'une sorte de pâte protectrice faite d'huile et de mie de pain. Comme quoi, il ne faut pas cracher sur les sorcières. Quelques jours plus tard, les journaux boliviens annonçaient en première page : «Premio Goncourt aqui», le prix Goncourt ici, donnant ensuite la nouvelle proprement dite en petits caractères à l'intérieur».
«Au retour de Los Angeles, j'ai eu droit à une belle compensation. De Gaulle m'avait invité à déjeuner —il y avait là trois ou quatre personnages, si on veut des témoins… Le général me demande : «Qu'est-ce que vous comptez faire à présent, Romain Gary?» Je réponds que je suis au frigidaire : c'est ainsi qu'on appelle au Quai les diplomates sans affectation. Et il me dit : «Voulez-vous travailler avec moi?» Il n'a mentionné aucune fonction précise mais le seul poste disponible auprès de lui à ce moment-là était celui de conseiller diplomatique. Bon, le poste de conseiller diplomatique du général de Gaulle, ça fait énorme, vu de l'extérieur, mais en réalité, c'était sans contenu, de Gaulle avait à peu près autant besoin d'un conseiller diplomatique que la Suisse d'un supplément de montagnes. Au moment où j'ai répondu, il, était trop tard, parce que j'avais l'air d'avoir réfléchi quelques secondes, et c'était impensable. C'était déjà perdu… Un poste de conseiller auprès de de Gaulle, c'était la certitude d'une carrière faite. Et pour un amateur de la nature humaine, quel poste d'observation! Et puis, pouvoir parler avec le vieux à peu près tous les jours… J'ai répondu : «Mon général, je veux écrire…» J'en ai été malade pendant plusieurs jours».
«En mai 1974, j'aurai soixante ans. Et mon avenir se présente. C'est tout. Mes histoires posthumes ne m'intéressent pas. D'ailleurs, je ne risque rien. Je connais un truc. Le jour où je ne pourrais plus faire l'amour aux femmes, je leur gratterai le dos. Elles adorent ça. Toute ma vie, j'ai entendu : Gratte-moi le dos.» Alors, quand tout le reste sera parti, je leur gratterai le dos».
«Mon éditeur américain et Gallimard m'ont garanti une rente, quelque soit la vente de mes livres, je ne suis pas obligé de publier, en ce sens que je peux mettre mes manuscrits de côté pour les publications posthumes. J'ai complété ça par le journalisme et le cinéma. Pendant quelques années, j'ai beaucoup écrit dans les journaux et hebdomadaires américains, et je continue, mais moins. J'ai eu pendant deux ans un billet d'avion en blanc, tous azimuts, me permettant de courir n'importe où lorsqu'il y avait urgence, c'est-à-dire lorsque j'avais l'impression que j'étais ailleurs. J'écris ou je dicte sept heures par jour dans n'importe quelles conditions et n'importe où, je ne pourrais pas supporter le monde sans ça. Évidemment, j'éprouve le besoin de revenir de temps en temps, avoir quelques habitudes, quelques bistrots où je peux me situer dans une petite continuité quotidienne, m'asseoir. Mais ça me reprend aussitôt, et lorsque j'appelle Lantz, qui, me représente à New York, il me demande : «Où voulez-vous courir?», et il me trouve toujours un reportage, un récit à faire, souvent dans les quarante-huit heures. J'ai fait aussi de la chirurgie de scénario. J'ai cavalé une fois au Kenya pour refaire en trois jours un scénario qui avait été écrit pour la Norvège en hiver. Parfois, on m'appelait au dernier moment, alors qu'ils étaient déjà à mi-film, et qu'ils découvraient soudain un trou, une vraie connerie, et c'était très bien payé pour quelques jours de travail. Un jour, le nouveau directeur du moment d'un grand journal français m'invite à causer. Il me propose de refaire un grand reportage, un vrai truc, avec ma peau à l'appui. On parle frais, et on me propose des miettes. Et le patron en question de conclusion : «Pour vous, les reportages, n'est-ce-pas, ce sont des vacances?... Un homme charmant. D'ailleurs, nous nous sommes quittés très poliment. Heureusement, il y a Lantz à New York. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Il y a cinq ans, j'ai été malade, j'ai cru que j'allais crever, alors j'ai voulu revoir les éléphants en Afrique. Je lui télégraphie. Dix jours après, je recevais de Ralph Graves, le patron de Life, une commande pour un grand papier… sur les éléphants. Je ne sais pas ce que je ferais sans Robert Lantz, c'est mon père et ma mère».
«La paix de l'esprit, ça ne m'intéresse pas du tout, la sérénité, le détachement, la communion avec l'univers, je ne vois pas ce que ça peut offrir à un homme qui a toujours aimé ici. La tranquillité… Je serai assez tranquille quand je serais mort, c'est fait pour ça… J'avais un pilote dans mon escadrille, Bordier. Quand il mettait ses gants, avant de monter en avion, il regardait le ciel, les étoiles, puis il disait, avec satisfaction : «La nuit sera calme.» On revenait chaque fois en morceaux, après avoir perdu des équipages, mais il répétait toujours, très content, derrière sa petite moustache : «La nuit sera calme.» Et puis, il n'est pas revenu, lui non plus… Je crois que c'était un type qui rêvait de tranquillité… Ça m'arrive, évidemment, ça m'arrive…».
«L'île Maurice, c'est le Club Méditerranée habituel, même là où il n'y en a pas, c'est toujours le même «paradis tropical», des Caraïbes à Tahiti, un mélange de Noirs, d'Indiens, de Chinois et de cocotiers. Coraux, mer émeraude, sables blancs, du charter, quoi. C'était la veille de mon départ. Je logeais dans-tout-ce-qu'il-y-a-de-bien, avec bungalow au clair de lune, hôtesses de l'air grand charme, en escale, romance des îles grand format, toute la crème chantilly exotique. Au bout de l'allée qui menait à mon bungalow il y avait des taxis pour les clients du palace. La veille de mon départ, je laisse ma voiture dans le parc, je me dirige vers mon bungalow, et je vois une silhouette qui s'approche de moi dans le noir. C'était un des chauffeurs, un Indien obèse, avec des fesses comme deux immenses sacs à merde, inouï, il devait être une curiosité locale. Il me demande si je veux une fille «qui fait tout». Je dis non. «J'en ai une de seize ans», me glisse-t-il. J'ai dit non merci. J'allais passer lorsque le chauffeur me lance : «J'en ai une de dix ans. Une petite de dix ans, mais bien dressée, un vrai petit singe, a little monkey.» Je m'arrête. Ça devient intéressant. Je partais le lendemain, ayant raté complètement mon reportage et voilà que je touchais enfin le fond de la couleur locale. J'ai dit oui. On pouvait voir? Il m'a montré ses dents dans un sourire clair de lune. Fier, de bien connaître les hommes. Oui, on pouvait voir, on pouvait tout ah!-ah!-ah! Mais il fallait aller chez les parents, et déjà il me mettait le bras sur l'épaule, familièrement, entre frères salauds. On est monté dans son taxi et on y est allés. […]. Je savais que je ne pouvais rien tirer de la petite, qui était trop jeune pour parler vraiment, j'ai donc dis que je prenais les deux, l'aînée et la cadette. J'ai payé d'avance et le chauffeur nous a ramené tous les trois dans mon bungalow. […]. J'ai expliqué à l'aînée qui j'étais, et pourquoi je les avais fait venir, elle ne s'est plus arrêtée de parler jusqu'à trois heures du matin. Évidemment, les parents n'étaient pas des parents, les mômes n'étaient pas des sœurs, elle m'a expliqué que ça enchantait les clients, ça, d'imaginer que c'était deux sœurs qui faisaient ça entre elles. […]. Mais ce qu'il y avait de bouleversant, d'effrayant, c'était l'isolement et l'ignorance. Exemple : je dis à la môme que je suis français. Français? Elle a eu un sourire radieux. Alors vous pouvez m'obtenir un visa pour … la Chine? Oui, pour la Chine. Et c'est là que je suis entré dans le désespoir. Car cette môme-là était Mao, et ce n'était même pas de la politique. Elle imaginait qu'en Chine on pouvait vivre sans travailler et être payé par l'État pour être heureux. Elle me l'a expliqué en détail, avec du rêve plein les yeux, assise dans mon bungalow, pendant que sa «sœur», dix ans, écoutait le transistor, après s'être fait depuis un an en moyenne de trois ou quatre Sud-Africains et Australiens par soirée. […]. Ce qu'il y avait de déchirant, d'irrésistible, c'était le rêve —et le besoin de savoir. Et c'est là que je suis rentré dans le Roman. Parce que, en présence de cette fille, de ce rêve, de cette sommation, pour répondre à ses questions, pendant trois heures, je me suis vu transformé en maoïste. Pendant trois heures, je lui ai donné à croire, à boire et à manger. […]. Il y avait devant moi une fille qui avait du rêve plein les yeux, et rien d'autre, aucun autre espoir, aucune possibilité de s'en sortir, l'abandon total. Détruire ce rêve, c'était encore pire que de prendre les deux «sœurs» et «allez, toi ça, et toi ça». Et c'est ainsi que, vers trois ou quatre heures du matin, j'ai été invité à assister le lendemain à la réunion d'une «cellule maoïste» dans la brousse. […]. Je me suis assis sur l'autel, sous l'étoile, et ils se sont accroupis autour de moi, et pendant deux heures, j'ai répondu à leurs questions sur Mao, j'ai fait de mon mieux. Je leur ai donné à espérer. Sans cynisme, sans double jeu, sans ironie. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas un mot de ce que je disais, ils ne possédaient pas l'abc politique nécessaire. Ils écoutaient la musique, c'est tout. Une mélodie d'espoir. […]. Je me souvenais du chauffeur qui m'avait offert la fillette de dix ans. J'ai acheté une planche de contre-plaqué et des clous très minces, d'un centimètre et demi de longueur. Le soir, je suis allé dans l'allée des taxis pendant que les chauffeurs faisaient causette dans les cuisines du palace. J'ai mis ma planchette sur le siège du salaud, la pointe des clous vers le ciel, vers Dieu et la justice, là où il n'y a ni l'un ni l'autre. Puis je suis rentré dans mon bungalow à cent mètres de là. Je me suis couché, laissant la porte ouverte, et j'ai attendu le bonheur. Quand le sac à merde c'est posé de tout son poids sur les clous, il a poussé de tels hurlements que… enfin, c'était pour moi la paix de l'esprit, la béatitude, la sérénité, quoi, une sorte de sainteté même. […]. Il faut avoir vingt clous s'enfonçant jusqu'à la tête dans ta crudité pour mettre comme il avait fait, ce salopard, toute son âme dans sa voix…».
A suivre...
Notes
1. Juan Lechin Oquendo, né le 18 mai 1914 à Corocoro et mort le 27 août 2001 à La Paz. Chef syndical et secrétaire général de la Fédération Syndicale de Travailleurs Miniers de la Bolivie (FSTMB) de 1944 à 1987 et de la Centrale Ouvrière bolivienne (COV) de 1952 à 1987. Entre 1960 et 1964 a été Vice-président de Bolivia.
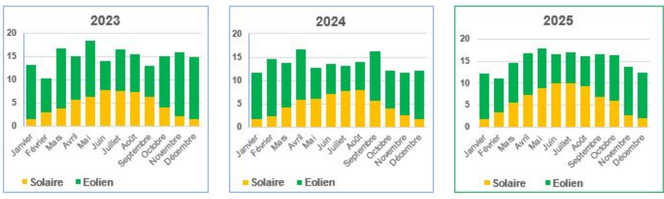
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire