avec le concours de Thierry Gaubert
5 octobre 2017
« Le mot “sécurité” arrête la communication des êtres, des espaces et des expériences »
Jef Klak s’efforce de faire se côtoyer des réalités hétérogènes. Comme ce 11 avril 2017, quand le collectif de la revue a invité le philosophe Jacques Rancière à s’exprimer après une lecture-théâtre parlant du Cortège de tête 1 durant les manifestations contre la loi Travail de 2016. Au cours de cette soirée dans l’institutionnel lieu culturel de La Gaîté Lyrique à Paris, des personnes bloquées à l’entrée par les vigiles et l’administration du lieu ont interrompu les discussions. Celles et ceux à l’intérieur sont intervenu.es pour faire rentrer une partie du public restée aux portes. Non sans esclandre. Voici donc les paroles de Jacques Rancière ce soir-là, répondant aux questions préparées par Jef Klak, et improvisant face à celles posées par la situation.
Télécharger l’article en PDF.
Votre pensée s’articule autour d’images que vous nommez « scènes » ; pourriez-vous définir ce que vous entendez par là ? Qu’est-ce qu’une « scène politique », que vous appelez aussi « scène du peuple » ? Qu’est-ce qu’une « scène esthétique » ? Et selon vous, quelles scènes sont apparues lors du mouvement du printemps dernier « contre la loi Travail et son monde » ?
Une « scène », c’est un moment qu’on essaie de découper, avec l’idée qu’il porte son sens en lui-même. C’est-à-dire qu’on isole un moment : on ne cherche plus à expliquer qu’il est arrivé ceci parce qu’on est à tel moment de l’histoire du capital, de l’histoire de l’État, etc. On essaie d’isoler des moments significatifs dans lesquels on estime que l’on n’a pas besoin d’aller chercher ailleurs, qu’ils portent en eux-mêmes le principe de leur intelligibilité.
Ce que j’ai toujours essayé de faire, c’est d’isoler des moments. J’ai travaillé à une époque sur un livre qui s’appelle La Nuit des prolétaires 2. Normalement, on explique que l’émancipation ouvrière passe par la grande industrie, telle ou telle forme de développement du capital, et ainsi de suite. J’ai essayé de dire que cela passe finalement par des moments singuliers. Par exemple quand, au lieu d’alterner normalement travail et repos, des gens ne vont pas dormir et consacrent leur nuit à se rencontrer, à discuter, à écrire, à tout ce qu’on veut…
Ce que j’ai appelé « scène esthétique », c’est aussi cela : tout d’un coup, il y a quelque chose qui change dans ce qu’on définit comme art. Des choses qui n’étaient pas de l’art le deviennent. Il y a des événements qui instituent à la fois un moment et une forme d’individualité différente. C’est un peu la méthode Jacotot 3 de l’émancipation intellectuelle : on part d’un petit point et on essaie de voir ce qui peut se construire à partir de là. Ce petit point, ça peut être quelque chose de visible, comme un affrontement dans la rue, ou bien des gens qui, au lieu de partir en manif, décident de s’arrêter et d’occuper une place.
Ça peut partir de presque rien… Cela peut même, en un sens, ne pas être une scène réelle : ça peut être un ouvrier-menuisier qui correspond avec un intellectuel saint-simonien et lui met un petit mot pour lui dire : « Le temps ne m’appartient pas, mais demain, si tu te trouvais Place de la Bourse entre deux heures et deux heures et demie, nous nous verrions comme les ombres misérables des bords de l’enfer 4. » En un sens, ce n’est rien, mais ça dit tout. Ceux qui ont le temps, ceux qui n’ont pas le temps : comment est-ce qu’au bord de la place de la Bourse, on trouve le temps, non de s’enfermer dans les grandes explications sur la dynamique du capital, mais de voir comment des rencontres sont possibles ou pas. C’est un peu cela dont il est question aujourd’hui. Simplement, ce qui est important, c’est qu’une scène, ce n’est pas quelque chose d’instantané, il ne suffit pas de prendre un cliché. Pour illustrer Mai-68, on voit toujours la passionaria sur les épaules d’un copain. Mais qu’est-ce que cette photo dit au juste ? Qu’est-ce qu’on dit de Mai-68 en montrant cet instantané ?
Dans la lecture de Cortège de tête qui vient d’être faite, il y a cette histoire du gars qui se construit un bouclier pour se protéger des policiers pendant les manifs. « Les flics en portent bien, eux aussi. Donc, pourquoi pas moi ? Je me bricole mon bouclier. Et ce bouclier, dit le manifestant, ça m’a servi à faire des rencontres. » On n’a pas l’impression que le bouclier ait jamais servi à quelque action militaire. Ça, ça peut être une scène. Ce qui est tenté dans Cortège de tête, c’est de construire des scènes pour montrer rétrospectivement ce qui s’est passé pendant le mouvement social, et qu’on n’avait pas forcément vu.
Le mouvement contre la loi Travail a montré la difficulté des centrales syndicales à contrôler les manifestations comme elles l’entendaient. Elles étaient en général débordées, à l’avant, par ce qu’on appelait les « cortèges de tête ». Pour autant, ces mêmes institutions ont continué à donner le tempo de la mobilisation. Ainsi, le fait qu’elles ne convoquent pas de nouvelles manifestations après celles du 15 septembre 2016 a pour ainsi dire sonné la fin du mouvement. Dans un entretien à Mediapart.fr 5 à propos de Nuit Debout, vous disiez : « Le fond du problème, c’est qu’il faut imaginer des formes de vie politiques qui à la fois soient entièrement hétérogènes par rapport à cette vie politique officielle, entièrement confisquée par une classe de professionnels qui se reproduit indéfiniment, et pourtant être capable de l’affronter selon leurs propres formes et leur agenda propre. » Un an après ; lors des élections présidentielles, avez-vous repéré des initiatives qui pourraient ressembler à ce que vous appelez de vos vœux ?
Je n’aime pas être mis dans la position de dire ce qui est bien, ce qui n’est pas bien, ce qu’il aurait fallu faire ou ne pas faire. Donc, je ne vais pas commencer maintenant. Je préfère prendre les choses d’un peu loin. La loi Travail, c’est quoi ? C’est une loi qui dit : le travail, désormais, ce sera un truc que chacun gérera à sa façon. C’est-à-dire que le travail ne sera au fond qu’une forme d’existence individuelle. Jusqu’ici, le travail était une chose collective et non individuelle, et cela pesait dans l’existence d’un mouvement révolutionnaire. Les syndicats sont en quelque sorte les héritiers de cette histoire-là.
En même temps, une tension apparaît, il y a un cortège qui dit : « On en a marre, on ne veut plus défiler derrière les syndicats, derrière les sonos, c’est pas beau, ça sert à rien. » Et ce cortège de tête s’impose en brisant la tradition des services d’ordre. Ce n’est pas une nouveauté dans l’absolu, parce qu’après tout, des bagarres pour savoir qui va marcher en tête dans les manifs, il y en avait déjà en 1968. La nouveauté, c’est que ça s’est nommé « cortège de tête ». Je ne pense pas que cette idée existait avant. Tout d’un coup, il y a quelque chose comme une bascule : sur un terrain de lutte qui normalement était le terrain des syndicats, il y a un groupe qui se désigne par le fait qu’il est là, qu’il se place en tête, qu’il met ses gestes et son action en tête.
Il y a comme une bipolarité : d’un côté, des gens qui ont une certaine légitimité – en quelque sorte historique, institutionnelle –, et de l’autre côté, des gens qui passent devant, qui leur marchent sur les pieds. Ça veut dire aussi qu’on est dans une sorte de rapport, qu’on connaît bien, de parasitisme. Les syndicats mènent toujours la danse, mais ne sont plus en tête de cortège.
Depuis qu’il n’y a plus ce gros sujet collectif qu’était le mouvement ouvrier, on est toujours à la recherche des manières de constituer une force autonome qui ne soit plus une force sociale constituée, mais qui se constitue à partir d’une série de gestes, de manières de se mettre ensemble : une assemblée sur une place, des gens qui décident qu’on va taper sur quelques vitrines ou bien sur la police. Il y a toujours ce rêve que le mouvement soit autonome, qu’il ne soit pas une sorte de parasite ou d’avant-garde de terrain, et qu’il puisse définir ses objectifs propres. Ainsi du rapport entre le mouvement contre la loi Travail et Nuit Debout : est-ce qu’on va constituer autre chose qu’un parti politique destiné à récolter 1,5 % de suffrages aux élections ; réussira-t-on à créer un mouvement de sécession ? Peut-on considérer le camp de la révolte comme un camp sécessionniste : est-ce qu’on va créer des communes autogérées ou bien un parti de type Podemos et compagnie ? Cette question n’a pas encore été résolue, et ce n’est pas moi qui la résoudrai.
Ce qui aurait été amusant, c’est que le mouvement Nuit Debout devienne un mouvement anti-élections. Ça n’a pas eu lieu, et il y a même un certain nombre de thèmes dans l’air du printemps dernier qui deviennent des éléments de programme. On voit bien que dans l’effervescence électorale il y a une forme d’appropriation de choses un peu radicales : VIe République, Constituante, disparition de la fonction présidentielle… Mais si cela peut être repris dans une logique interne au système, c’est parce qu’on manque de logique d’affrontement autour de ces thèmes.
Dans La Haine de la démocratie 6, vous écrivez : « La démocratie n’est ni une société à gouverner, ni un gouvernement de la société, elle est proprement cet ingouvernable sur quoi tout gouvernement doit en définitive se découvrir fondé. » Un des slogans du mouvement contre la loi Travail a été « Soyons ingouvernables » : c’était une des banderoles du cortège de tête parisien, et elle a même été traduite dans les manifestations aux États-Unis suite à l’élection de Donald Trump. Est-ce que cela fait de ceux qui se reconnaissent dans ce mot d’ordre des démocrates types ?
Ce qui m’intéressait, c’était de redéfinir ce qu’est la démocratie : ce n’est pas le fait que tout le monde vote, ce n’est pas le fait qu’il y ait une majorité de votants qui décide. À l’origine, ce n’est même pas une forme spéciale de gouvernement ou bien, comme certains disent, une forme de société permissive dans laquelle tout le monde fait ce qu’il veut. À l’origine, la démocratie est quelque chose d’étrange : le gouvernement de ceux qui ne sont pas qualifiés pour gouverner. Normalement, on doit gouverner si on est plus savant que les autres, plus riche, plus vieux, plus fort, plus près de la parole divine que les autres, ou que sais-je encore ? La démocratie s’est inventée comme une espèce de gouvernement paradoxal, où ceux qui n’ont pas de supériorité définie ont véritablement le pouvoir. La démocratie, ce n’est pas des gens qui vous disent : « Il vaut mieux voter Macron pour battre Le Pen ou Mélenchon pour battre Macron, etc. » Voici quelque chose qu’il faut sans cesse rappeler. La question n’est donc pas tant d’être ingouvernable, mais de gouverner en tant que ceux qui n’ont pas de capacité à gouverner, et qui ne sont pas nés pour gouverner.
Dans le slogan « Soyons ingouvernables », il y a quelque chose qui ne me plaît pas trop, c’est une espèce d’ autodésignation : « On est les ingouvernables, on ne se laisse pas avoir. » Cela renvoie à une certaine idée de la politique, où l’on met le pouvoir d’un côté, et la résistance de l’autre. On enferme la lutte politique dans l’idée qu’il y a le pouvoir et la gouvernementalité à abattre et, en face, ceux qui résistent en se déclarant comme inatteignables par le pouvoir. À la limite, cela rejoint certaines positions qui ne sont pas vraiment révolutionnaires, comme celles des libertariens américains qui se déclarent aussi ingouvernables. Ça peut donc relever d’une déclaration forte, mais en même temps, je considère qu’il y a quelque chose là-dedans qui s’apparente plutôt à une esquive.
Ce soir à La Gaîté Lyrique, des gens voulaient entrer, mais la jauge de la salle était atteinte, d’autres voulaient sortir pour fumer, et il y a des vigiles au milieu qui suivaient des ordres et ne laissaient entrer ni sortir personne, avec une fonction qui leur était assignée. Au dessus, il y a des responsables, un État normatif en termes de sécurité incendie, etc. C’est parti en esclandre.
Dans Malaise dans l’esthétique 7, vous écrivez : « La politique advient lorsque ceux qui n’ont pas le temps, prennent le temps nécessaire pour se poser en habitant d’un espace commun, pour démontrer que leur bouche émet bien une parole qui énonce du commun et non seulement une voix qui signale la douleur. Cette distribution et cette redistribution des places et des identités, ce découpage et ce re-découpage des espaces et des temps, du visible et de l’invisible, du bruit et de la parole, est ce que j’appelle le partage du sensible. La politique consiste à reconfigurer le partage du sensible qui définit le commun d’une communauté, à y introduire des objets et des sujets nouveaux, à rendre visible ce qui ne l’était pas et à faire entendre comme parleurs, ceux qui n’étaient perçus que comme animaux bruyants. » En mêlant la pièce Cortège de tête, avec les textes publiés dans Jef Klak au sujet du mouvement de la loi Travail, on a essayé de faire cela, de dire ce qui s’était passé en termes de conquêtes d’espaces, même si elles étaient temporaires. On est comme dans un redécoupage de la politique qu’on fabrique. Selon vous, est-ce qu’il y a une séparation entre l’action qui vient de se passer à l’entrée de la salle, et ce moment où nous discutons, juste à côté ? Est-ce qu’il y a une séparation entre le moment politique et la parole qui cherche à ressaisir le politique ?
Je ne peux pas trop vous répondre sur ce qu’il s’est passé ce soir, car je n’ai été témoin que des résultats et non pas de la chose elle-même. Ça m’a rappelé une chose qui est arrivée il y a quelques années dans un centre culturel à Santiago du Chili, où j’étais venu faire une conférence sur l’émancipation. Au même moment, il y avait un mouvement lycéen très fort dans la rue, et tout d’un coup (j’avais commencé à parler depuis un quart d’heure), on a entendu des grands coups à l’entrée. Deux cents lycéens frappaient sur la porte et criaient « ¡ Emancipacíon ! ¡ Emancipacíon ! » La police est arrivée, et il y a eu une quasi-émeute. Finalement, on a sonorisé le débat, et les gens qui étaient dehors ont pu écouter ce que nous racontions sur l’ emancipacíon.
Pour en revenir à ce qui s’est joué ici ce soir, il y a quelque chose d’important dans le rapport entre ce qu’on essaie de construire à travers une série d’actes, et ce qu’on essaie de ressaisir par des mots. Au fond, Jef Klak tente de briser la séparation entre le domaine de la parole – éventuellement de « la parlote » –, et celui de l’action concrète. On a bien vu au printemps dernier qu’il y a une tension entre ceux qui se retrouvent en assemblée sur une grande place pour parler, et ceux qui disent qu’il faut partir de cette assemblée, viser des cibles réelles, casser et revendiquer le fait qu’on casse. Mais on ne peut pas simplement opposer ces domaines, c’est un peu plus compliqué puisque, par exemple, parmi les personnes qui assumaient le slogan « Nous sommes tous des casseurs », on en retrouvait qui animaient Radio Debout sur la place de la République.
Au fond, on essaie à chaque fois de constituer le commun : à travers des gestes, des initiatives, des violences gestuelles, mais aussi des manières de se mettre ensemble… Le moment d’après est important : comme une reprise, une traduction. Le temps est fini où les partis pouvaient synthétiser le cours de l’histoire. La synthèse se fait au jour le jour, et plutôt comme une traduction, comme une expérience de transmission.
Par ailleurs, la situation dans laquelle on s’est trouvé ce soir se répète à chaque fois que l’on est dans un lieu où il y a des contraintes de sécurité. Cela finit par donner raison à ceux pour qui l’état d’exception est permanent . Cela dit, ce qui a été tenté ce soir, c’est de casser les contraintes de sécurité. Et cela a du sens de faire se dérouler la soirée dans des conditions contradictoires. Après tout, présenter le numéro d’une revue, cela se fait en général dans des conditions assez paisibles, où il y a 20-30 personnes qui viennent pointer le bout de leur nez. Comme on sait que ce sont des librairies sympathisantes avec les libertaires ou les anarchistes, on sait qu’il n’y aura pas de problème. On parlera entre nous. Ce soir s’est posée la question du moment où l’on sort de l’entre-soi. Et cela rend toujours les choses plus compliquées.
Encore une fois, le point de rupture n’est pas entre monde de l’art ou du spectacle et monde de la politique, mais disons plutôt entre des lieux administrés et des lieux non administrés. Par exemple, il y a ceux qui obéissent à des contraintes strictes en matière de jauge et ceux qui n’y obéissent pas. Cette réunion-là aurait pu avoir lieu à La Parole errante à Montreuil, et on ne se serait pas occupés de savoir s’il y avait trop de monde. Un rassemblement comme le nôtre convoque un peuple qui n’est pas vraiment dénombrable, où le dehors et le dedans ne se distinguent pas. Et l’espace où nous sommes n’a pas vraiment de jauge. Finalement, les gens auraient pu rentrer physiquement, mais il y a des normes de sécurité. Une expérience a été faite du rapport entre l’intérieur et l’extérieur, qui a sa logique, qui en soi-même fait partie de la structure du monde où l’on vit avec le fait que, quelques fois, on se heurte à un mur. Le mot « sécurité » est un mot central de notre monde, et qui précisément arrête la communication des êtres, des espaces et des expériences.
À l’origine de la revue Jef Klak, il y a des envies communes : aller chercher la politique là où elle se terre plutôt que là où on l’attend, révoquer le partage entre revue politique et revue culturelle, vulgarisation et recherche, faire se côtoyer le reportage, la fiction et les sons sans les hiérarchiser à travers des logiques trop causales. Pourriez-vous nous rappeler l’histoire de la distinction chère à certains sociologues entre « critique sociale » et « critique artiste » que vous faites remonter à la séparation entre deux cultures : celle de la tradition ouvrière marxiste et celle des romantiques attachés à critiquer l’utilitarisme ?
On sait que cette histoire de séparation entre la critique sociale et la critique artiste a été lancée par cet énorme pavé qui s’appelle Le Nouvel esprit du capitalisme 8. On y lit qu’il y a eu une tradition de la « critique sociale » donnée par le mouvement ouvrier, par un groupe solidaire qui pense les choses en termes de lutte organisée et de mouvement global. À côté, dit-on, il y a la « critique artiste », née de 1968 et de la société de consommation, avec une revendication d’autonomie où chacun veut se réaliser soi-même, où l’on pense la libération sous la forme d’une culture de l’autonomie, de créativité. « Critique artiste » veut dire aussi qu’il y a une espèce d’esthétisation de la lutte, dans un mode de pensée du collectif qui serait au fond individualiste et chercherait l ’autovalorisation.
Je ne rentre pas dans tous les détails des complexités de l’affaire, mais je dirais premièrement que ça recouvre quelque chose de plus ancien. Ce qu’on appelle critique artiste, c’est ce qu’on appelait anciennement mouvement petit-bourgeois. Il y a une époque où l’on disait : « Il y a la classe ouvrière qui connaît vraiment l’exploitation, les raisons de la lutte, et puis il y a les petits-bourgeois qui trouvent ça sympathique et intéressant, mais qui ne savent pas du tout de quoi on parle, et qui viennent là avec leurs idéaux et non avec la conscience de la classe. » On l’a un peu oublié, mais je me souviens, étant jeune, quand les gros bras du Parti venait défendre le local du mouvement étudiant contre les fachos, il y avait des discussions un peu dans ce genre.
Ce n’est donc pas quelque chose de nouveau, mais ç’a été un peu systématisé sous cette forme critique artiste / critique sociale. Cela vient en partie de l’idée chère à Bourdieu de la « distinction ». De mon côté, j’ai affirmé qu’opposer le bon mouvement social au mouvement artistico-individualiste, c’est toujours présupposer que le mouvement ouvrier n’existe que comme collectif, que les ouvriers ne sont bons en somme qu’à faire masse.
Dans mon travail sur l’émancipation ouvrière, j’ai essayé de dire autre chose : le mouvement ouvrier est né aussi de gens qui voulaient exister autrement que comme une espèce de masse. Ils voulaient faire autre chose, entrer dans un monde sensible commun autrement que sur un mode où on se serre les coudes, tous ensemble pour faire bloc. Il y a selon moi une composante esthétique absolument fondamentale dans ce qui s’est appelé mouvement social. Esthétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la volonté de participer à l’ensemble des jouissances de toutes sortes, aussi bien intellectuelles, esthétiques… qui sont normalement refusées au plus grand nombre. On pense à la définition du communisme donnée par Marx dans les Manuscrits de 1844 : une humanisation des sens humains. Le mouvement ouvrier, c’était cela aussi : ne pas être simplement un mouvement du travail qui se bat, mais un mouvement de gens qui participent à part entière à un monde commun.
Je ne crois pas qu’il y ait eu cette séparation nette : d’un côté les romantiques, et de l’autre, un mouvement ouvrier. Il faut se souvenir que l’un des militants les plus actifs du mouvement ouvrier anglais, William Morris, était par ailleurs connu pour avoir incarné ce mouvement de réforme artistique. Fondamentalement, je crois que cela veut dire qu’il n’y a pas à opposer des formes qui seraient antagoniques avec d’un côté le commun et de l’autre l’intellectuel ou l’esthétique. Au fond, tous les combats sont esthétiques : il s’agit de savoir comment on reconstruit et on reconfigure un monde commun. « Critique sociale et expérimentation littéraire » pour Jef Klak, c’est une façon de mettre les deux ensemble. Il y a un travail de recherche nécessaire pour construire un monde commun qui passe aussi par les mots, les pensées, les formes artistiques.
On voit bien qu’il y a de plus en plus de porosité entre les différents mondes : le monde politique n’est plus un monde donné avec des références bien constituées. Au fond, on est dans une ère où le monde de l’art essaie de bricoler un peu autrement des formes communes, tente de réfléchir sur ce que font les mots et les formes quand on les met ensemble. C’est pour moi significatif qu’il y ait cette composante esthétique dans les mouvements actuels, dans les organes révolutionnaires récents. Faire une revue comme Jef Klak, avec une attention à la mise en page (et il y a beaucoup d’éditeurs de la gauche radicale qui partagent ce souci), ce n’est pas une coquetterie, mais une question riche de sens : comment on met ensemble du blanc et du noir, des mots et des images ? La valeur des images existe-t-elle comme illustration ou bien propose-t-elle une énigme, un problème ? Il y a là comme une sorte d’éducation esthétique. Il était dit tout à l’heure dans la pièce « Je n’aime pas les séparations », et on voit bien là qu’on vit un moment où l’on essaie de briser les séparations.
Il y a une question récurrente au sein du collectif Jef Klak : celle de l’accessibilité. Ce n’est pas qu’une question économique : le prix de la revue est évidemment un souci, mais il y a aussi la question du contenu. Que dit-on de l’actualité, des pratiques populaires ou des expériences quotidiennes ? On retrouve là le souci un peu naïf de pouvoir s’adresser au plus grand nombre. Pourriez-vous revenir sur la question de l’égalité : face à une œuvre, à un énoncé, ou dans les prises de décision collective ?
Il y a toujours eu une pluralité de manières de considérer la question de l’égalité. On regarde à qui on s’adresse, et il va y avoir 10 % de tel niveau d’études, 10 % de tel autre niveau d’études. Donc, il va falloir se mettre au niveau des gens, voilà la manière classique de penser l’égalité, mais c’est celle des inégalitaires. Dans cette logique, on va considérer qu’il y a des gens qui sont incapables, et qu’il faut petit à petit descendre jusqu’à eux. Avec une telle méthode, on n’arrive jamais qu’à des catastrophes.
Selon moi, l’égalité est un principe qui inspire d’abord ce qu’on dit, ce qu’on fait et ce qu’on essaie de mettre en forme. Je me souviens d’avoir parlé en « province » – et les gens y intériorisent en quelque sorte leur infériorité – dans une petite ville Front national, et quelqu’un m’avait dit : « Ohlala, est-ce que vous allez vous mettre à la portée du public d’ici ? » Ce à quoi j’ai répondu : « Je ne me mets jamais à la portée de qui que ce soit, j’essaie de dire le mieux possible ce que j’ai à dire, pas pour me mettre en valeur, mais pour faire en sorte que ce que j’ai à dire soit dit le mieux possible. »
C’est pareil pour une revue. « Ohlala, est-ce que ça va pas être élitiste ? Est-ce que ça va pas coûter cher ? » Le papier est beau. Le travail iconographique ou typographique est soigné. Même s’il y a beaucoup de bénévolat, ça coûte quand même cher à fabriquer. Si on pense qu’il faut le faire, on pense que ça doit trouver ses lecteurs, son adresse. L’égalité, c’est aussi ça : on ne sait jamais très bien à qui on s’adresse. Si on détermine la cible, on est fichu. Aussi bien dans le monde du commerce ordinaire que dans le monde dit intellectuel ou artistique, on nous demande de concevoir les choses en termes de cibles, à savoir : « Qu’est-ce qu’il faut faire pour que les gens bougent ? »
Je pense qu’il faut avoir une logique complètement différente : chacun est aussi intelligent que moi. Chacun peut lire ce que j’écris, chacun peut avoir la sensibilité que j’ai en face des images. Il y en a certains qui ne l’auront pas, mais on sait très bien que ce n’est pas une question d’origine sociale. Le goût des livres, par exemple, est un goût minoritaire partout, y compris dans la classe des gens qui en vivent.
La pièce Cortège de tête ne se veut ni une pièce de théâtre, ni une performance, ni une lecture, ni de l’art, ni de la politique – ou un peu tout de cela. Celles et ceux qui ont dit leur texte ne sont pas à proprement parler des acteurs, des actrices ou des militants. Pourtant, chaque fois que ce texte a été lu, c’était volontairement dans des théâtres institutionnels. Organiser cette rencontre dans un haut lieu de l’institution culturelle n’était pas une évidence pour le collectif Jef Klak. En venant ici, nous quittons nos lieux habituels. Vous rappelez dans Aisthesis 9 à quel point le tissu de l’expérience sensible dépend aussi des conditions matérielles de production et de diffusion : de quelles manières les lieux et les modes de production et de diffusion infléchissent-ils l’expérience sensible ?
Il y a une porosité des espaces et des formes. On l’entend y compris chez les membres les plus violents du cortège de tête, à savoir : on ne veut plus être derrière ces sonos moches, ces ballons moches. D’une certaine façon, on veut du beau, on veut être respecté.e.s. On veut vivre dans un monde sensible : on ne veut pas défiler derrière des slogans qui sont aussi moches que ceux de chez Carrefour, comme il est dit dans un des fragments rassemblés par Jef Klak 10. Ça fait le lien entre une certaine idée de la lutte de classes et une certaine idée de l’esthétique.
Il y a trois jours, je parlais dans un colloque sur le conflit politique organisé par le Collège international de philosophie : ça avait lieu au Théâtre de l’Échangeur, à Bagnolet. Beaucoup de choses se passent aujourd’hui dans des théâtres, souvent aussi dans des musées, parce qu’un certain type d’espaces critiques traditionnels n’existent plus. Ce n’est pas à l’Assemblée nationale qu’on parle politique, ce n’est pas non plus dans les organisations dites politiques. Ça se fait dans des lieux un peu kidnappés : la rue, une place, des agences Pôle emploi, que sais-je ? ou tout autre forme de bâtiment public occupé. Ça se passe aussi beaucoup dans des lieux de l’art qui sont souvent devenus des sortes d’espaces transitionnels. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui.
Notes
1. Cortège de tête/ une conférence imaginaire contre le réel. De et avec, Lisemarie, Reda, Abdel, Karim, Nicolas. Comment dans le brouillard des lacrymos, tout au fond de la nasse, se nouent les amitiés. Le réel s’ingéniait à ce que nos trajectoires jamais ne se croisent. Pourtant, chacun de notre côté, nous fabriquions l’instrument qui allait permettre nos rencontres : ce cortège bâtard qui déborde les syndicats, qui n’a pas de service d’ordre, que les flics nassent, qu’ils tabassent ; celui du black-block, celui qui part en manif sauvage, « Ahou ! » dans lequel tu ne peux pas marcher sans tes lunettes de piscine et qui prend l’apéro chez Valls. À base de textes écrits sur le vif, de souvenirs, de sons, nous raconterons cette fête. À l’instar de nos rencontres et de la bataille, qu’ensemble, encore, nous menons, notre geste sera inachevé. Nous chanterons la geste de ce cortège où se mélangent syndicalistes sincères, étudiants, chômeurs, lycéens… ce phénix sur lequel le pouvoir jette des grenades, non pas tant parce qu’il pète les banques qu’il est la brume où ceux qui ne devraient jamais se rencontrer se rencontrent.
2. La Nuit des prolétaires, « Pluriel », Hachette, 2012.
3. Dans Le Maître ignorant (« 10-18 », Fayard, 2004), Jacques Rancière rappelle l’expérience de Joseph Jacotot (1770-1840), professeur français à Louvain, dont les élèves flamands apprennent le français tout seuls à partir d’une édition bilingue de Télémaque, et qui en déduit une méthode d’enseignement dite du « maître ignorant ».
4. Lettre de Gabriel Gauny à Moïse Rétouret, 12 octobre 1833 .
5. « La transformation d’une jeunesse en deuil en jeunesse en lutte », 30 avril 2016, Propos recueillis par Joseph Confavreux.
6. La fabrique, 2005.
7. Galilée, 2004.
8. Luc Boltanski et Ève Chiapello, Gallimard, 1999.
9. Aisthésis, scènes du régime esthétique de l’art, Galilée, 2011.
10. « Une pensée pour les familles des vitrines. Paroles de manifestant.e.s masqué.e.s », Jef Klak nº 4 « Ch’val de Course ».
php
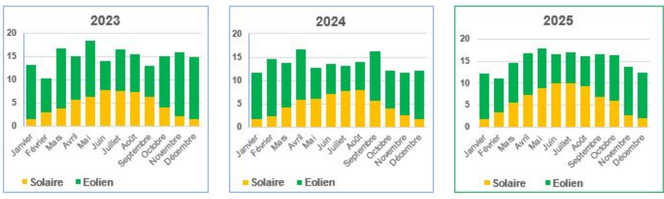
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire