par Émile Carme
09/09/2017
Commentaire : "Qu'est-ce que le passé, sinon du présent qui est en retard ?"
Pierre Dac (1893-1975)
php
Texte inédit pour le site de Ballast
« Je sais que jamais je ne baiserai l’âme / De celle qui ne parvient pas à m’appeler camarade », écrivit le « poète raté » qu’il se dit être. Cinquante ans jour pour jour que le Che est tombé. Chacun sait le voyage initiatique en motocyclette, la gueule d’ange dont chaque génération s’éprend, le maquis cubain, les tragiques épopées congolaises et boliviennes, le martyr allongé sur un lavoir, l’hymne de Buena Vista Social Club et la récupération marchande du mythe qu’il devint aux quatre coins du monde : inutile d’y revenir. Chacun sait les lieux communs — et leur dénonciation n’en est qu’un de plus — et l’on chérit la figure de l’internationalisme, la voix d’un communisme indocile, l’Incorruptible disparu pour la justice sociale. Mais on sait peut-être moins les conceptions qui l’animaient et la vision de l’émancipation que celui qui tenait Fidel Castro pour un « ardent prophète de l’aurore » faisait sienne.

Il n’est aucun « mythe » à déconstruire, aucune « vérité » à mettre au jour, aucune « face cachée » à révéler — laissons cela aux tapages du commerce éditorial, à la bouillasse du journalisme d’opinion 1 et aux falsifications d’un ouvrage réédité à l’occasion de ce cinquantenaire 2 : tout est dit, écrit, consultable. Nous n’entreprenons pas un portrait. Encore moins le récit exhaustif de sa vie. Seulement l’esquisse mentale de cet « enfant du siècle » que le philosophe trotskyste Daniel Bensaïd décrivit à raison comme l’homme de « l’accord parfait 3 » entre gestes et convictions. Il est deux écueils, pareillement coupables : réduire l’entièreté d’une œuvre et d’un parcours à la psyché de son propriétaire (flic anachronique de l’inconscient, fouilleur de poubelles) et faire l’impasse, d’un dédain scolastique, sur l’âme et les entrailles (les idées flotteraient dans l’éther d’une humanité rationnelle sans odeurs ni affects 4). Depuis Nietzsche, au moins, nous ne pouvons ignorer que toute pensée procède d’une subjectivité, que toute philosophie est « exégèse du corps 5 » et que l’on a « la philosophie de sa personne 6 » ; Ernesto Guevara n’échappe pas à la règle.
Quel communisme ? « Il n’est aucun mythe à déconstruire, aucune vérité à mettre au jour, aucune face cachée à révéler — laissons cela aux tapages du commerce éditorial. »
Sur la place de la Révolution, le 18 octobre 1967, Fidel Castro, pleurant la mort de son compagnon, clame que le Che « a mené les idées du marxisme-léninisme à leur expression la plus fraîche, la plus pure, la plus révolutionnaire ». Guevara s’inscrit dans cette tradition idéologique, l’affaire est entendue. Un marxiste convaincu, soucieux du caractère scientifique du corpus légué par le penseur allemand : « On doit être marxiste avec autant de naturel qu’on est newtonien en science ou pasteurien en biologie. » Le marxisme interprète l’Histoire et prévoit l’avenir, estime-t-il — mais, précisent sitôt Löwy et Besancenot dans leur essai Che Guevara, une braise qui brûle encore, un marxisme qu’il entend « non dogmatique, sans vérités gravées dans le marbre » : Guevara lit d’« un œil critique » mais dans « une adhésion constante ». Si Marx et Engels appellent au dépérissement progressif de l’État afin de réaliser le communisme — la société sans classes —, Lénine remodèle le marxisme autour d’un parti d’avant-garde composé de révolutionnaires professionnels à même de conquérir le pouvoir central, d’un État fort 7 garant de la dictature du prolétariat, d’une discipline militarisée et d’un leader perçu comme « chef d’orchestre 8 ». Guevara, dans les pas du dirigeant russe, se montre partisan d’une société éminemment structurée : « En tête de l’immense colonne, nous n’avons ni honte ni timidité à le dire, marche Fidel ; puis viennent les meilleurs cadres du parti, et, immédiatement après, si proche que l’on sent sa force énorme, l’ensemble du peuple… »
Les masses, le parti, le leader. Guevara évoque volontiers la fonction de ce dernier, qu’il nomme également « grand conducteur », dans le dispositif révolutionnaire : Fidel Castro sait mieux que quiconque se faire l’interprète « des désirs et des aspirations du peuple ». Lors des rassemblements, « Fidel et la masse commencent à vibrer en un dialogue d’une intensité croissante jusqu’à l’apogée », observe-t-il. Structure verticale, donc, où le parti — cœur battant, organe et noyau dur de la révolution (« On ne peut être pour la révolution et contre le parti communiste cubain », assure l’Argentin en 1962 à l’intellectuel nord-américain Maurice Zeitlin) — a également pour fonction d’instruire le grand nombre, de l’éduquer : « Le peuple est toujours prêt à apprendre ce qu’on lui enseigne », explique-t-il ainsi en 1958, sur les ondes de Radio Rebelle. L’osmose atteinte, la liaison assurée, la masse « réalise avec enthousiasme et discipline les tâches qu’établit le gouvernement » : les socialistes, écrit-il encore, « suivent leur avant-garde, constituée par le parti, par les ouvriers d’avant-garde, par les hommes d’avant-garde qui avancent liés aux masses ». Les cadres, consigne-t-il dans une préface à un ouvrage de vulgarisation consacré au marxisme-léninisme, se doivent d’être « toujours meilleurs, plus purs, plus humains que tous les autres » ; ils sont des guides, capables de sentir « les désirs parfois obscurs de la masse ». L’avant-garde — notion essentielle de la pensée guévariste — marche devant mais à bonne distance : le pont ne doit jamais se briser ; le peuple, dont la voix est « la plus sage et la meilleure orientation », reste la boussole, mais une boussole qui, seule, ne parvient pas à organiser la rupture : il faut « entendre les pulsations du peuple pour pouvoir les transformer en idées concrètes », rappelle Guevara à l’Union des jeunesses communistes. La masse émet, le parti sculpte, le leader instaure et tous trois se fécondent mutuellement. Un journaliste l’interroge : y aura-t-il des élections à Cuba ? Réponse : « Quand le peuple le demandera. »

Fidel Castro (DR)
Un communisme optimiste, volontariste (maoïste, en cela, analyseront d’aucuns), arrimé à l’horizon : le Che parle de la « société parfaite », celle du communisme enfin réalisé, lance en 1960 que sa génération verra « le monde libéré définitivement » ; il prend l’avenir à témoin, parie, jure que « l’Histoire nous donnera raison ». Un communisme résolument internationaliste et anti-impérialiste — sa vie durant, le Che ne cesse d’écrire sur ce monde qu’il parcourt et dont les maux l’obsèdent, ressassant, dans le sillage de José Marti, figure de l’indépendantisme cubain, que « tout homme véritable doit sentir sur sa joue le coup donné à n’importe quel homme » : il s’agit là, très certainement, de la facette la plus connue du Che ; n’y revenons pas. L’un de ses meilleurs biographes, Pierre Kalfon, ratifie les dires du guérillero lorsque ce dernier tançait le sectarisme : Guevara n’est pas un sectaire en dépit de son « radicalisme à outrance » : il amende sa vision de l’URSS, déroge aux mots d’ordre de la propagande soviétique, n’a pas recours à la mauvaise foi pour mieux avoir raison, consent au débat argumenté (sauf avec les ennemis et les traîtres, s’entend, et Guevara chérit les coupes franches : « Ou bien on est notre ami, ou bien on est notre ennemi. ») et n’approuve pas la destruction des textes de Trotsky par les communistes cubains les plus orthodoxes. Stalinien, le Che ? Les gros sabots en jurent, les disciples le nient : la vérité, comme de juste, dodeline et se cherche entre deux chaises. Ernesto Guevara fleurit la tombe de Staline, quatre ans après l’édifiant rapport Khrouchtchev, mais évoque, dans des notes, « le terrible crime » qui fut le sien, celui d’avoir « institué le culte illimité de l’autorité » ; Guevara lance que l’on ne saurait être communiste sans avoir lu les quatorze volumes du Petit Père des peuples mais, tout en avançant que « toute révolution comporte, qu’elle le veuille ou non, que cela plaise ou non, une inévitable part de stalinisme », encerclement capitaliste oblige, conteste l’existence d’une percée stalinienne à Cuba ; Guevara jure face à un portrait du « regretté » Staline qu’il ne prendra jamais de repos tant qu’il n’aura pas vu les « pieuvres capitalistes » anéanties mais s’en prend à la bigoterie stalinienne en matière de mœurs, aide à la libération des partisans du chef de l’Armée rouge et rejette le réalisme socialiste en art ; Guevara qualifie en 1961 l’URSS de « continent des merveilles » mais dénonce son manque d’appui aux luttes du tiers-monde puis confie à l’une de ses connaissances, cinq ans plus tard, que ce qu’il voit en Tchécoslovaquie soviétique n’est que l’« échec du socialisme 9 » : le marxiste cubain Samuel Farber écrit, dans Che Guevara — Ombres et lumières d’un révolutionnaire, que le guérilléro, une fois libéré de ses responsabilités à la tête du gouvernement cubain, se montre très critique à l’endroit de l’URSS tout en ne rompant jamais avec « la conception monolithique du socialisme soviétique de l’État à parti unique ».
La lutte armée
« Stalinien, le Che ? Les gros sabots en jurent, les disciples le nient : la vérité, comme de juste, dodeline et se cherche entre deux chaises. »
Ernesto Guevara se revendique volontiers du pragmatisme. Il n’entend pas être un révolutionnaire de cafés ; il agit et n’a pas « l’habitude de parler de théorie », précise-t-il lors d’une interview. La meilleure manière de dire, c’est encore de faire, se plaît à lancer celui qui refuse, depuis toujours et dans l’un de ses poèmes, de « copuler des idées sans fonctions pratiques ». Et l’action, chez lui, passe notamment par le feu. Dans une lettre adressée à ses parents, Guevara n’en fait pas mystère : « Je crois en la lutte armée comme unique solution pour les peuples qui luttent pour se libérer, et je suis conséquent avec mes convictions. » Lutte armée contre les pouvoirs despotiques dont il explicite la méthode, dans plusieurs de ses textes ; ce qu’il théorise sous le nom de « foquisme » (de foco, foyer) consiste en une avant-garde militarisée du peuple et n’a pas besoin d’attendre la fameuse réunion des conditions nécessaires à la révolution : un « noyau insurrectionnel » peut y remédier. Guevara assure qu’il ne faut pas redouter la violence et assume sans détour la guerre civile comme conséquence de la lutte des classes : nier la guerre civile, écrivait Lénine, reviendrait à nier toute révolution socialiste — Guevara le cite, et entérine. Si le Che estime qu’une mobilisation pacifique, ou non-violente, s’avère correcte d’un point de vue théorique (on sait que le jeune Guevara aima Gandhi et qu’il se recueillit, parvenu au pouvoir, sur la tombe du meneur indien), il certifie qu’elle ne « marche pas » sur le continent qui est le sien et rappelle, à qui lui oppose la prise de pouvoir par les urnes, qu’un coup d’État militaire au service de la classe possédante ne manque jamais de renverser le régime progressiste qui a renoncé aux armes. En 1966, Mario Monje, dirigeant du Parti communiste bolivien, répond négativement à sa demande d’appui, ajoutant : « Toi, tu as une mitraillette en tête, dans la mienne, il y a de la politique. »
Il y a la théorie. Il y a aussi celui qui l’échafaude. Guevara — que Castro décrit comme « un maître de la guerre » et « un soldat insurpassable » — aime la guerre : vérité nue et brute. Se battre les armes à la main, dit le Che, voilà qui porte « la joie de tous à son paroxysme ». Au poète Pablo Neruda, il confie : « Quand nous l’avons faite, nous ne pouvons plus vivre sans la guerre. À tout instant nous voulons y retourner. » Impatient d’en découdre, on le voit, au Congo, foncer sur le champ de bataille tandis que tous se replient, armé d’un fusil-mitrailleur. « Chacun désire ardemment » le moment de l’affrontement avec l’ennemi, promet celui qui, dans la jungle de la Sierra Maestra, se dit « vivant et assoiffé de sang » et s’émerveille à la vue d’une cargaison d’armes à feu, ce spectacle qu’il tient pour le plus « merveilleux du monde », ces « instruments de la mort ». Dans des Notes de voyage, le jeune homme consigna : « Je prendrai d’assaut les barricades ou les tranchées, je teindrai mon arme dans le sang et, fou furieux, j’égorgerai tous les vaincus qui tomberont entre mes mains. Je me vois immolé à l’authentique révolution. » Fidel Castro n’a jamais tari d’éloges à l’endroit de son camarade argentin et nul n’ignore le culte qu’il instaura dans tout Cuba à sa mémoire, en lieu et place, du reste, du sien propre ; il lui trouvait toutefois un défaut, son talon d’Achille : « son excessive agressivité ».

Ernesto Guevara, mort en Bolivie (LAPRENSA /AFP-MARC HUTTEN / Archivo, cine)
Le Che a tué, sans contredit : il raconte, dans le maquis cubain, avoir notamment abattu à bout portant et d’une balle dans la tête un paysan qui les avait trahis (« Quand nous infligeons la peine de mort, nous le faisons correctement ») — il n’hésitait pas, en revanche, à épargner la vie des prisonniers et proposa, le jour de son arrestation en Bolivie, de soigner les blessés de l’armée qui l’avait capturé et s’en allait le tuer (les témoignages abondent ; ainsi du Che arrêtant la main de l’un de ses camarades, prêt à abattre un prisonnier, la bataille terminée : « Tu crois qu’on est pareils à eux ? »). Biographes et historiens peinent à s’accorder sur le nombre d’exécutions approuvées ou diligentées par Guevara, en sa qualité de responsable de la commission d’épuration et de procureur suprême de la forteresse de La Cabaña, au lendemain de l’effondrement du régime pro-étatsunien de Batista : entre quelques dizaines et 550, environ, bien que plusieurs voix s’élèvent afin de lui dénier toute responsabilité 10 — acteurs de la dictature déchue et criminels de droit commun, pour l’essentiel ou l’entièreté (lors d’entretiens menés dans les années 2000, Castro assume ces exécutions au nom de la justice révolutionnaire : elles évitèrent en sus, ajoute-t-il, les lynchages de rue, la vengeance individuelle et le ressentiment populaire).
La morale de l’homme nouveau
« Biographes et historiens peinent à s’accorder sur le nombre d’exécutions approuvées, commandées ou diligentées par Guevara. »
Leimotiv du Che. L’homme, par trop lourd de ses « tares » anciennes, doit entreprendre un « travail continuel » afin d’« extirper » ses défauts : point de communisme sans cela. L’homme n’est qu’un « produit non achevé » et le peuple, proclame-t-il en 1962 à l’Union des jeunesses communistes, est capable, oui, de « se débarrasser des mesquineries humaines ». Il faut éradiquer en lui le goût pour le profit et tourner la page de l’homme loup pour son prochain, le remplacer par « un autre type d’homme », un homme complet, conscient, libéré de la marchandise — lors d’un discours prononcé à la Havane deux ans plus tôt, encadré par le ministère de la Santé publique, Guevara fait savoir que des « nouveaux types d’humains » sont en train de naître à Cuba : ces enfants apprennent la science révolutionnaire et la lecture. L’être de demain aura tué l’individualiste qui le ronge ou le guette et le futur verra « l’utilisation totale de tout individu au profit de la collectivité » ; le bonheur passe par le fait de se sentir « rouage de la machinerie » et il est « criminel » de se préoccuper du confort des uns quand tant d’autres n’ont rien (des propos qui méritent d’être nuancés à la lumière d’autres déclarations : l’individu — être unique et membre d’une collectivité — est un « facteur fondamental » et la « personnalité » de chacun doit être respectée en tant qu’elle peut jouer un « grand rôle mobilisateur »).
Guevara dresse le portrait de l’authentique révolutionnaire — on peut, sans crainte de forcer la ligne, songer à quelque autoportrait : « Il doit unir à un esprit passionné un cerveau froid et prendre des décisions douloureuses sans sourciller. » La tendresse de « l’homme ordinaire » lui est interdite ; il sait que sa vie se placera sous le signe du sacrifice : ses enfants ne l’appelleront jamais « père », son épouse aura à s’adapter et ses amis seront les amis de la révolution. « Il n’y a pas de vie en dehors de celle-ci », écrit-il. « Un homme qui consacre sa vie entière à la révolution ne peut se laisser distraire par la pensée de ce qui manque à un enfant, de ses chaussures usées, du strict nécessaire qui manque à sa famille. S’il se laisse hanter par ces préoccupations, il créé un terrain favorable au développement de la corruption. » Mais, tient-il toutefois à préciser, il ne faut pas pêcher par extrémisme : il convient de garder en soi « une grande dose d’humanité » afin de ne pas s’isoler du grand nombre… Guevara rappelle que l’homme communiste a vocation à « développer sa sensibilité » au point d’éprouver de l’angoisse dès l’instant où un homme est assassiné à la surface de la planète : l’autre devient partie de soi pour ériger le nous de l’émancipation. Amour et haine : les deux piliers, célèbres et partout cités, posés par Guevara. Le révolutionnaire — qu’il décrit comme « le degré le plus élevé de l’espèce humaine » dans son Journal de Bolivie — doit être « animé par de grands sentiments d’amour » et celui qui lutte pour la révolution doit nourrir une « haine intransigeante de l’ennemi » afin de se muer en une « efficace, violente, sélective et froide machine à tuer ».

Ernesto Guevara (DR)
Reste donc à prêcher par l’exemple. Toujours. Au résistant français David Rousset, Guevara explique ainsi vouloir ériger « le parti du sacrifice ». Une fois parvenu à la tête de la Banque centrale de Cuba, il baisse le salaire de ses adjoints et ne touche pas le sien ; en visite officielle au Japon, il interdit à trois soldats de passer leur soirée dans un cabaret — on ne gaspille pas « l’argent du peuple en orgie avec des putes » ; on lui demande un autographe et le voici tournant les talons, lâchant qu’il n’est pas un acteur de cinéma ; un journaliste l’appelle « Che » : il refuse la familiarité et exige qu’on lui donne du « commandant Guevara » ; un guérillero entre dans son bureau, bien mis et honoré à l’idée de le rencontrer au lendemain de la victoire contre Batista : Guevara lève à peine les yeux et, s’adressant au jeune homme à la troisième personne du singulier comme s’il n’était pas là, prie « cette chose » qui se trouve face à lui de quitter les lieux — on ne fait pas le coquet, on donne tout, éreinté, pour le peuple ; un camarade débarque avec une Jaguar abandonnée : le Che lui intime l’ordre de s’en débarrasser dans l’heure puisqu’elle lui confère des airs de « gigolo » ; un collaborateur commet une erreur grave et Guevara ne manque pas de l’envoyer pour un temps dans un camp de travail à l’ouest de l’île — il reviendra pointer, comme si de rien n’était ; on lui propose un verre de lait après qu’il est intervenu, sans masque, dans une usine de plastique en flammes : il s’enquit de savoir s’il y a à boire pour tous les travailleurs présents — non ?, il refuse donc ; des membres du Parti offrent à sa famille plus de denrées que le protocole ne l’y autorise : l’apprenant, le Che s’en offusque et punit les responsables ; des étudiants l’invitent à donner une conférence et lui proposent d’être rémunéré : il s’indigne, estimant qu’il y a là « injure » ; un cuisinier se sert en premier au Congo : Guevara le condamne à trois jours sans manger ; au Congo toujours, l’un de ses guérilleros couche avec une Africaine : Guevara assure, honneur du militant oblige, qu’il doit se marier avec elle mais le Cubain l’est déjà, marié, au pays — Guevara insiste : le combattant se suicide. « Non seulement je ne suis pas un modéré mais j’essaierai de ne l’être jamais », assène bien sûr celui que l’économiste Nestor Lavergne décrivit comme un homme rigoureux, exigeant, peu démocrate et très centralisateur : « un type bien ».
Quand George Orwell aspire à bâtir un socialisme par et pour l’homme ordinaire, dos aux saints comme aux ascètes, Guevara exhorte nuit et jour à l’arrachement, au dépassement, à l’effort : il est quelques accents robespierristes chez ce latino asthmatique en treillis qui n’aurait certainement pas boudé la Vertu si chère à l’avocat d’Arras — « ce sentiment sublime suppose la préférence de l’intérêt public à tous les intérêts particuliers 11 ».
« Il sait ce qu’il veut »
« Quand George Orwell aspire à bâtir un socialisme par et pour l’homme ordinaire, dos aux saints comme aux ascètes, Guevara exhorte nuit et jour à l’arrachement, au dépassement, à l’effort. »
« J’ai un caractère explosif », admit le Che, conscient de ce qu’il tenait pour un défaut. Castro avoua, dans les pages de la colossale Biographie à deux voix, que son défunt complice se montrait « parfois rigide », ce que l’intéressé ne cachait nullement : « Je suis extrêmement rigide dans mes actes », écrivit un jour le commandant à ses parents. Le portrait est, peu ou prou, unanime. Le jeune Guevara est volontiers décrit comme vif, peu porté sur la toilette (et fier de cela), batailleur, baiseur, fou de livres, très critique, insatiable, franc jusqu’à la brutalité (« Mes qualités diplomatiques n’ont jamais été très grandes », consignera-t-il dans son Journal du Congo), ironique et doué d’un rire contagieux ; le commandant Guevara est à l’envi dépeint comme rabat-joie, implacable, en retrait, peu disert, sarcastique, cultivé, courageux, irascible et maniant l’humour noir. Au maquis, il tempête contre les « lavettes » et les « trouillards », son sac débordant de bouquins, et traite de « mange-merde », son juron favori, quiconque le contrarie ; au guérillero qui lui propose son aide, le voyant épuisé, le Che crache : « Occupe-toi plutôt de ta mère. »
Enrique Oltuski, ministre cubain, dira : « Impossible de ne pas l’admirer. Il sait ce qu’il veut. Il ne vit que pour cela. » Salvador Allende confiera que deux hommes, sur Terre, l’impressionnèrent — l’un d’eux est celui que l’on devine : son regard empli de fermeté, d’ironie, de solitude et de tendresse. Benigno, guérillero sous ses ordres au Congo puis en Bolivie, rapporte dans son récit Vie et mort de la révolution cubaine que le médecin était un homme de conviction, capable de tout pour la lutte, du meilleur comme du pire, ce pire qu’il redoutait d’ailleurs tant ses punitions « étaient vraiment féroces » — ses hommes éprouvaient « vis-à-vis de lui à la fois de l’admiration et de la peur ». Un homme dur, très dur. « Quand le Che s’emportait, il ne vous laissait jamais expliquer pour quelle raison vous aviez commis une erreur, il ne vous laissait tout simplement pas ouvrir la bouche, et le mieux était encore de se taire. J’ai énormément aimé le Che, j’aurais été prêt à tout donner pour lui, y compris ma vie, n’importe quand, mais de là à faire de lui un homme parfait, il y a loin. » Souvent, conte-t-il encore, vit-il le Che écouter un homme puis, reprenant la parole, conclure : « Ce que tu me racontes, c’est de la merde. » Mais ce même Che refusait tout privilège, se traitait avec la même dureté qu’il traitait ses hommes, ne redoutait pas le danger ni la mort, n’hésitait jamais à secourir ses camarades sous le feu de l’ennemi ; ses troupes, poursuit le colonel cubain, le regardaient comme « un surhomme à la bravoure absolue ».

La Havane (DR) Don Quichotte et moine-soldat
L’usage entend distinguer — sinon opposer — l’aventurier du militant ; le premier a le goût du neuf et du risque (grand large, crochets du droit, bars de nuit et hautes montagnes) et roule sa bosse, quitte à la briser, sans foi ni souci des attaches et d’autrui ; le second, harnaché à ses idéaux, chemine pour plus grand que lui (la Cause, la Révolution, le Salut) et parfois perd sa vie pour mieux l’offrir. Découpage à la hache, pour sûr, mais l’outil ne manque pas d’arguments. Guevara malmène toutefois l’affaire : baroudeur et disciple, bourlingueur et affilié. Un homme d’action 12 en mission. Une tête brûlée qui a le sens du devoir et rêve d’une gestion administrative semblable à « un parfait mécanisme d’horlogerie ». L’avide lecteur de Jack London qu’il est n’a de cesse, surtout en privé, d’assumer son désir d’aventure — « mais un aventurier d’un type différent, un de ceux qui risquent leur peau pour démontrer leurs vérités… » Il se sait « vagabond impénitent » et, dans une lettre à sa compagne Hilda Gadea, évoque son « esprit anarchique qui [lui] fait rêver d’horizons » ; s’il est monté à bord du Granma aux côtés de Castro afin de prendre d’assaut le Cuba de Batista, ce ne fut pas tant en vue de l’emporter — il estimait l’opération presque vouée à l’échec — que « par un lien romantique de sympathie et d’aventure », admet-il dans ses Souvenirs de la guerre révolutionnaire.
« Pourquoi, demande un jour Debray à Guevara en pleine forêt bolivienne, se montre-t-il à ce point aimable avec Castro et si cassant avec tous les autres ? »
Un vagabond et un guerrier, hanté par le sacrifice. Il forme, avec les éléments les plus hardis, un « peloton-suicide », c’est son nom, pour mener les assauts risqués contre les troupes du dictateur cubain. Si Guevara refuse d’être comparé à Jésus — « Je ne suis ni le Christ ni un philanthrope ; je suis tout le contraire du Christ […]. J’essaie d’envoyer à terre l’adversaire plutôt que de me laisser mettre en croix. » —, il y a toutefois en lui l’âme d’un martyr : « J’offre mon sang », répond-il en 1958 aux questions d’un reporter argentin. Il confie à Alberto Granado, son vieil ami, qu’il est un « prophète ambulant » et n’est pas fait pour vivre derrière un bureau ni pour crever grand-père et en appelle, bien que conscient de la dangerosité du terme, à une « mystique », celle du socialisme. De passage en Égypte, Nasser, surpris, lui demande les raisons qui le poussent à évoquer à ce point la mort : mieux vaut vivre pour la révolution, modère le dirigeant panarabe. « Mon sort est de mourir comme un guérillero », confie enfin Guevara, scribe de son propre destin, avant de partir en Bolivie et d’y rester à jamais. Régis Debray, conseiller du prince Fidel et auteur de Révolution dans la révolution, s’y rendit justement afin de rencontrer le Che : il se fit arrêter à son retour et passa quatre années au cachot. L’Argentin devenu cubain, racontera le Français, prenait « un malin plaisir » à faire pleurer ses hommes : il n’avait « aucun sens de la psychologie » et, écrira-t-il en 2006, serait tenu à l’heure qu’il est par le tout-Paris pour « macho rétro et insortable » — il pratiquait les « montées aux extrêmes » et la peine de mort, se montrait « résolument homophobe » et partisan d’une société disciplinaire 13. Debray ajoute : « Le mécanisme classique : je suis altruiste pour l’humanité mais pas pour l’autre. On a vraiment la structure du sectaire parfait, comme pouvaient l’être saint Dominique, les saints et les martyrs chrétiens. »
Un saint doublé d’un solitaire. Et Guevara le sait mieux que personne. « Je n’ai ni foyer, ni femme, ni enfants, ni parents, ni frères. Mes amis ne sont mes amis qu’autant qu’ils pensent politiquement comme moi », écrit le mari et le père de famille qu’il est à sa propre mère, sur du papier à en-tête Air India, en 1959. Guevara va jusqu’à admettre qu’il ne sait pas comment le Cubain ordinaire est fait — « Je ne considère plus les gens que comme des soldats », lâche-t-il d’un ton que l’on devine amer. Si, nous dit Debray dans plusieurs de ses livres, Castro se montre curieux de tout, prévenant, chaleureux, courtois, séducteur et sympathique, le Che reste à l’écart, lisant, ruminant, inspirant la crainte et la révérence. Pourquoi, demande un jour Debray à Guevara en pleine forêt bolivienne, se montre-t-il à ce point aimable avec Castro et si cassant avec tous les autres ? Le révolutionnaire de répondre : il n’a pas la faconde du leader cubain, pas son sens inné du contact humain ; lui reste donc le silence : « Tout chef doit être un mythe pour ses hommes. » Et de conclure : « Si les gens ne m’aiment pas de prime abord, au moins me respectent-ils, car je suis différent. » Guevara recopie ces vers de Neruda, « Je pars. Je suis triste : mais je suis toujours triste » ; et s’il déclara naguère que la solitude relevait à ses yeux d’un « manque d’éducation » que la révolution ne manquera pas de pallier, il n’en confie pas moins, au Congo, la solitude qui le submerge, comme jamais. Un solitaire qui lègue à ses enfants, pour seul testament et héritage, quelques lignes sur une feuille de papier : « Grandissez comme de bons révolutionnaires. […] Rappelez-vous que l’important c’est la révolution et que chacun de nous, seul, ne vaut rien. » C’est un « ermite armé », raconte encore Debray dans Loués soient nos seigneurs, un pur, un homme de morale et d’ascèse, un ange exterminateur qui se soucie peu du principe de réalité et n’entend pas, contrairement à Castro, louvoyer, négocier, s’allier sans y croire. Surhomme et inhumain, adepte de l’autocritique voire de la mortification, « bourreau de lui-même et des autres » ; conclusion de l’écrivain : le Che fut un « homme antipathique et admirable ».
Ernesto Guevara ne saurait être un modèle en vue d’œuvrer à quelque rupture démocratique et anti-autoritaire ; il n’en demeure pas moins qu’il devint bien plus que ce qu’il fut : une métonymie mondiale de la contestation de l’ordre marchand, cynique, concurrentiel et (néo)colonial — le philosophe Miguel Benasayag évoque à juste titre un « paysage Che », une « subversion guévariste 14 » dépassant le seul Guevara. Cet ordre qu’il nous reste, sous d’autres formes, à démanteler. Si l’on gagne toujours à dénuder nos chimères 15, ne bradons jamais les nôtres à nos ennemis : questionnons le Che en tenant ferme à nos réponses.
Bibliographie
Toutes les citations du présent article proviennent des ouvrages suivants, sous la plume de Guevara : Souvenirs de la guerre révolutionnaire (éditions Mille et une nuits, 2007), Justice globale (éditions Mille et une nuits, 2007), Journal de Bolivie (éditions Mille et une nuits, 2008), Journal du Congo (éditions Mille et une nuits, 2009), Le Socialisme et l’homme (Aden, 2006) et Écrits sur la révolution (Aden, 2007).
Essais, récits et biographies cités ou évoqués : Che Guevara, une braise qui brûle encore d’Olivier Besancenot et Michael Löwy (éditions Mille et une nuits, 2007), Che Guevara — Ombres et lumières d’un révolutionnaire de Samuel Farber (Syllepse, 2017), Le Cas Guevara de Léo Sauvage (La Table ronde, 1971), Che — Ernesto Guevara, une légende du siècle de Pierre Kalfon (Seuil, 1997), Biographie à deux voix de Fidel Castro et Ignacio Ramonet (Fayard, 2007), La Face cachée du Che de Jacobo Machover (Armand Colin, 2017), Les Masques de Régis Debray (Gallimard, 1997), Loués soient nos seigneurs de Régis Debray (Gallimard, 2000), Supplique aux nouveaux progressistes du XXIe siècle de Régis Debray (Gallimard, 2006), Vie et mort de la révolution cubaine de Benigno (Fayard, 1996), Ernesto Guevara, connu aussi comme le Che de Paco Ignacio Taibo II (Payot, 2001), Che Guevara — Le temps des révélations de Jean Cormier (éditions du Rocher, 2017) et Che Guevara, du mythe à l’homme — aller-retour de Miguel Benasayag (Bayard, 2003).
Rebonds
-Lire « Si on m’assassine… » — par Salvador Allende (Memento), septembre 2017
-Lire notre abécédaire du sous-commandant Marcos, mai 2017
-Lire notre entretien avec Olivier Besancenot : « Le récit national est une imposture », octobre 2016
-Lire notre abécédaire de George Orwell, octobre 2016
-Lire notre entretien avec Gérard Chaliand : « Nous ne sommes pas en guerre », décembre 2015
-Lire notre article « Jack London : histoire d’un malentendu », Émile Carme, décembre 2015
-Lire notre entretien avec Breyten Breytenbach : « On n’a pas nettoyé les caves de l’Histoire ! », juin 2015
-Lire notre semaine consacrée à Daniel Bensaïd, avril-mai 2015
-Lire notre entretien avec Michael Löwy : « Sans révolte, la politique devient vide de sens », décembre 2014
Notes
1. ↑ Nous songeons bien sûr à Laurent Joffrin, comparant il y a peu et en toutes lettres, dans les colonnes de Libération, Guevara aux jihadistes.
2. ↑ Dans La Face cachée du Che, paru aux éditions Armand Colin, Jacobo Machover n’hésite pas à manipuler le Sartre d’Annie Cohen-Solal afin de prêter à Guevara une phrase assassine, contre le père de l’existentialisme, qu’il n’a tout simplement pas prononcée : on se reportera, pour le vérifier, à la page 82 de l’édition 2017 du livre de Machover et à la page 514 de la biographie de Cohen-Solal, édition 1985, au Grand livre du mois.
3. ↑ « Le Che, un penseur d’actes ou la tragédie d’un enfant du siècle », intervention de juillet 1997.
4. ↑ La politologue Janette Habel s’oppose ainsi, dans les pages de Politis, à une lecture « psychologisante » du Che afin de contester la dureté de l’homme, tenant à ses yeux de la légende noire (n° 1472, octobre 2017).
5. ↑ Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir, coll. 10/18, p. 41.
6. ↑ Préface au Gai Savoir, Le Livre de poche, 2006, p. 65.
7. ↑ En dépit, bien sûr, de L’État et la Révolution paru en 1917.
8. ↑ Voir Jean-Jacques Marie, Lénine — La Révolution permanente, Payot, 2011.
9. ↑ « Todo aquí es aburrido, gris y sin vida. No es el socialismo, es el fracaso del socialismo », dixit Ulises Estrada Lescaille.
10. ↑ Dans Che Guevara — Le temps des révélations, paru en 2017 aux éditions du Rocher, Jean Cormier convoque plusieurs témoignages afin de disculper le Che : celui-ci n’avait « pas de pouvoir » en la matière et « n’avait rien à voir » avec les tribunaux militaires. Aleida March, épouse de Guevara, contesta également son implication et, même, sa présence lors des exécutions. Dans le premier tome de Ernesto Guevara, connu aussi comme le Che, l’écrivain et journaliste Paco Ignacio Taibo II assure qu’il approuvait « certainement » les pelotons mais que l’accusation visant à le transformer en boucher sanguinaire est « totalement infondée » : le Che, note-t-il encore, promettait le tribunal révolutionnaire à quiconque entendait châtier individuellement les bourreaux de l’ancien régime.
11. ↑ Maximilien de Robespierre, Œuvres complètes, tome X, p. 353.
12. ↑ C’est ainsi qu’il se décrit à Kabila, dans une lettre publiée dans son Journal du Congo.
13. ↑ Voir Supplique aux nouveaux progressistes du XXIe siècle, Gallimard, 2006.
14. ↑ Voir Miguel Benasayag, Che Guevara, du mythe à l’homme — aller-retour, Bayard, 2003.
15. ↑ Selon le beau mot dépeignant Diogène de Sinope.
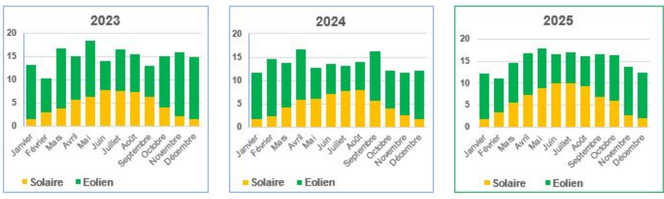
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire