Réfléchir encore et toujours pour ne pas devenir "bête à manger du foin"
Jean-Paul Jouary
php

Blocage au Mans, le 4 décembre. / JEAN-FRANÇOIS MONIER/AFP
Nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas non plus, en France, en dictature. Et c’est précisément parce que la vie politique a été réduite à cette opposition que nous sommes impuissants. Rousseau aimait à dire qu’aussitôt l’élection passée et les membres du parlement élus, le peuple redevient esclave. Être représenté, ajoutait-il, est une idée récente dans l’histoire des humains. Les gilets jaunes ont remis sur le devant de la scène cette critique historique de la confiscation démocratique au nom de la « démocratie représentative ». Nous en discutons avec le philosophe Jean-Paul Jouary, auteur, depuis les années 1970, de près de 30 ouvrages et ancien rédacteur en chef de l’hebdomadaire Révolution. Comment le peuple peut-il « se gouverner » et non plus être dirigé ?
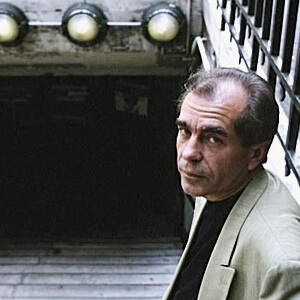
Prenons une séquence télévisuelle : un plateau de BFM TV en date du 15 février 2016. Un invité avance que nous ne sommes pas en démocratie ; l’animateur rétorque aussitôt : « Je n’ai pas l’impression de vivre dans une dictature, tout de même. » Cette réponse est des plus communes. Pourquoi pense-t-on ce cadre si étroitement ?
C’est un procédé démagogique insupportable, effectivement courant. Un peu comme si on avait dit à Mandela qu’il ne devait pas se plaindre de 28 années de bagne, parce qu’il aurait pu être pendu. On le dit aussi à propos de l’Europe : quiconque critique son libéralisme se voit accusé d’être anti-européen, donc nationaliste, donc proche de l’extrême droite. Pour en venir à l’argument que vous évoquez, nous ne sommes effectivement pas sous une dictature, mais comment dire que nous vivons dans une « démocratie » au sens propre ? Comment dire que le peuple des citoyens se gouverne lorsqu’on peut avoir une majorité absolue de députés avec une minorité de voix, qu’on peut adopter une loi sans même en débattre ni la voter au Parlement avec le 49-3, qu’on peut entendre le président annoncer des décisions qui surprennent son propre gouvernement, qu’il peut dissoudre le Parlement, et même signer des traités qui ont été rejetés par référendum comme pour le Traité de Lisbonne ? Cette caricature de démocratie décrédibilise tant la démocratie que l’abstention progresse au même rythme que les votes d’extrême droite. C’est une sorte de « monarchie élective », un « coup d’État permanent » comme la qualifiait François Mitterrand avant de s’en accommoder. La preuve ? Six mois après une élection, les mesures essentielles du président et de sa « majorité » sont toutes largement impopulaires. Puis-je vous proposer un petit jeu ?
Faites !
Imaginons que, dans leur campagne électorale, chaque président ait fait campagne avec les mesures qu’il a effectivement prises après son élection. Par exemple, Emmanuel Macron faisant campagne en disant aux citoyens qu’il leur promet de supprimer l’impôt sur la fortune et les taxations sur les transactions infra journalières, tout en réduisant les APL, en réduisant les retraites, en les désindexant par rapport à l’inflation, en démantelant le droit du travail, en s’attaquant au statut de la fonction publique, en supprimant des postes d’enseignants, en réduisant drastiquement le nombre des cadres sportifs, en adoptant une loi qui permet aux préfets d’enfermer les futurs manifestants sans intervention d’un juge, en réduisant les finances locales donc les services de proximité, en s’en prenant aux droits des chômeurs, etc. Aurait-il dépassé les 5 % ? Poser la question, c’est y répondre. Ne pas voir la crise que traverse notre démocratie, c’est s’engager dans une voie extrêmement dangereuse. Il devient urgent de réinventer conjointement la justice sociale et les institutions démocratiques. Aux États-Unis, au Brésil, en Italie, en Allemagne, et dans la plupart des autres pays, sous des formes différentes, cette crise se manifeste, et les responsables politiques, et trop souvent aussi médiatiques, sous-estiment le danger de leur obstination à tout changer pour que rien ne change.
Le mouvement des gilets jaunes a fait surgir une critique que le pouvoir croyait sans doute oubliée : celle de la démocratie représentative !
On voit bien que cette démocratie « représentative » ne fonctionne plus du tout. Si, aussitôt élus, les « représentants » peuvent diriger en contradiction avec les aspirations d’une sensible majorité des citoyens, c’est qu’ils ne les « représentent » pas. D’ailleurs, que signifie « représenter » ? Re-présenter, c’est recréer une présence lorsqu’elle est impossible. Ainsi, un représentant de commerce ou un ambassadeur re-présentent leur entreprise ou leur pays. Qu’ils prennent la moindre initiative contre ce qu’ils sont censés représenter, et on leur fait payer cette prétention au pouvoir en les chassant de leur fonction. On ne re-présente au sens de « décider à la place de » que dans deux cas : lorsqu’un enfant est trop jeune, alors les parents le représentent et décident à sa place, et lorsqu’une personne est malade mentale, alors des tuteurs font de même. Dans ce que l’on appelle la « démocratie représentative », si les élus prétendent « représenter » le peuple sans lui obéir par voie référendaire mais en prétendant décider à sa place pendant une période donnée, est-ce parce qu’on considère le peuple comme infantile ou comme malade mental ? En ce moment, je pense qu’il y a un peu des deux. Rousseau disait qu’on « ne représente pas le peuple »… Ceux qui s’accaparent pouvoir et richesse en ont tellement conscience qu’ils se vantent chaque jour de posséder la sublime vertu d’oser prendre des mesures impopulaires et de rester « droits dans leurs bottes » face aux manifestations, grèves, sondages. Il n’y a pas plus cynique aveu qu’aujourd’hui on gouverne le peuple sans le représenter, c’est-à-dire qu’on le dirige comme un troupeau. Le pouvoir, disait encore Rousseau, est devenu un « bien de famille ».

Emmanuel Macron le 15 mars 2019 (Laurent Dard / DDM / AFP)
« L’idée des représentants est moderne », affirmait justement Rousseau dans Du contrat social. Le peuple, écrivez-vous dans votre dernier livre, La Parole du mille-pattes, s’est ainsi vu dépossédé de son pouvoir : la démocratie représentative a démocratiquement permis « de supprimer la démocratie au sens propre ». Pourquoi le grand nombre a-t-il accepté si facilement ce tour de passe-passe ?
Ce processus a été historiquement long et complexe. Tous les peuples, je dis bien tous, ont vécu pendant des dizaines de millénaires en prenant les décisions collectivement, avec tous les hommes et toutes les femmes du groupe. En Côte d’Ivoire, au Kenya, en Ouganda, au Ghana, au Rwanda, au Sénégal, chez les Berbères, mais aussi en Asie ou chez les autochtones des Amériques, on trouve des traditions ancestrales de partage, de recherche des intérêts communs, de refus de la vengeance, de modes de réconciliation, de débat public et de décisions collectives. Dans La Société contre l’État, Pierre Clastres parlait d’un « effort permanent pour empêcher les chefs d’être des chefs ». J’en donne une idée dans ce livre, et propose une représentation de ce qui peu à peu a changé. Il se trouve que, dans des conditions glaciaires, en Europe notamment, les premiers stocks de nourriture ont permis des dépendances et des inégalités de statuts, sans doute d’ailleurs associées aux grandes œuvres rupestres du paléolithique supérieur, si j’en crois les travaux d’Emmanuel Guy par exemple. Comme lui, je m’appuie sur les travaux de Brian Hayden sur la Naissance de l’inégalité. L’émergence de l’agriculture et de la propriété de la terre a permis à son tour la structuration d’États et de classes sociales, de l’esclavage et d’empires, si bien qu’Athènes n’a été que la redécouverte, à l’intérieur de dominations sociales brutales (esclavage massif, domination des femmes, colonisations) de formes nouvelles d’expression de la minorité citoyenne. Encore qu’on y refuse d’élire des « représentants » au suffrage universel, mais qu’on tire au sort pour un an l’essentiel des assemblées, pour éviter que, se prétendant choisis pour des qualités personnelles de décision, on se mette à diriger la Cité sans approbation explicite du peuple. Comme l’a bien vu Rousseau, les peuples ne se sont donnés des gouvernants que pour empêcher de se voir imposer des dirigeants. De tout temps, les démocrates ont refusé d’élire des individus au suffrage universel, celui-ci étant utilisé exclusivement pour approuver des décisions
À lire Alain Badiou — qui, comme vous, revendique le terme de « communisme » —, la démocratie est pourtant un verrou à faire sauter pour aboutir à l’émancipation. Il faudrait même « prendre le risque de n’être pas un démocrate », dit-il, puisque la démocratie est la vache sacrée de l’ordre en place, puisque tout le monde, grands capitalistes et dictateurs compris, ne jure que par elle…
Je pense qu’Alain Badiou est présenté partout comme le « vrai » marxiste parce qu’il perpétue une version du communisme qui n’a rien à voir avec la définition qu’en donne Marx : un processus infini de libération humaine qui associe des gens très différents, sans « identité communiste » (l’expression n’ayant strictement aucun sens). Un « mouvement réel qui abolit l’état actuel », selon les mots de Marx, s’opposant à tout ce qui exploite et opprime. C’est une autre définition de la démocratie au sens propre. Libre à Badiou de prendre ce risque de refuser la démocratie, qu’il confond d’ailleurs avec la démocratie libérale. Être révolutionnaire aujourd’hui, c’est clairement articuler les luttes sociales avec la réinvention de la démocratie. Mais nul n’est obligé d’être révolutionnaire. Je ne revendique pas plus l’étiquette « communiste » que les premiers chrétiens qui luttaient contre l’esclavage, les femmes qui agissent pour l’égalité, les gens qui, même sous des formes un peu désordonnées, combattent la pauvreté et la marginalisation, et tout citoyen qui agit pour plus de bien commun et moins d’exploitation cynique des quelques puissances financières qui dévorent tout. Le processus de libération humaine est plus compliqué et riche qu’on ne le croit. Les États, les partis et certains théoriciens qui se disaient « communistes » en ont propagé souvent une caricature dérisoire ou grimaçante…
À la seconde où le mot RIC a été prononcé, la quasi totalité du personnel médiatique et politique libéral, escorté par une frange de l’extrême gauche, a invoqué la peine de mort, le mariage homosexuel et l’avortement. Pourquoi le peuple fait-il à ce point peur qu’il faille recourir au « progressisme » pour s’en défendre ?
Un peuple se construit. Si on le fait voter sur ceci ou sur cela, sans débat intense à l’échelle de la société, le pire est possible. Surtout si ce n’est pas lui qui impose un référendum. Mais si cela vient de lui, que le débat public a lieu, tout peuple est capable de construire des représentations qu’il ne partageait pas au début. Le débat sur le Traité de Lisbonne a prouvé qu’un débat à l’échelle de la société pouvait transformer un « oui » à 80 % en un « non » à 55 %. Je suis convaincu que dans ces conditions on n’a rien à craindre des référendums d’initiative citoyenne. Les peuples, après tout, risquent de moins se tromper que les « experts » qui dirigent si souvent contre les peuples, avec les résultats catastrophiques que l’on sait. Pourquoi les citoyens voteraient-ils en conscience contre leurs intérêts ? Si on méprise à ce point les citoyens, pourquoi leur accorde-t-on d’ailleurs le droit de vote ?

Acte II, Paris, 24 novembre 2018 (Stéphane Burlot)
Un argument est régulièrement opposé à la démocratie directe, parfois en citant Rousseau, d’ailleurs : le nombre. Vous lui opposiez, dans Rousseau, citoyen du futur, nos dispositifs informatiques…
Le problème n’est pas simple, c’est vrai. Délibérer et décider tous ensemble est plus facile dans une tribu africaine ou amérindienne de quelques centaines de personnes, ou sur l’agora athénienne à quelques milliers, qu’à l’échelle d’un peuple de millions d’électeurs. En même temps, cette proximité des orateurs et des membres du groupe favorisait l’art oratoire et la démagogie. Lorsque l’idée démocratique se fraie à nouveau un chemin au cours des deux derniers siècles, les opinions se forment davantage sur des idées, des conceptions de la société, avec des concentrations de travailleurs qui permettent des discussions et des engagements collectifs. La télévision a rétabli la possibilité d’une démagogie dans l’intimité de chaque foyer, tandis que la destruction des collectifs de travailleurs a éparpillé les individualités et rendu plus difficile le débat démocratique. Tout montre que les « réseaux sociaux », qui bien sûr rendent possibles de nouvelles formes de perturbations des débats, créent aussi la possibilité de débats et de mobilisation qui échappent aux États centralisés. Forts de l’expérience de la révolution tunisienne hier, comme de l’Algérie aujourd’hui, les pays totalitaires tentent de détruire ces réseaux sociaux. En même temps, si Internet permet à des milliards d’humains de commander un colis qui parvient chez eux en quelques jours, on voit mal ce qui empêche aujourd’hui d’opérer des référendums à l’échelle de centaines de millions d’électeurs ! Rien, absolument rien de « technique » ne s’oppose à l’idée de référendums d’initiative populaire. Ceux qui s’y opposent le font parce qu’ils s’accrochent au principe même du pouvoir sans ou contre le peuple. Que ceux-là aient le courage de se déclarer anti-démocrates.
Le terme de « populisme » permet aux libéraux de balayer toute critique et de renvoyer dos à dos les nationalistes et les partageux. Cela, vous le dites aussi, peu ou prou. Mais vous ajoutiez, en 2015, que le populisme aboutit « à la mort de la démocratie ». Comment n’être pas « populiste » tout en combattant ceux qui combattent le « populisme » ?
On en vient aujourd’hui à qualifier de « populiste » toute invocation de la souveraineté populaire contre des politiques contraires à ses intérêts et à sa volonté. C’est encore là un procédé qui vise à disqualifier toute critique du monde existant. Au sens traditionnel et péjoratif, le populisme désigne une certaine façon de flatter dans le peuple ce qui naît en lui de contraire à toute analyse raisonnée des problèmes aux niveaux des institutions et de la théorie. Et depuis Platon et Aristote, jusqu’à Rousseau et Marx, on sait qu’on ne peut idéaliser « le peuple » et qu’il est dangereux de dénigrer ce qui, dans la vie intellectuelle et politique, s’efforce de dépasser les apparences, les opinions toutes faites, les passions débridées. En ce sens-là, oui, le « populisme » est une instrumentalisation de ce que le peuple peut avoir de moins élevé, pour parler simplement. Le scandale commence lorsque ceux-là mêmes qui s’accaparent les pouvoirs et les médias traitent de « populistes » ceux qui, en harmonie avec les aspirations et besoins que manifestent les gens, opèrent la critique de tout ce qui leur fait obstacle. Dans ce cas, on qualifie de « populiste » l’aspiration démocratique elle-même. C’est ce jeu démagogique sur le mot qui accrédite finalement l’idée que ceux qui combattent le populisme sont des populistes.
Vous revenez, dans vos écrits, sur les palabres et les traditions culturelles qui placent « la parole au cœur des relations ». C’est là, d’ailleurs, un point central du discours des gilets jaunes : les gens se reparlent « enfin », apprennent à « s’écouter », que ce soit sur un rond-point ou une barricade, dans une cabane ou une assemblée. Serait-ce là le cœur même de la politique ?
La construction de réflexions et de décisions collectives par la parole est non seulement le cœur du politique, mais c’est la construction même du peuple citoyen, le passage d’une somme d’individus à un ensemble plus cohérents de citoyens. On l’a vu avec les gilets jaunes comme on le voit dans tout mouvement social : c’est chemin faisant que les revendications, les propositions, les critiques s’affinent et s’articulent entre elles. Il n’y a de « vérité » en politique que pour ceux qui refusent le principe même de la démocratie : au-dessus de la souveraineté populaire, on pose Dieu, la Nature, le grand guide, l’incarnation de la révolution salvatrice. On y met aussi les paroles d’« experts », face au peuple ignorant, à qui on a mal expliqué, etc. Ce discours revient depuis des décennies, depuis des siècles. On lui oppose la « science politique », la lumière de Science Po. Mais en science, on ne vote pas ! Je préfère cette phrase de l’Éloge de la philosophie de Maurice Merleau-Ponty que j’aime à répéter, qui est profonde, et que l’on taxerait aujourd’hui sans doute de « populiste » alors qu’elle résume l’essence même de la démocratie : « Notre rapport au vrai passe par les autres. Ou bien nous allons au vrai avec eux, ou bien ce n’est pas au vrai que nous allons. » C’est ce que dit avec d’autres mots Amartya Sen dans La Démocratie des autres : « Les élections sont seulement un moyen de rendre efficaces les discussions publiques. » En tant qu’individu, je me pose la question de savoir ce qui est bon pour moi ; en tant que citoyen, je me pose la question de savoir ce qui est bon pour nous. Sans cette question il n’y a pas de politique, et en cerner les contours suppose une infinité de dialogues partagés, sincères.

Mouvement algérien contre le 5e mandat de Bouteflika (Marie Magnin / HANS LUCAS / AFP)
C’est le sens du titre et du sous-titre de votre dernier livre…
Oui, La Parole du mille-pattes évoque un dicton ancestral ivoirien : « C’est avec de bonnes paroles que le mille-pattes traverse un champ fleuri de fourmis » : ni la violence ni la ruse ne permettront de donner au conflit une solution satisfaisante. Il faudra parler, parler, pour trouver ensemble une solution. Son sous-titre, Difficile démocratie, évoque ce que cela suppose d’efforts pour chacun de nous. Les livres que j’avais consacrés à Rousseau puis à Mandela m’ont fait creuser ce sillon. Dans celui-ci je remonte aux traditions africaines, amérindiennes, asiatiques pour analyser sous un autre angle le rapport des humains à la politique. Pourquoi, avec les savoirs accumulés et les outils modernes de communication, on ne parviendrait pas à réinventer à une autre échelle les traditions qui ont permis à notre espèce de vivre pendant des dizaines de millénaires ? C’était le pari de Mandela avec la transposition de l’ Ubuntu à l’échelle de l’Afrique du Sud avec les trois années de discussion publique de « vérité et réconciliation ».
Le philosophe Cornelius Castoriadis disait de l’homme qu’il « est un animal paresseux ». Et, citant l’historien Thucydide, il ajoutait : « Il faut choisir : se reposer ou être libre ». Peut-on imaginer une société qui, passée l’effervescence d’un hypothétique moment révolutionnaire, soit à même, ou seulement désireuse, de s’investir dans la chose publique avec une intensité presque quotidienne ?
Kant parlait déjà de cette « paresse », de ce qui nous fait préférer somnoler. Il y voyait la cause du maintien du peuple dans un état de « minorité », au profit de ces « tuteurs » qui se prétendent indispensables. Une phrase de Kant résume bien ce qui malheureusement demeure un diagnostic sévère mais lucide : « Après avoir abêti leur bétail et avoir soigneusement pris garde de ne pas permettre à ces tranquilles créatures d’oser faire le moindre pas hors du chariot où il les a enfermées, ils leur montrent le danger qui les menace si elles essaient de marcher seules. » On en est là, mais parfois il en est qui ruent ici et là. Après Étienne de la Boétie, Spinoza ou Rousseau, Michel Foucault a définitivement démontré qui si le pouvoir s’exerce du haut vers le bas, c’est parce que dans l’ensemble de la vie sociale le pouvoir se transfère du bas vers le haut. Cette délégation liberticide ne relève guère d’une fatalité, mais infléchir ce processus est une tâche historique d’une difficulté extraordinairement grande. C’est ainsi, comme vous le dites, qu’après de rares mais précieux moments de soulèvement, de reprise en mains par le peuple de ses propres affaires, le courage démocratique tend à décliner et laisser place à cette paresse. La souveraineté, qui était si jalousement conservée pendant des dizaines de millénaires, passe aujourd’hui pour un idéal inaccessible. C’est ce processus de dépossession que je m’efforce d’explorer, mais tout montre qu’on ne peut espérer le combattre qu’en combinant ce type de réflexions à des pratiques sociales et politiques collectives.
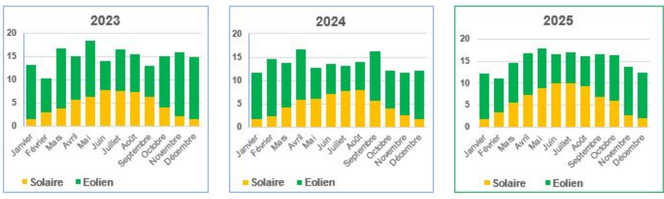
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire