Alexis Moreau
Lorsqu’elles décident de fermer un site, les multinationales ne lésinent pas sur les moyens. Quitte, dans les cas extrêmes, à saboter les machines. La « loi Florange » de 2014 leur impose la recherche d’un repreneur, mais sans obligation de résultat. Comme les directions n’ont souvent aucune envie de voir s’implanter un concurrent – ou, pire, de laisser les clés aux salariés qui auront créé leur société coopérative – elles usent de tous les stratagèmes disponibles pour empêcher une reprise. Combien de sites industriels rentables ferment ainsi chaque année ?
A Docelles, un village niché au creux des Vosges, la nouvelle a semé la consternation cet automne. La direction du groupe forestier finlandais UPM aurait envoyé une équipe pour saboter son ancienne papeterie, à l’arrêt depuis 2014 et dont les équipements devaient être vendus aux enchères quelques jours plus tard. Objectif : empêcher des concurrents de racheter les pièces pour les remettre en service ailleurs. Les saboteurs n’ont pas hésité à percer des machines neuves, dont certaines valent jusqu’à 700 000 euros pièce.
« La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre, et des journalistes de tout le pays sont venus faire des reportages, raconte le maire, Christian Tarantola [1]. Tout le monde est écœuré. Des habitants sont venus me trouver pour tenter de comprendre. » Ancien représentant CFE-CGC, Nicolas Prévot a travaillé 17 ans dans l’usine : « En l’apprenant cela dans la presse, j’ai eu, comme les autres, un sentiment d’immense gâchis. Dans toute cette affaire, nous n’avons jamais eu notre mot à dire. UPM nous a menti depuis l’annonce de la fermeture, en prétendant qu’ils avaient l’intention de vendre. »
Fermer des usines pour faire monter les prix
Lorsque le DRH apprend aux salariés, un matin de 2013, que le groupe a l’intention de fermer le site six mois plus tard, c’est le début d’une course contre la montre. Plusieurs projets de rachat émergent, dont un plan de reprise en société coopérative et participative (Scop) porté par les 85 salariés de l’usine (lire ici). L’usine attire aussi des industriels du papier, comme Pocheco, basé dans le Nord [2]. Son dirigeant, Emmanuel Druon, bataille pour racheter le site. Sans succès.
« Quand l’annonce de mise en vente a été publiée, nous avons sauté sur l’occasion, explique-t-il. La papeterie de Docelles est une entreprise ancienne mais polyvalente et moderne, capable de produire des papiers de grande qualité. Notre idée était de nous implanter sur des marchés de niche, afin de ne pas se frotter aux grands groupes. » Pourtant, Emmanuel Druon se heurte à un mur : « Les émissaires du groupe m’ont fait comprendre qu’ils se fichaient de notre projet. Leur préoccupation était de fermer des usines en série pour réduire l’offre de papier sur le marché européen, et faire remonter les prix, cela afin d’augmenter leurs marges. J’ai appris par la suite que les coûts de fermeture du site devaient être amortis en cinq ans par UPM, grâce aux seuls gains représentés par les hausses de taux de marge. »
Au nom de la « liberté d’entreprendre »
UPM n’aura donc pas hésité à saboter l’usine avant de partir. Son dirigeant français avoue, au détour d’un article, que le procédé a été utilisé dans d’autres pays européens, accréditant la théorie d’Emmanuel Druon. Si ces sabotages choquent par leur brutalité, ce qu’ils révèlent n’a rien d’inédit. Bien souvent, les grands groupes rechignent à céder une usine destinée à être fermée. C’est précisément pour leur forcer la main qu’une loi est entrée en application en 2014, après des mois de polémique – et une promesse un peu hâtive formulée par le candidat François Hollande sur le toit d’une camionnette. Surnommé « Loi Florange », le texte oblige les entreprises de plus de 1000 salariés à chercher un repreneur lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une usine impliquant des licenciements.
A l’époque, le Medef était monté au créneau, dénonçant sans originalité une atteinte à la liberté d’entreprendre. Les partisans du texte n’avaient pourtant rien de dangereux révolutionnaires, à l’instar du très modéré François Brottes, ex-député PS : « Nous vivons dans un système de libre-échange, c’est exact, déclarait-il alors. Mais si une entreprise travaille à créer un désert autour d’elle, en empêchant que les activités qu’elle arrête soient reprises par les salariés ou par d’autres concurrents, joue-t-elle le jeu du libre échange ? »
La « reprise », un marché pour les cabinets de conseil
Initialement, la proposition de loi prévoyait d’obliger les grands groupes à céder leur usine. A l’arrivée, l’obligation de résultat a été abandonnée, au profit d’une simple obligation de moyen. Les entreprises doivent prouver qu’elles ont entamé des démarches, sous peine de voir retoqué leur plan social par l’administration. En pratique, ce ne sont pas les directions elles-mêmes qui prospectent les repreneurs, mais des cabinets spécialisés. Il peut s’agir de sociétés ayant pignon sur rue, qui prospèrent sur le marché des restructurations : BPI, Altedia, Alixio, etc.
Bastamag s’est procuré un contrat conclu en mai 2016 entre l’entreprise d’équipement de salles de bains Allia, filiale de la multinationale suisse Geberit, et le cabinet de conseil en « ressources humaines » Altedia. Allia s’apprêtait à fermer deux sites, laissant 230 salariés sur le carreau. Le document récapitule les missions confiées à Altedia : ciblage des candidats à prospecter, « prospection intensive » durant quatre mois, visites, suivi... Au total, les honoraires du cabinet s’élèvent à 90 000 euros – hors bonus en cas de rachat. Un passage du contrat souligne la préoccupation majeure de la multinationale : garantir l’homologation par l’État du plan social.
Le rôle parfois ambiguë des experts
Le choix d’ Altedia résume à lui seul l’ambiguïté de la démarche. Fondé en 1992, ce cabinet ne s’occupe pas seulement de la recherche de repreneurs, mais aussi du reclassement des salariés licenciés dans le cadre de plans sociaux (PSE). Une activité encore plus lucrative. Se pose alors la question du conflit d’intérêts. Un cabinet responsable des deux prestations – et qui sera donc gagnant quelle que soit l’issue de la procédure de reprise – aura-t-il réellement intérêt à éviter la fermeture d’un site, qui lui assurerait la gestion d’un « plan social » conséquent ?
 Lire notre enquête : Derrière les plans sociaux, le business des cabinets de « reclassement »
Lire notre enquête : Derrière les plans sociaux, le business des cabinets de « reclassement » Un expert comptable habitué des restructurations s’est livré pour Bastamag à une estimation, inspirée de cas qu’il a pu traiter. Dans cet exemple théorique, une multinationale envisage de fermer un site de 300 salariés. Un cabinet candidate pour la recherche de repreneurs, et pour la prise en charge d’éventuels reclassements.
Dans une première hypothèse, le sauvetage aboutit. Le cabinet empoche alors 1 150 000 euros – soit 150 000 euros d’honoraires fixes liés à la recherche de repreneurs auxquels s’ajoute un million d’euros de bonus lié à la réussite de la reprise.
-Seconde hypothèse : la reprise échoue, et tous les salariés sont licenciés. Le cabinet peut espérer toucher 150 000 euros d’honoraires fixes, plus 1,35 millions pour le reclassement des salariés – à raison de 4500 euros par salarié suivi [3]. Soit un total d’1 500 000 euros. Dans cet exemple fictif, l’échec de la reprise rapporte 350 000 euros supplémentaires au cabinet de conseil !
L’art et la manière de faire échouer une reprise
Dans le dossier Allia, Altedia s’est occupé à la fois de la recherche du repreneur et du reclassement (Bastamag a cherché à contacter Altedia à plusieurs reprises, sans succès). des salariés. A l’arrivée, un des deux sites a fermé ses portes. L’autre a échappé à la fermeture, après une longue mobilisation des salariés. Conclusion de notre expert : « Dans ce cas de figure, qui n’est pas rare, un cabinet a objectivement intérêt à ce que la reprise échoue. Cela ne veut pas dire qu’il bâclera le dossier ! Mais le doute subsiste. Pour l’éviter, les directions devraient refuser d’engager le même prestataire pour les deux missions. »
Mais ces mêmes directions y ont-elles intérêt ? Bien souvent, elles emploient plus d’énergie à fermer un site qu’à trouver un repreneur. En pratique, il n’est pas difficile de plomber un sauvetage industriel tout en faisant mine de respecter la loi. Il suffit par exemple d’exclure du champ des recherches les concurrents directs. Dans le contrat signé par Allia et Altedia, par exemple, le cabinet de conseil indique, dans la rubrique « ciblage d’entreprises à prospecter » : « Éventuelle "blacklist" des concurrents d’ Allia ». Ce choix interroge : les repreneurs les plus à même de racheter un site et de valoriser ses compétences humaines et matérielles sont, bien souvent, des industriels du secteur.
Une autre méthode consiste à décourager les repreneurs. « Pour caricaturer, si vous faites le portrait d’un site en expliquant qu’il est loin de tout, peu attractif et que l’activité n’a aucun avenir, vous n’attirerez pas grand monde », résume Jean-Vincent Koster, expert auprès des comités d’entreprise. Il cite un exemple de dossier monté pour la reprise d’un site par un cabinet patronal : « On a dit au cabinet, sur le ton de la blague : "Si vous arrivez à trouver un repreneur avec un dossier pareil, vous êtes très forts !" Leur description était totalement à charge. Ils n’évoquaient ni le potentiel de relance du site, ni les compétences des salariés. »
Les salariés mieux servis par eux-mêmes ?
Mais les candidats au rachat ne sont pas forcément des industriels. Ce sont parfois les salariés eux-mêmes qui tentent de reprendre leur usine menacée. Bien souvent, ils ont intérêt à s’armer de courage, car les directions ne leur facilitent pas la tâche. Les salariés de Fralib en savent quelque chose, qui ont dû ferrailler trois ans contre leur ancien employeur, la multinationale agroalimentaire Unilever, pour reprendre leur usine de sachets de thé. Les employés de la Seita, filiale française d’ Imperial Tobacco, vivent le même chemin de croix. Ils tentent de relancer leur usine de Riom, vouée à la fermeture pour cause de délocalisation en Pologne.
 Lire notre reportage : Les anciens de Fralib et leur coopérative lancent le thé de la transformation sociale et écologique
Lire notre reportage : Les anciens de Fralib et leur coopérative lancent le thé de la transformation sociale et écologique Une quarantaine d’entre eux ont monté un projet de Scop, qui commercialiserait des dosettes - les tubes dans lesquels on fabrique soi-même sa cigarette. Dans leur business plan, les salariés tablent sur un retour à l’équilibre en 2020. « Notre projet est soutenu par les responsables politiques locaux, la Confédération des Scop et les buralistes du département, assure Stéphane Allègre (CGT). Mais le groupe refuse de nous céder les machines. A la limite, je comprends qu’ils hésitent à nous laisser les locaux : un site de 80 000 mètres carrés peut représenter une jolie plus-value immobilière en cas de revente. Mais les machines ne leur serviront à rien. Ils vont les détruire, ou les revendre à prix cassé. »
La reprise par les salariés, une menace idéologique
L’argument de la concurrence ne tient pas vraiment ici. On voit mal comment une Scop de 40 salariés pourrait rogner les marges d’une multinationale pesant 30 milliards d’euros. « Cet argument ne fonctionnait pas davantage dans le cas de Fralib, note un avocat parisien. Au fond, la vraie raison est peut-être d’ordre psychologique, voire idéologique : quand un groupe tire un trait sur une usine, il n’a aucune envie de voir une poignée de travailleurs la remettre en marche. Dans une économie libérale, ce ne sont pas les salariés qui décident. Ce sont les directions ! »
En moyenne, quelque 200 sites industriels baissent le rideau chaque année [4]. Certes, tous ne sont pas rentables, mais combien d’usines pourraient échapper à la casse ? Il n’existe pas de statistiques publiques recensant les reprises. Le cabinet Trendeo nous a néanmoins fourni ses propres estimations, en partie réalisées à partir de la presse locale. Le nombre de sauvetages de sites menacés reste marginal : 14 en 2013, 28 en 2014, 12 en 2015, 8 en 2016. Une chose est sûre : la loi Florange, promulguée en 2014, n’a pas suffi à inverser la tendance.
Photo : un salarié de l’usine Fralib, reprise en coopérative par une partie des salariés après une longue bataille contre Unilever / Jean de Peña (Collectif à-vif(s))
Notes
[1] Voir ici, là, ou encore là.
[2] L’entreprise Pocheco et ses pratiques sociales et environnementales ont fait l’objet de précédents articles de la part de Bastamag. Voir ici et là.
[3] Dans cet exemple théorique, les honoraires du reclassement intègrent la part variable maximale (100% de reclassés).
[4] En cinq ans, les statistiques du cabinet spécialisé Trendeo indiquent : 266 fermetures en 2012, 267 en 2013, 217 en 2014, 190 en 2015, 136 en 2016.
php
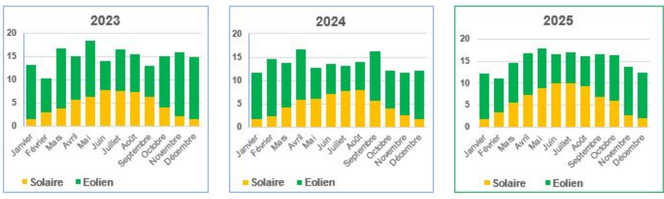
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire