30/09/2019

Entretien avec le Collectif Rosa Bonheur
Le collectif de chercheuses et chercheurs Rosa Bonheur1 a publié le 19 septembre dernier aux Editions Amsterdam La ville vue d’en bas. Travail et production de l’espace populaire. Le livre est une plongée dans la vie quotidienne des classes populaires aux marges du salariat en même temps qu’un renouvellement salutaire des approches théoriques sur le sujet.
Entretien au long cours avec Antonio Delfini.

Contretemps (CT) : « Que font les gens dont on dit qu’ils ne font rien ? » C’est en résumé la question que vous vous êtes posée avec cette enquête. Dans votre bouquin, vous proposez d’appréhender à nouveaux frais le quotidien des classes populaires aux marges du salariat en construisant le concept de « travail de subsistance ». Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par-là ?
Rosa Bonheur (RB) : avec cette enquête, nous voulions comprendre ce qui se cache derrière les chiffres du chômage et de l’inactivité qui touchent de plein fouet les quartiers populaires et les villes désindustrialisées. Ces chiffres disent une paupérisation impressionnante des populations mises en marges des marchés de l’emploi et de la consommation ainsi qu’une dégradation toute aussi forte de leurs conditions d’existence. Mais paradoxalement ces chiffres peuvent tout autant être utilisés par les pouvoirs publics pour rendre les gens coupables de leur situation, en les présentant comme « fainéants », « assistés », etc., ou pour stigmatiser leurs pratiques. Aller à la rencontre de ces personnes, chercher à comprendre comment ils organisent leur quotidien, comment ils font face concrètement aux problèmes de la subsistance et de la stigmatisation que subissent les quartiers populaires, ça nous permettait d’interroger les effets de la désalarisation à partir d’un point de vue qui est souvent invisibilisé, mais qui existe et qui doit être dit : de regarder cette réalité « par en bas ».
Grâce à cinq années d’enquête ethnographique, nous avons découvert que les gens « dont on dit qu’ils ne font rien » sont en réalité très actifs et réalisent ce que nous nommons le travail de subsistance, fait d’emplois précaires pour celles et ceux qui y ont accès, mais surtout d’activités informelles qui parfois permettent de produire des revenus, d’autoproduction et d’échanges divers en vue de prendre soin des autres. Quelques exemples : s’occuper collectivement des personnes âgées, des enfants, des malades, mais au-delà, prendre soin des besoins de chacun des membres de la famille ; bricoler ce qu’on a récupéré, rénover son logement, trop souvent affecté par l’insalubrité, réparer sa voiture ou celle des autres contre un peu d’argent ; gérer la relation avec les administrations, avec les travailleurs sociaux, en vue d’une activation de droits de plus en plus problématique ; s’occuper d’un jardin pour récolter ses propres légumes ; mettre en vente des biens autoproduits, offrir des services par le biais d’affichettes collées dans les fenêtres, dans les magasins du coin, les boulangeries ; gérer des loisirs pour l’épanouissement de la famille… Autant d’activités qui sont immédiatement orientées vers la satisfaction de besoins des proches et qui s’inscrivent dans des réseaux de proximité. 24 heures par jour ne suffisent pas pour garder la tête hors de l’eau quand on n’a plus, ou seulement ponctuellement, accès au travail rémunéré. Le travail de subsistance est à la fois dans et hors du marché, il permet de satisfaire les besoins de la vie quotidienne, alors que ceux-ci ne peuvent plus être satisfaits par les petits salaires des boulots trop précaires ni même par les minima sociaux.
Une grosse partie de notre enquête a donc consisté à montrer en quoi ce travail de subsistance construit aujourd’hui le quotidien partagé des classes populaires en marge de l’emploi. Notre livre est plein de récits de vie et de ces moments de vie quotidienne dans lesquels les gens des classes populaires stigmatisées, les subalternes, font des choses pour eux-mêmes et pour autrui, pour subsister dignement.
CT : Mais, par-là, vous englobez sous le même qualificatif de « travail » un ensemble de pratiques qu’on ne reconnaît pas comme tel habituellement…
RB : Oui. Et même du côté des habitants, ces activités qui se déploient dans l’espace urbain, dans les friches laissées vacantes par la désindustrialisation, dans les logements ou dans les centres sociaux sont rarement, ou inégalement, qualifiées de travail. Car la plupart du temps elles ne donnent pas lieu à rémunération.
Pourtant, cette organisation doit, pour nous, être qualifiée de travail au sens où elle résout le problème de la reproduction et en même temps inscrit les individus dans une chaîne de réciprocités. Elle a besoin de formes de spécialisation dans les activités, elle a besoin aussi des savoir-faire qu’on produit collectivement, qu’on s’échange, qu’on se transmet, à la maison, dans la rue. Ces activités de travail sont connectées entre elles, elles fondent des économies populaires où chacun peut et doit trouver sa place, où chacun est rétribué, ne serait-ce que moralement, selon ses capacités.
CT : Vous interprétez ces différentes pratiques – le plus souvent reléguées à la marge des analyses ou même carrément occultées – comme faisant partie d’un nouveau régime spécifique de travail qui se distingue du régime salarial de la période fordiste. Qu’est ce qui fait système dans ce nouveau régime ?
RB : Dans la société fordiste, si nous suivons les travaux de Robert Castel, c’était le revenu qui contenait l’essentiel des ressources nécessaires à la subsistance –revenu direct qui permet la consommation de produits standards dans les marchés, et différé en termes d’accès à des prestations et des droits sociaux. Était-ce la seule forme de travail qui existait ? Non. Des économistes du Sud comme Enzo Mingione attirent l’attention sur le rôle d’autres populations non salariées qui étaient spécialisées dans d’autres formes de travail, qui jouaient un rôle très important dans la production et la distribution de ressources de subsistance, mais qui ne comptaient pas en termes politiques ni économiques. Il y avait, d’une part, l’espace du travail reproductif, en grande partie pris en charge par les femmes, qui était subordonné au travail de production de valeur. D’autre part, à cheval entre l’espace domestique et le marché, il y avait le travail indépendant qui se construisait sur d’autres logiques et temporalités que celles de l’efficacité capitaliste. Enfin, d’autres formes de travail comme le travail d’autoproduction, lié aux économies domestiques et urbaines de subsistance, étaient devenues « travail à côté » selon l’expression de Florence Weber, c’est-à-dire une expression culturelle d’un rapport esthétique au travail et au monde de la part des ouvriers et ouvrières.
À partir des années 1970, la fragmentation des marchés du travail a fait éclater l’universalité du « travailleur salarié » comme figure de la normalité ouvrière. Elle a donné une nouvelle place aux formes et espaces économiques qui étaient subordonnés à l’économie capitaliste : les espaces de l’économie domestique et urbaine de subsistance, du travail reproductif et de l’autoproduction.
Les capacités productives des individus et des collectifs n’ont pas été annihilées par la désindustrialisation, elles se redéploient et s’inscrivent dans des réseaux de réciprocité selon des rationalités plus sociales et morales qu’économiques. Elles impliquent néanmoins une réorganisation de la sphère familiale selon un principe d’activation économique. Ce que nous observons c’est que la sphère domestique et, au-delà, la vie dans les quartiers populaires, sont entièrement colonisées par le travail de subsistance qui – peu rémunéré, quand il l’est – ne permet pas de sortir complètement la tête de l’eau.
Ce travail de subsistance a donc pris dans certains quartiers une place essentielle, et en partie autonome du marché. Ce travail, qui ne vise pas à la production de valeur dans une logique purement capitaliste, acquiert désormais une place prépondérante dans l’espace matériel et social des classes populaires maintenues aux marges du salariat. Il se diffuse à mesure que le marché formel du travail se réduit, que la pauvreté nécessite l’organisation d’échanges de services, le recours à l’autoproduction ainsi qu’à un tissu commercial partiellement autogéré ou destiné explicitement aux classes populaires.
Pour autant, et c’est un aspect qui nous semble important d’être rappelé, la culture de la débrouille qui sous-tend le travail de subsistance est tout à fait compatible avec une gestion dérégulée de la main-d’œuvre qui fait reposer les coûts de reproduction sur chaque travailleur individuel ainsi que sur la communauté de travail. C’est-à-dire que sans une revendication politique, collective, ces économies urbaines de subsistance peuvent se dissoudre dans la logique de la promotion d’un entrepreneuriat de soi très cohérent avec un régime d’intensification du travail. Un contre-exemple intéressant ici est celui des travailleurs des économies populaires en Argentine qui se sont organisés depuis 2011 pour défendre le droit à une vie bonne dans les quartiers populaires.
CT : Votre enquête ne se contente pas de mettre en évidence les diverses facettes de ce « travail de subsistance ». Elle montre également – et c’est sans doute l’un des aspects les plus intéressants de votre livre – que ce travail entretient un lien étroit avec l’espace quotidien des classes populaires. Dans votre approche, travail et espace sont inextricablement liés. L’espace est à la fois support et résultat du travail de subsistance. Pouvez-vous développer ce rapport dialectique ?
RB : En schématisant quelque peu, on peut dire que Michel Foucault a mis l’accent sur le territoire comme dispositif de disciplinarisation des populations. Ensuite, on a appris avec David Harvey comment le territoire est support du processus de valorisation du capital. Ce que nous voulons montrer c’est que le territoire est aussi un espace de valeur d’usage. Et donc que, par le travail de subsistance, les classes populaires façonnent la ville, produisent leur propre espace : elles ne sont pas passives dans les quartiers ou villes qu’elles habitent, au contraire, elles les disputent.
À l’époque fordiste, la ville-usine était un modèle qui s’incarnait dans une organisation spatiale et sociale construite à partir de l’usine comme dispositif de régularisation des comportements, de séparation et hiérarchisation des espaces, des temps sociaux, des statuts… Les économies familiales et domestiques ainsi que les économies d’autoproduction y étaient largement subordonnées et cantonnées dans des espaces très contrôlés et normés.
La désindustrialisation a suscité un réarrangement complexe de ces différents espaces économiques. La sphère capitaliste, au sens de Braudel, a perdu sa prééminence : si elle occupe encore une partie de l’espace urbain – via notamment la reconversion tertiaire d’une partie des anciens lieux de production industrielle –, elle n’organise plus l’espace social des classes populaires. Hormis les emplois précaires et subalternes de service, les emplois qualifiés de cette économie tertiarisée ne leur sont pas accessibles. En revanche, les espaces laissés vacants par le reflux du capitalisme industriel et financier sont réinvestis par le travail de subsistance.
Ce travail se fait dans, sur et pour l’habitat. C’est en ce sens-là que ce sont des habitants-travailleurs. Le travail qui se faisait dans des espaces qui étaient strictement conçus pour ça, les usines et les ateliers, se fait aujourd’hui dans l’habitat au sens large, c’est-à-dire à l’intérieur du logement, sur les parkings, dans la rue. Le travail irrigue la ville, il se déploie désormais dans des espaces qui ne sont pas des espaces spécialisés.
Dans l’ouvrage nous montrons comment le travail de subsistance se diffuse au sein des familles à mesure que le marché formel du travail se réduit, que la pauvreté nécessite l’organisation d’échanges de services, le recours à l’autoproduction ainsi qu’à un tissu commercial partiellement autogéré ou destiné explicitement aux classes populaires. La conclusion de l’ouvrage prolonge d’ailleurs ce constat empirique par une discussion sur la déspécialisation des usages de l’espace de la ville populaire .
CT : Votre enquête va à l’encontre des travaux sociologiques qui ne voient les quartiers populaires que comme des espaces de relégation, de ghettoïsation. Elle met en revanche l’accent sur ce que permet le quartier. Un « effet de quartier » inversé en somme. Ce que vous appelez « centralité populaire ».
RB : Oui, l’enquête nous a conduits à qualifier de « centralité populaire » l’espace urbain pourtant délaissé par le capital et relégué socialement. Car depuis les classes populaires, cet espace est central. Il remplit trois fonctions décisives : permettre l’accès au logement abordable ; fournir différentes formes de travail, de revenus et de consommation à bas prix ; et enfin donner accès aux ressources relationnelles que les habitants tirent de l’ancrage dans l’espace local. Cet ancrage est produit par le travail des classes populaires elles-mêmes du fait de l’inscription spatiale du travail de subsistance.
L’espace constitué en centralité populaire est donc à la fois un espace ségrégé et d’ancrages contraints, mais aussi de mobilité. Il est un espace support de trajectoires sociales et familiales diversifiées permettant souvent de ne pas tomber dans la misère, de résister au déclassement et, parfois, d’assurer une mobilité sociale ascendante.
Cette « centralité populaire » est pleine de liens et de ressources. Ces liens font parfois communauté, sans que l’on puisse réduire la nature de la centralité populaire à des liens communautaires.
Mais ces liens obligent : on y a vu de la suraffiliation. Ce n’est donc pas un espace enchanté pour les habitants qui y vivent, il est traversé par de fortes déterminations de genre et ethno-raciales, ce qui crée d’autres fragmentations entre sous-groupes sociaux. Pour autant, nous ne parlons pas de centralité ouvrière ou centralité immigrée, car ces pratiques touchent les mondes populaires dans leur ensemble et ne sont pas des pratiques liées à la seule ethnicité des habitants.
Ce concept nous permet donc de prendre au sérieux les conséquences de la concentration socio-spatiale des classes populaires tout en prenant nos distances avec les représentations disqualifiantes des politiques publiques décrivant les espaces populaires comme relégués, ghettoïsés.
CT : Il est possible de tirer de nombreuses conséquences politiques de vos résultats de recherche. Sur un modèle inspiré des formes d’organisation du prolétariat industriel, une option politique serait de reconnaître les habitants des classes populaires avant tout comme des travailleurs et de pousser à la création de nouvelles formes de représentation sur le modèle du syndicat. Une autre approche pourrait pousser à l’autonomisation du travail de subsistance en renforçant ses assises communautaire et familiale pour en faire un espace de travail et d’échange extérieur au marché formel. Que pensez-vous de ces deux options ? En existe-t-il d’autres ? Et, plus largement, comment vous positionnez-vous vis-à-vis des conséquences politiques de vos travaux ?
RB : L’enjeu de notre bouquin, c’est effectivement de qualifier la population des quartiers populaires non pas comme des habitants mais comme des travailleurs urbains. Et à partir de cette focale essayer de comprendre autrement les relations sociales qui se tissent au sein de la ville entre les différents acteurs. Il y a une forme de désinstitutionnalisation du travail qui avant était très cadré, au sein de l’entreprise mais également dans les mobilités quotidiennes, les trajectoires résidentielles, etc. Aujourd’hui, tout ça s’est transformé radicalement. Et penser aujourd’hui les rapports entre voisins comme étant des rapports de travail qui produisent une ville et une vie habitable, ça permet de changer de perspective.
Dans ce cadre, de nouveaux acteurs participent de la régulation de ce travail. Qui participe aujourd’hui de la régulation du travail des mécaniciens de rue ? La police, la municipalité, les voisins, les travailleurs formels, les femmes des mécaniciens. Qui régule le travail de subsistance des femmes? Le monde associatif, les administrations publiques, leurs conjoints, leur entourage familial et résidentiel plus largement. Se repose donc à nouveaux frais la question de l’organisation de ces travailleurs, de leur représentation et finalement de leur identité sociale. Dans ce nouveau contexte, on ne peut plus se construire uniquement dans l’opposition entre « nous », les travailleurs, et « eux », les patrons, bien que cette opposition reste bien évidemment essentielle. Mais à une échelle locale, et du point de vue des acteurs des économies de subsistance, un nouvel enjeu apparaît autour du territoire, de l’espace, de la ville et du quartier. Les usages de l’espace sont ce qui aujourd’hui donne la consistance à l’action politique des classes populaires. Une action politique qui porte autour de l’accès à des ressources, de la construction d’un « nous » valorisant …
CT : Si on vous suit, l’espace joue désormais un rôle central dans la construction d’une nouvelle conflictualité sociale. Dès lors est-il possible de présenter synthétiquement cette dynamique de construction d’une centralité populaire comme un mouvement qui s’oppose aux processus de gentrification ou de métropolisation ? Selon vous, les mobilisations actuelles qui portent sur les transformations urbaines et notamment celles qui luttent contre la gentrification doivent-elles défendre les centralités populaires ?
RB : Oui, mais il ne faut pas l’interpréter comme un mouvement d’opposition. Des résistances existent mais demeurent généralement discrètes. Si des contestations plus mobilisatrices se font parfois jour, la centralité populaire est surtout le résultat d’une production ordinaire de la ville, dont le peuplement populaire est entretenu par l’offre de logement et la possibilité de déployer le travail de subsistance.
En effet, ce que l’enquête nous a appris c’est que la centralité populaire est le résultat d’un travail actif des classes populaires : auto-réhabiliter son logement dégradé, devenir propriétaire, voire bailleur, héberger les siens ; réparer des voitures dans la rue, travailler depuis son domicile et vendre des services et des objets par annonces sur internet et sur les fenêtres ; ouvrir un petit commerce à bas prix, embaucher des hommes et les femmes peu qualifiés, immigrés locaux. En somme, les classes populaires fabriquent la ville. Elles le font sous la contrainte économique et la ségrégation résidentielle mais ces pratiques favorisent un processus d’autonomisation partielle – au sens d’une dépendance atténuée aux logiques de marché. En cela elle s’oppose ou ralentit les effets des politiques d’habitat et de rénovation urbaine qui appliquent le dogme de la mixité sociale depuis maintenant plus de vingt-cinq ans.
En revanche, les pratiques constitutives de la centralité populaire sont l’objet d’une répression de la part des pouvoirs publics, fermeture du marché aux puces, imposition d’un plan de rénovation urbaine, fermeture d’une crèche, coupes successives des subventions aux associations, renforcement de l’encadrement des pratiques de réhabilitation, contrôle renforcé des bénéficiaires du RSA. La centralité populaire est donc bien soumise à l’action de pouvoirs publics et aux processus de marché. En cela oui, il faut la défendre sous peine de voir s’accélérer le processus de changement de la population d’un espace.
CT : Votre travail, qui s’inscrit à la croisée de différentes approches théoriques est sur beaucoup d’aspects une relecture du marxisme, non ?
RB : L’objectif au départ ce n’est pas de rénover le marxisme, mais notre approche est résolument matérialiste puisque, d’une part, nous questionnons la manière dont un espace social produit et distribue des ressources pour garantir la subsistance de ses membres – se nourrir, se loger, consommer des biens et des services, par exemple, s’habiller correctement, être en bonne santé physique et mentale, s’épanouir. Et ensuite, parce que nous interrogeons la façon dont les postes de travail, les rôles et les fonctions se distribuent,qui fait quoi ?, sachant qu’à chaque place dans la division sociale du travail correspond un statut social plus ou moins prestigieux.
Notre effort conceptuel se situe d’abord dans le prolongement des analyses féministes autour du travail domestique : nous retenons une approche extensive du terme de travail, en refusant d’en cantonner l’usage au travail rémunéré, ce qui a longtemps contribué à ne voir que le travail productif masculin et on sait quelles sont les implications politiques d’une telle occultation. Dans ce cheminement, nous nous retrouvons dans les travaux qui portent sur le travail domestique, bien sûr, et plus largement sur le travail gratuit. Le travail de subsistance se situe à une échelle autre que celle du marché : l’échelle de la production matérielle de l’existence. Nous montrons aussi que le capital ne cesse de s’approprier ce travail non rémunéré, et d’ailleurs c’est parce qu’il se l’approprie que les salaires sont si bas dans les économies périphériques : celles où sont employés, parfois, les mécanos qui ont appris leur métier dans la rue et qui proposent leurs services dans les ateliers agréés ou les concessionnaires, celles où s’emploient ponctuellement ou régulièrement les femmes qui travaillent à domicile ou qui s’occupent des vieux et des malades des familles des classes moyennes, la coiffure, le bâtiment, etc. Donc, pour nous, le premier enjeu consiste à identifier ces populations comme étant des travailleurs, et à montrer qu’ils ne sont ni reconnus ni rémunérés à leur juste valeur.
Ensuite, nous insistons sur l’inscription spatiale de ce travail, nourrie par les travaux menés en Espagne et en Amérique latine sur les économies populaires de subsistance, et par la géographie radicale. Dans cette démarche, nous avons aussi trouvé de très forts échos dans les travaux historiques, au premier plan desquels ceux de Braudel, pour souligner les relations conflictuelles mais aussi d’interdépendance qui peuvent exister entre la diversité de mondes économiques qui composent une unité spatiale. L’usine avait été le dispositif qui avait permis d’articuler le capitalisme, comme dynamique d’accumulation et de captation de ressources par différents procédés, à l’économie marchande, fondée sur les transactions marchandes et le crédit, et enfin à la vie matérielle, qui est la plus imbriquée aux structures familiales et à l’environnement au sens large. Il s’agit de questionner aujourd’hui de quelle façon ces différents mondes économiques s’articulent dans la production des espaces populaires. Nous posons ici un deuxième enjeu qui a trait à la production conflictuelle de la ville populaire.
Enfin, nous avons voulu questionner le problème de la sociabilité, c’est-à-dire du problème du rapport entre travail et production de société qui avait été discuté par Marx mais aussi par Durkheim, et que nous interrogeons dans le contexte de la dissolution de la ville-usine et de la réinscription du travail dans les réseaux de réciprocité, familiaux, urbains et communautaires. Le travail de subsistance ne permet pas seulement d’accéder à ou de produire des ressources nécessaires aux besoins de la vie quotidienne. Il assure aussi la production de liens sociaux, il permet des processus d’identification positive, il a enfin une fonction morale réparatrice. L’économie de subsistance produit un système de valeurs à la hauteur des stigmates et des discriminations vécues par les classes populaires. Parmi ces valeurs, on retrouve l’attachement au travail bien fait, le respect des hiérarchies notamment générationnelles, la séparation des tâches des femmes et des hommes. Le travail de subsistance permet donc de restaurer une honorabilité, un prestige, une respectabilité, qui agissent localement. Pour autant, nous n’avons pas voulu donner une vision angélique ou irénique des choses, et nous mettons au jour des rapports de pouvoirs, des inégalités très fortes et effets de domination notamment des hommes sur les femmes, des fragmentations internes aux classes populaires multiples. La notion d’économie morale, que nous mobilisons à la suite d’ Edward Thompson et de James Scott, est ainsi doublement relationnelle et conflictuelle : il y a des conflits de valeurs entre les classes populaires et les autres classes, par exemple quand les membres des classes populaires affirment : « mais nous sommes des travailleurs, pas des fainéants, des assistés ou des voleurs ! » ; mais il y a des conflits internes aux classes populaires qui ont trait à l’inégale reconnaissance du travail fourni par chacun.
CT : L’élaboration de ces différents concepts s’appuie sur une longue enquête monographique réalisée dans la ville de Roubaix. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’agencement entre les intentions de départ, le choix et la découverte du terrain et la construction de ces catégories d’analyse ?
RB : En 2010, une partie de l’équipe va en Argentine, et rencontre des travailleurs informels qui sont complètement en dehors des statistiques mais qui s’organisent, et réclament des droits. L’action associative et politique est complètement différente là-bas. Il y a tout un travail militant d’organisation populaire qui est central. Nous sommes arrivés à Roubaix dans l’idée de retrouver ça : ces gens qu’on représente comme étant des fainéants, des assistés, dont on dit qu’ils sont dangereux, qu’est-ce qu’on ne connaît pas d’eux ?
Nous avons choisi d’enquêter à Roubaix pour plusieurs raisons, de natures très différentes. Roubaix est une ville exemplaire par son histoire industrielle, ville anciennement très riche, capitale mondiale du textile, qui permet l’avènement d’une bourgeoisie très prospère et toute-puissante, en même temps qu’elle se nourrit et grandit d’une immigration venant d’horizons différents selon les époques, la Belgique toute proche, la Pologne, l’Italie, le Maghreb…. C’est une ville exemplaire aussi par la désindustrialisation qu’elle va subir ensuite, et qui va toucher de plein fouet ses ouvriers, la bourgeoisie, elle, va très bien s’en sortir. La ville est depuis plusieurs années dans le classement des villes françaises les plus pauvres, mais surtout les plus inégalitaires. Roubaix a par ailleurs été très étudiée par les sciences sociales, autour notamment des questions de luttes urbaines, de participation citoyenne, de politiques municipales. Ces recherches antérieures, qui pourraient être vues comme un désavantage car nuisant à « l’originalité » de l’objet, sont en fait de grand intérêt, de par la cumulativité sur laquelle reposent les sciences sociales. Elles nous ont permis de mieux cerner, très rapidement, les caractéristiques de la ville. Enfin, et très prosaïquement, condition non nécessaire mais finalement très pratique, sa proximité nous a facilité l’accès au terrain, pour nous mais aussi pour les étudiants avec qui nous avons pu partager concrètement l’expérience de terrain lors des enseignements d’enquête.
La première année, nous avons essayé de repérer des formes de résistances non dites, cachées. Un peu démuni.e.s pour rencontrer des habitant.e.s, nous avons opté pour deux voies : des déambulations dans les rues, parfois appareil photo ou carnet de notes à la main pour susciter la curiosité et engager la conversation, mais aussi un passage par ce qui était institué : les associations, les syndicats, etc. Et on trouvait, comme on le disait à l’époque, qu’il n’y avait pas beaucoup de « vrais gens » au sein de ces organisations. Ça, c’est un constat qu’on a tiré de cette première année d’enquête : cette différence fondamentale avec l’Argentine où les organisations sont absolument au cœur de la vie du quartier. Là-bas, l’organisation est un vrai capital. Car sans organisation, tu n’as tout simplement pas accès à tes droits. Les quartiers sont auto-construits par leur population et donc si tu ne t’organises pas, tu n’as pas accès à l’électricité, au ramassage des ordures, à l’eau potable, etc. L’État ne le fait pas de lui-même. Ce sont les habitants qui s’organisent pour forcer l’État à rendre ce genre de services. Donc le premier constat, c’est qu’à Roubaix, les associations ne sont pas au cœur des formes d’organisation populaire. Elles ont un rôle absolument essentiel dans le quotidien, mais souvent depuis une position de soutien et/ou d’encadrement des classes populaires, plutôt que d’auto-organisation. Cette première année est un peu une année de désenchantement. On était allé chercher des formes de résistance, même des résistances qui ne disent pas leurs noms, clandestines, un texte caché, et on ne l’a pas trouvé dans le monde associatif ou organisationnel classique. Donc il nous a fallu déplacer le regard vers le quotidien. Ce qui impliquait aussi une nécessité de nommer les rapports sociaux et les formes prises par la conflictualité un peu en décalage avec ce qui est fait habituellement, de façon beaucoup moins binaire.
À la fois en raison de leur accessibilité et de leur complémentarité, nous avons alors investi deux types d’entrées : la mécanique de rue et des ateliers, lieux d’activités, d’échanges et de paroles, dans des centres sociaux. Dans les deux cas les rapports sociaux de sexe et de race sont absolument frappants. Lors de la partie de l’enquête sur la mécanique de rue, nous avons surtout rencontré des hommes, alors que l’enquête dans les centres sociaux porte quasiment exclusivement sur des femmes. Nous nous avons également exploré, dans un second temps de l’enquête, deux autres terrains, autour des commerces de coiffure, où nous avons rencontré essentiellement des femmes, et un terrain plus mixte sur la pratique de l’auto-réhabilitation des logements, à la fois sur la base d’observations directes et d’entretiens sur les chantiers, et d’observation d’un guichet municipal lié à ces travaux. Au total, nous avons rencontré environ 200 personnes, aux marges du salariat, 1/3 en emploi officiel ou non, ½ inactif, les deux tiers de nos enquêtés sont des femmes, dont la majorité a entre 30 et 60 ans, les trois quarts appartiennent à des familles avec enfants, les deux tiers sont issues de l’immigration, surtout maghrébine.
CT : Alors que certain courants révolutionnaires enjoignent à la création de « communes » afin de remplacer le sujet révolutionnaire qu’était la classe ouvrière, vous montrez que le travail de subsistance des classes populaires s’appuie sur une logique de réciprocité au sein d’une communauté locale élargie, et à géométrie variable. Et que c’est au sein de ces communautés que se redessinent des identités collectives, des statuts sociaux, des positions sociales en partie différentes que celles construites sous la période fordiste. Comment se reconfigure l’opposition classique entre « nous » et « eux » au sein de ce nouveau groupe prolétaire ? Ce retour à la communauté ou à la famille élargie afin de sécuriser les parcours individuels et de protéger des aléas de la vie populaire est-il un simple retour en arrière avant l’époque des protections sociales institutionnalisées ?
RB : Il est vrai que les communautés de travail ont tendance à se confondre avec les communautés de vie. Mais, à l’heure actuelle, les contours du « nous » sont extrêmement fluctuants : nous les Roubaisiens, nous les Arabes, nous les Algériens, nous les femmes, nous les pauvres. Il n’y a pas de récit homogène de l’émancipation qui puisse soutenir la production d’une communauté politique. Ce qui n’est pas, en soi, étonnant. Il faut quand même signaler que Marx parlait du spectre qui hantait l’Europe, le spectre du communisme, alors qu’il n’y avait qu’une quarantaine d’usines en Angleterre. Bref, il faut trouver des catégories politiques qui connectent avec les enjeux matériels des classes populaires. En miroir, « eux » ce sont tantôt les gens qui décident – depuis la mairie, depuis Lille, depuis Paris, depuis les directions d’entreprises –, les blancs, les hommes, les agents d’encadrement des organismes et des collectivités territoriales… C’est-à-dire, toutes les formes localisées où le pouvoir se niche ou s’exerce, d’une façon ou d’une autre : un service municipal, l’agence de la CAF, le policier ou le travailleur social…
Sur le plan des rapports de production et du nouveau régime d’accumulation, les analyses de Negri et Hardt peuvent être utiles pour comprendre le passage d’une société disciplinaire, dans laquelle la plus-value est extraite pendant la journée de travail, à une société de contrôle, dans laquelle le capital extrait la plus-value de la société tout entière, vampirisant en quelque sorte les modalités localisées d’organisation sociale qui soutiennent la production, sans cesse régulées et normalisées. Par exemple, une partie de notre enquête s’est intéressée à la façon dont les femmes qui participent aux ateliers dans les centres sociaux, sont sans cesse rappelées à leur condition de mères et de femmes respectables. Il faut signaler que le caractère volontaire de cette participation est ambigu, car elle peut être liée au fait d’être allocataire du RSA, et que la présence aux ateliers leur pose souvent problème parce qu’elles sont obligées de jongler avec des dizaines d’autres tâches qui font partie de leur travail de subsistance, mais qu’elles ne sont jamais reconnues pour ce travail.
Sur le plan de l’organisation de la vie sociale, les individus peuvent aussi devenir fonction au sein de leurs communautés d’appartenance, ou pour le dire avec une catégorie marxiste, des valeurs d’usage. Le travail de subsistance attache l’individu à une communauté, à une logique de réciprocité, ils s’en trouvent assujettis, à qui sert une mère de famille ?, et réifiés, à quoi sert une mère de famille ?. Contre ces déterminations, les individus se battent aussi, c’est-à-dire, on n’observe pas un retour à la famille traditionnelle, le périmètre de la famille évolue dans les familles populaires, les unions conjugales sont plus précaires que par le passé, les solidarités peuvent s’établir à d’autres échelles qui permettent de produire une sécurité économique sans consentir à des attaches qui peuvent être oppressants.
CT : Ce nouveau groupe prolétaire est traversé par des distinctions fortes de race et de genre. Ces distinctions construisent une nouvelle division du travail, notamment chez les mécaniciens de rue et plus largement dans l’occupation de l’espace. Pouvez-vous développer cet aspect ?
RB : Le travail de subsistance fait effectivement l’objet d’une division genrée et racisée. Sur les tâches, d’abord : de façon assez classique, aux femmes les activités liées au soin des autres, à l’éducation des enfants, à la cuisine, à l’habillement, à la confection de petits objets, plutôt tournées vers l’intérieur des logements et des institutions. Ce travail féminin est fortement naturalisé, et à ce titre largement déqualifié, même s’il donne lieu à la reconnaissance entre femmes des savoir-faire mis en œuvre. Aux hommes, les activités manuelles de réparation, de rénovation, de mécanique, qui s’exercent plus à l’extérieur, en façade, dans la rue, dans les cours. Ces activités masculines donnent plus souvent lieu à des échanges monétaires, ce qui contribue plus facilement à les qualifier comme du travail. Mais cette intégration, au moins partielle, au marché formel entraîne une forte division genrée. En outre, dans les activités de mécanique, plus le travail s’éloigne des locaux des concessionnaires et des garages de réparation ayant pignon sur rue – et donc de conditions de rémunération et d’emploi qui permettent des formes de stabilité matérielle –, plus souvent ceux qui l’exercent sont d’origine maghrébine, ce qui s’apparente à une forme d’ordre « pigmentocratique » comme l’a écrit Fernando Urrea à propos de la segmentation raciale du marché du travail en Amérique latine.
CT : Votre analyse va à rebours des thèses sur l’islamisation de Roubaix qui n’interprètent l’émergence de cette ville post-fordiste que sous la forme d’un développement du « communautarisme », compris comme renforcement d’une communauté ethnique ou religieuse. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis de ces approches ?
RB : Nous avons commencé à travailler sur Roubaix en étant très au fait à la fois de la place de l’Islam dans l’espace public, et de la stigmatisation qui en découle pour la ville, et ses habitants. Nous avons dès le début pris le parti de ne pas faire de la religion un objet de recherche, mais un élément de contexte – et pas seulement l’Islam, car Roubaix a une longue histoire partagée avec le catholicisme social de droite et de gauche.
L’histoire de la ville est une histoire de migration – belge, polonaise, italienne, espagnole, portugaise, puis algérienne, marocaine, turque, chinoise, thaïlandaise, ivoirienne, malienne, etc. La question « communautaire », qu’elle soit construite sur des bases nationales et/ou religieuse, s’est imposée à nous dans les trajectoires et le quotidien de la plupart de nos enquêté.e.s car ces appartenances génèrent des ressources matérielles et symboliques, des solidarités, des effets de distinction, des discriminations, des sentiments d’appartenance ou de rejet. À étudier les héritiers de la bourgeoisie textile roubaisienne, nous nous serions frottés de très près au catholicisme et à sa place dans le quotidien. Mais la question du stigmate engendré par cette présence religieuse aurait été absente. Les classes populaires roubaisiennes sont pour une grande partie d’entre elles d’origine maghrébine et de culture musulmane : c’est le produit de l’histoire, notamment post-coloniale, de la ville et cela est intégré à notre analyse. Mais cette caractéristique, si elle est incontournable dans les trajectoires, les rapports sociaux et les réputations, ne résume pas le quotidien populaire. Contrairement à d’autres approches médiatiques, politiques, et scientifiques, nous avons refusé de résumer notre analyse du quotidien populaire à cette dimension.
CT : Mais, au fait, qui êtes-vous ? Et qui est Rosa Bonheur ?
RB : Nous sommes un collectif de chercheuses et chercheurs composé de cinq sociologues et d’un géographe-urbaniste. Nous avions des entrées thématiques différentes : en sociologie urbaine, sociologie du travail, des mobilisations, de la famille, de l’éducation… Nous avons entamé cette recherche avec l’idée de nous décaler par rapport à ses thématiques classiques pour construire une problématique commune. C’est un collectif qui se constitue aussi dans un contexte de mobilisation collective des enseignants-chercheurs de 2007-2009 contre les réformes libérales de la Ministre Valérie Pécresse lors la loi L.R.U. Face à ces logiques de casse des collectifs de travail analysés sociologiquement dans bien des univers professionnels, nous avons décidé de publier sous un nom d’auteur commun. Au-delà du choix même du nom, qui relève de l’anecdote, nous soulignons ainsi que la recherche en sciences sociales est un travail collectif. Ce travail a également consisté à réfléchir ensemble à l’articulation de nos missions d’enseignement et de recherche, et notre connaissance de la ville nous a permis d’y travailler avec plusieurs promotions d’étudiant.e.s.
php
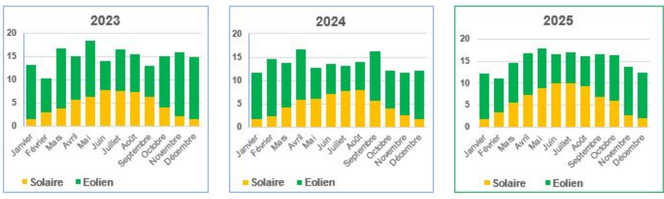
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire