31/10/2019
Commentaire : "Qu’est-ce que c’est qu’un mercenaire ? C’est un individu qui sert une cause, une institution, un pays non pas par conviction, non pas par devoir, mais parce qu’on le paye. [...] Car le mercenaire – et ce n’est pas là un jugement moral, mais la constatation d’un fait – sert d’abord son propre intérêt, et seulement marginalement celui des autres."
La campagne française a vu depuis 20 ans se multiplier, année après année, le nombre de prétendants pouvant prétendre à ce titre. Et parmi celles et ceux considérant que "l’argent est la mesure de toute chose", nous trouvons de trop nombreux élus ruraux!
Au sein de cette meute destructrice de la terre de France, ces édiles vendent les villages les populations aux mercenaires éoliens avec le soutien de l’État-nation qui, par ailleurs, a abandonné ces mêmes territoires; avec pour conséquences directes, le "pillage" d'un héritage environnemental, historique, culturel et patrimonial, dont paradoxalement, ils sont en charge en tant qu' "agent exécutif de la commune"
Alors, citoyens, aux élections municipales, mars 2020, faites un petit et anonyme geste pour vous, mais un grand geste pour la sauvegarde et la protection de ce pays qui vous a fait ce que vous êtes :
VIREZ LES ÉQUIPES PRO-EOLIEN!
Tenir tête, Fédérer, Libérer!
php
Qu’est-ce que c’est qu’un mercenaire ? C’est un individu qui sert une cause, une institution, un pays non pas par conviction, non pas par devoir, mais parce qu’on le paye. Et si une fois son contrat terminé une autre cause, une autre institution, un autre pays lui proposait une rémunération, cela ne lui posera aucun problème de changer de camp. Car le mercenaire – et ce n’est pas là un jugement moral, mais la constatation d’un fait – sert d’abord son propre intérêt, et seulement marginalement celui des autres.
Pendant des siècles, la figure du mercenaire domine non seulement le domaine militaire, mais aussi la politique. La notion de patriotisme et de service désintéressé n’a pas sa place au moyen-âge et à la Renaissance. On estime normal qu’un général combatte pour de l’argent ses propres compatriotes au service d’un roi étranger et touche les fruits du pillage d’une ville prise, quand bien même ce serait celle de sa naissance. Il est aussi parfaitement normal qu’un ministre s’enrichisse de sa charge. D’ailleurs, permettre à ses ministres de s’enrichir est le moyen le plus sûr pour un roi de s’attacher leur fidélité, de les prémunir contre les avances d’un souverain qui pourrait les payer encore mieux.
C’est avec l’avènement de l’État-nation que tout change. Même là où la monarchie subsiste, la notion de « res publica » – la « chose publique » – s’impose. On commence à partir du XVIIème siècle à servir l’Etat, entité qui transcende les individus, et non plus un monarque. Plus tard, on demandera aux citoyens de servir obligatoirement dans les armées pour une maigre solde et sans espérer de récompense autre que symbolique, sans pouvoir espérer les fruits du pillage. On exigera des gouvernants qu’ils prennent des décisions en fonction de l’intérêt général et sans se servir dans la caisse au passage.
Si la Nation peut exiger un service gratuit là où les rois étaient obligés de payer, c’est parce que contrairement au roi la Nation est un nous collectif qui a des devoirs envers chaque citoyen – c’est la fameuse « solidarité inconditionnelle et impersonnelle » qui pour moi fait en fait le fondement – et que par voie de conséquence elle est légitime à exiger un service en retour. Le rapport à la nation est un rapport contractuel : notre pays nous fait tels que nous sommes et nous lui devons par conséquence une dette de reconnaissance. C’est pour cette raison qu’au XIXème et XXème siècles les fonctions politiques et régaliennes étaient strictement réservées aux citoyens du pays. Un Italien doit tout à l’Italie, un Allemand doit tout à l’Allemagne. Comment imaginer qu’ils puissent, alors qu’ils ne doivent rien à la France, la servir de manière totalement désintéressée dans une position de pouvoir ? Il allait alors de soi que nommer un ministre étranger, c’était la garantie de le voir servir sa nation d’origine, à laquelle il doit tout. (1)
C’est à la lumière de ces réflexions qu’il me semble nécessaire d’examiner l’affaire récente qui a vu la démission de Sandro Gozi de son poste de conseiller au cabinet du Premier ministre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, un retour sur sa trajectoire est instructif. Sandro Gozi est un jeune politicien italien, dont le nomadisme politique l’a conduit du néofascisme jusqu’au centrisme. Il fut secrétaire d’ Etat dans le gouvernement Renzi, poste dans lequel il était censé mettre tout son cœur et son intelligence pour défendre les intérêts de l’Italie. Mais après la chute du gouvernement Renzi, il faut bien beurrer les épinards, et Gozi devient alors « consultant » auprès du Premier ministre de Malte, poste dans lequel on suppose il aura eu à cœur de défendre les intérêts des Maltais. Ce qui ne l’empêche pas « en même temps » – comme dirait notre président – de devenir conseiller au cabinet d’Édouard Philippe et de se faire élire député – in partibus en attendant que le retrait des députés britanniques lui permette de siéger à Bruxelles – en France. Postes dans lesquels, sans aucun doute, il fait tout son possible pour défendre les intérêts de la France.
Voilà donc un homme qui a défendu successivement ou simultanément les intérêts de la France, de l’Italie et de Malte. Et dont on peut supposer qu’il a utilisé les informations glanées dans chacune de ses fonctions pour alimenter les autres. Qui nous garantit que les informations transmises au cabinet du Premier ministre de la France n’ont servi par cet intermédiaire à faire avancer les intérêts maltais ou italiens contre nos propres intérêts ? Rien, bien entendu.
C’est ce que l’intéressé, pour se défendre, appelle la « transnationalité ». Avouez que c’est mignon, mais tout de même un peu court. Renzi, Philippe ou Muscat ont été mandatés par des citoyens – qui en dernière instance paient les salaires des ministres et de leurs conseillers – pour défendre les intérêts de leur Nation. Gozi est un mercenaire qui n’a en tête que ses propres intérêts. Qu’un tel personnage puisse accéder à des postes de confiance dans l’appareil politique et administratif devrait nous interroger.
Et Gozi n’est pas seul. Le cas de Salomé Zourabichvilli est encore plus intéressant. Cette dame est née en France en 1952 de parents français. Ses grands-parents étaient des immigrés géorgiens installés en France dans les années 1920. Elle fera des études en France, et une brillante carrière administrative au ministère des Affaires Étrangères où elle occupera des postes de haut niveau et particulièrement sensibles, comme celui de directrice des affaires internationales et stratégiques au Secrétariat général à la défense nationale, poste dans lequel elle a eu accès aux informations les plus sensibles concernant notre politique extérieure et de défense. Elle sera aussi ambassadrice de France en Géorgie entre 2003 et 2005… et c’est là qu’elle est repérée par le président Saakachvili, qui veut en faire sa ministre des Affaires étrangères. Elle n’a pas la nationalité géorgienne ? Qu’à cela ne tienne : le parlement vote une loi ad-hoc pour réparer cette petite difficulté, et on se retrouve dans la situation ubuesque ou la même personne est censée soutenir les intérêts de la France devant le gouvernement géorgien, et les intérêts de la Géorgie devant le gouvernement français. Mais la saga ne s’arrête pas là : Salomé Zourabichvilli se fera élire députée en Géorgie… mais fait partie des soixante diplomates qui signeront une lettre de soutien à l’élection d’Emmanuel Macron. Et puis elle décide de se présenter à la présidence de la Géorgie. Malheureusement, la constitution de ce pays interdit aux double-nationaux de se présenter. Encore une fois, ce n’est pas un problème. Madame Zourabichvilli renonce à la citoyenneté française, reniant par la même le pays qui l’a soignée, éduquée, et donné les meilleures opportunités, comme on se débarrasse d’un vieux vêtement qui a fait son temps. Elle sera d’ailleurs élue et préside aujourd’hui la Georgie. (2)
Cette affaire pose la même question que l’affaire Gozi : quels sont exactement les intérêts que Mme Zourabichvilli a défendu dans les différents étages de son parcours ? Ceux de la Géorgie ? Ceux de la France ? Les siens personnels ? C’est à mon sens cette dernière réponse qui est la bonne. Car en matière de politique internationale, on ne peut bien servir deux maîtres. Maintenant qu’elle est présidente de la Géorgie, on peut imaginer que les informations ultraconfidentielles dont elle a eu connaissance au Quai d’Orsay seront utilisées au détriment de nos intérêts – elle serait d’ailleurs en faute par rapport au mandat qu’elle a reçu du peuple géorgien si elle ne le faisait pas. Et de la même manière, les Géorgiens sont fondés à supposer que les informations dont elle dispose aujourd’hui pourraient être transmises aux anciens collègues de leur nouvelle présidente pour être utilisées au détriment de leur pays. On ne peut faire confiance à une personne qui change de trottoir en fonction de ses ambitions personnelles.
Et la même question se pose chez Sylvie Goulard qui, élue au Parlement européen et touchant une rémunération confortable de celui-ci, a accepté une deuxième rémunération bien supérieure par une institution de lobbying américaine, la fondation Berggruen. Et la question est toujours la même : quels sont les intérêts que Mme Goulard servait à Bruxelles ? Ceux de ses mandants français qui l’ont élue, ou ceux de la fondation Berggruen, qui l’ont grassement rémunérée ? Plus banalement, on peut conclure qu’elle n’a servi que ses propres intérêts, acceptant l’argent d’où il vient en échange de menus services.
La multiplication de ces affaires met à nu un changement fondamental. La fidélité à une idée, à une institution, au pays laisse progressivement la place à une course décomplexée à l’argent et aux postes – ce qui n’est pas la même chose que le pouvoir. D’où un nomadisme qui se manifeste dans tous les domaines : on change d’idée, de parti politique, de nationalité comme on change de chemise. Ceux qui juraient par les mânes de Jaurès sont prêts à servir un premier ministre de droite sans le moindre complexe, ceux qui juraient leur dévotion au drapeau italien peuvent conseiller le premier ministre français dans les négociations internationales. Il suffit que le chèque soit assez attractif. Et ce n’est pas seulement chez les grands que ce problème se pose : hier, des appelés sont allés mourir dans les tranchées sans une plainte dans des conditions qui sont pour nous difficilement imaginables. Aujourd’hui, des soldats devenus professionnels font des procès à l’Etat pour « mise en danger de la vie d’autrui ». Des personnes qui ont craché sur la France, brûlé publiquement leur passeport français, participé aux activités d’une organisation qui a massacré des Français exigent aujourd’hui par voie d’avocat ou de tribunes dans « Le Monde » d’être protégés par l’Etat français au prétexte qu’ils sont citoyens français. Comme si la citoyenneté n’accordait que des droits et n’imposait aucun devoir, pas même celui de loyauté.
Cette transformation traduit la mort de l’idée même de dette de reconnaissance, c’est-à-dire, l’idée que nous avons une dette envers ceux qui se sont battus avant nous pour construire ces institutions qui nous ont nourris, qui nous ont soignés, qui nous ont protégés, qui nous ont éduqués, bref, qui nous ont fait tels que nous sommes. A ceux qui essayaient d’utiliser dans les années 1970 ses désaccords sur la ligne pour mettre en difficulté le PCF, Marcel Paul avait répondu « le Parti m’a fait ce que je suis, jamais je ne le trahirai ». Par cette formule, il manifestait sa conscience d’une dette qu’il avait pourtant payé mille fois. Son discours était limpide : renier l’institution qui vous a formé, le pays qui vous a fait, c’est trahir une dette sacrée. Manifestement, cette reconnaissance n’est plus de saison dans la génération des Renzi et des Macron, persuadés de s’être faits eux-mêmes et de ne devoir rien à personne. Il ne reste pour toute fidélité que les fidélités personnelles et claniques qui ne sont en fait que des contrats de bénéfice mutuel entre gens du même monde. Pour le reste, dans une société ou l’argent est la mesure de toute chose, tout devient une affaire de mercenaires.
Descartes
(1) Ainsi, par exemple, l’étranger naturalisé français ne pouvait occuper de fonctions politiques ne France dans les dix années qui suivent sa naturalisation, période censée garantir l’établissement de liens solides avec la collectivité nationale et la distension des liens avec le pays d’origine.
(2) Quant au président Saakachvili, qui lui a mis le pied à l’étrier… il joue lui aussi les mercenaires : diverses affaires de corruption le poussant à quitter la Géorgie, il renonce à sa nationalité géorgienne et reçoit du président Poroshenko la citoyenneté ukrainienne, pour être nommé immédiatement gouverneur de la province d’Odessa, l’une des plus riches – et les plus corrompues – de l’Ukraine.
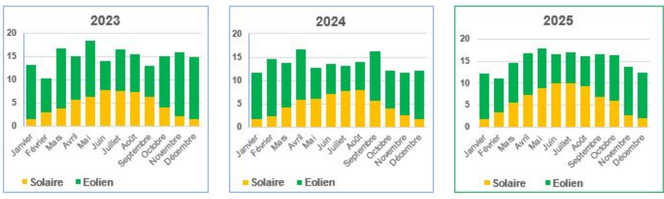
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire