Philippe Gauthier
Ce texte est une retranscription légèrement retravaillée d’une présentation que j’ai faite le 20 mai 2018 lors de la Grande transition à Montréal. Je devais la refaire le 29 juin dans le cadre du festival Virages, à Sainte-Rose-du-Nord.
On entend beaucoup parler de transition énergétique. Selon les médias, les énergies renouvelables s’implantent rapidement et vont bientôt remplacer les carburants fossiles sans le moindre accroc, tout en créant de nouveaux emplois. Et à en croire les émules de Jeremy Rifkin, l’énergie coûtera de moins en moins cher, suivant en ceci l’exemple du prix de l’informatique ou des télécommunications.
Mais quelle est réellement aujourd’hui la part combinée de l’énergie solaire photovoltaïque, du solaire thermique, de l’éolien, de la géothermie et de l’énergie marémotrice? Vous serez peut-être tenté de répondre 5, 10, voire 20 % du total. Mais le véritable chiffre est beaucoup plus modeste : 1,5 %. Il s’agit là du résultat des 45 dernières années de transition, selon les données officielles de l’Agence internationale de l’énergie.
Pour se résumer, de 1973 à 2015 :
- la part du pétrole dans le mix énergétique mondial est passée de 46 à 32 %
- la part du charbon a augmenté de 25 à 28 %
- la part du gaz naturel est passée de 16 à 22 %
- le nucléaire est passé de 1 à 5 %
- l’hydro-électricité est passée de 2 à 3 %
- les biocarburants, le bois et les déchets sont passés de 11 à 10 %
- et la part des énergies renouvelables a été multipliée par 15, de 0,1 à 1,5 %.
Entre 1990 et 2015, la part des carburants fossiles (on semble inclure ce nucléaire dans ce calcul) est passée de 88 à 86 % – une diminution marginale de 1 % par décennie. Et plus récemment, en dépit de taux impressionnants de croissance des renouvelables, en quantité réelle, on a ajouté deux fois plus de pétrole et de gaz que d’électricité renouvelable entre 2011 et 2016.
D’où vient cet écart entre la perception d’une transition rapide et une réalité plutôt modeste? Une partie est attribuable à l’usage de données relatives, exprimées en pourcentage : il est facile d’annoncer de forts pourcentages quand on part de petits chiffres. On peut aussi mentionner les effets d’annonce – tout le monde aime se vanter de ses succès, mais personne n’évoque ses échecs. Il s’agit d’un véritable biais de sélection sur les réussites. Une autre stratégie courante dans les médias consiste à publier des projections annonçant le succès pour une date assez lointaine, qui est retardée quand l’échéance approche – personne ne se souvient des anciennes prédictions trop optimistes.
Au final, le discours public sur les renouvelables se veut rassurant. Il vise à renforcer la confiance envers l’État, l’industrie et la supériorité des marchés. Il cimente le statu quo social. S’inscrivant en faux contre ces prédictions lénifiantes, ce texte défendra les thèses suivantes :
- la transition énergétique est beaucoup trop lente et ne sera pas terminée en 2050
- les obstacles dépassent de loin la simple résistance de l’industrie pétrolière
- le pic pétrolier et la diffusion trop lente des énergies renouvelables vont réduire la quantité totale d’énergie disponible à l’horizon 2050
- le manque à gagner va créer une décroissance subie ou planifiée, avec des impacts très différents en termes de justice sociale.
- L’ampleur du défi
Mais le défi est de taille. Pour réussir cette transition énergétique, il faudrait, dans les 32 prochaines années :
- faire passer la part renouvelable de l’électricité des 15 à 20 % actuels (en comptant l’hydraulique et la biomasse) à 100 %
- faire passer la part de l’électricité dans le mix énergétique mondial des 18 % actuels à 100 %
- doubler la production totale d’énergie, car au taux de croissance actuelle, la demande en énergie va plus que doubler en 32 ans.
Mais les obstacles pratiques sont importants et les délais, trop courts. Le chercheur italien Ugo Bardi, membre du Club de Rome, estimait en 2016 qu’il faudrait augmenter la production d’installations d’énergie renouvelable de 20 % par année de 2017 à 2022, puis de 10 % par année de 2023 à 2050. Il estime maintenant que les investissements actuels n’atteignent que le dixième du niveau nécessaire. Le climatologue américain Ken Caldeira estime pour sa part qu’il faudrait installer l’équivalent de la production d’une centrale nucléaire chaque jour, de 2000 à 2050. Au rythme actuel, la transition prendrait 363 ans.
Les causes de retard
Il est de bon ton d’attribuer le retard de la transition énergétique au manque de vision des politiciens ou à l’obstruction d’intérêts établis, comme l’industrie pétrolière. Bien que ces contraintes soient réelles, elle ne suffiraient pas à retarder le déploiement de formes d’énergie qui seraient véritablement plus rentables et plus commodes. En dépit de leurs avantages pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables comportent certaines limites que l’on peut classer en trois catégories :
- les obstacles physiques : ce sont des problèmes liés aux lois de la physique, qui n’ont pas de solution technique. On peut donner comme exemple la limite de Betz, qui restreint le rendement des éoliennes à 59,5 % du vent reçu, ou les grandes surfaces nécessaires au déploiement de panneaux solaires
- les freins techniques : il s’agit de difficultés techniques encore non résolues ou de contraintes matérielles ralentissant la transition, comme la mise en place d’une capacité de production suffisante pour les équipements ou pour les ressources rares qu’ils exigent
- les contraintes sociales : on parle ici de problèmes liés au financement des équipements, aux attitudes des divers acteurs sociaux et à l’évolution des usages. La transition bouscule les habitudes, ce qui provoque de la résistance.
Les cinq enjeux des énergies renouvelables
Les causes de retard évoquées plus haut s’appliquent à cinq grands enjeux entourant la transition énergétique. Il s’agit de grandes problématiques qui ne sont pas forcément insolubles, mais qui exigeront une attention spéciale et qui, dans l’attente de réponses, tendent à retarder la transition. Ils reposent habituellement sur une combinaison d’obstacles physiques, de freins techniques et de contraintes sociales.
Le premier de ces enjeux est l’espace. Les énergies renouvelables prennent beaucoup plus de place sur le terrain que les énergies fossiles, ce qui suscite des problèmes d’appropriation et d’industrialisation des habitats naturels et humains – c’est une forme d’extractivisme appliqué à l’habitat. On peut penser par exemple aux parcs de panneaux solaires et d’éoliennes installés dans des fermes ou des forêts. Ceci déplace ou dérange le plus souvent des populations pauvres ou marginalisées, voire des autochtones.
Le problème est plus important qu’on le reconnaît habituellement. Il faut environ 10 hectares de terrain pour installer 1 MW de panneaux solaires et 20 hectares pour installer 1 MW d’éoliennes (dans le cas des éoliennes, la population peut continuer d’occuper le territoire, mais cette cohabitation pose divers problèmes). Or, la croissance de la consommation mondiale d’énergie est de 2000 TWh par année, soit 350 000 éoliennes de 2 MW. C’est l’équivalent de couvrir 50 % des îles Britanniques d’éoliennes chaque année, ou la moitié de la Russie en 50 ans.
L’espace nécessaire est donc un obstacle physique incontournable. Ce n’est pas un frein technique important, mais il constitue une importante contrainte sociale (expropriations et « Pas dans ma cour ».
Le second enjeu est la question des ressources. Les fossiles ont l’avantage de produire de grandes quantités d’énergie dans des installations relativement modestes. Mais les renouvelables exigent de vastes infrastructures. À égale quantité d’énergie produite, ces installations utilisent dix fois plus de métaux que les fossiles. Et il faut en plus tenir compte de la nécessité d’installer des batteries et de vastes réseaux de transport électrique pour compenser l’intermittence de l’énergie produite.
Cette dépendance sur de grandes quantités de ressources matérielles (acier, béton, métaux rares…) se traduit souvent par la dépossession et le travail forcé de populations à l’étranger. Pensons par exemple aux Congolais qui exploitent le cobalt dans d’atroces conditions. Mais il peut aussi être difficile d’augmenter la production de certains métaux pour répondre à la demande accrue. Le gallium, par exemple, est un sous-produit de la production de l’aluminium et pour augmenter sa production, il faut d’abord augmenter celle du métal associé. La même relation existe entre le cobalt et le cuivre, sauf qu’en plus, le cuivre se fait rare.
L’économie classique nous enseigne qu’il n’y aura pas d’épuisement, puisque les hausses de prix et la technologie permettent d’exploiter des minerais toujours plus pauvres et donc, de maintenir le niveau de production. Mais l’exploitation de minerais toujours plus pauvres exige des moyens de plus en plus puissants et énergivores. On se retrouve dans un cercle vicieux : pour produire de l’énergie, il faut plus de métaux et pour produire les métaux à partir de minerais à faible teneur, il faut plus d’énergie.
La question des ressources n’est pas un obstacle physique à court terme, mais elle peut le devenir. Elle est assurément un frein technique, parce que déjà les industriels se battent pour contrôler les réserves de métaux critiques ou pour développer des alternatives utilisant moins de ressources. Et il s’agit d’une contrainte sociale, parce qu’on ne peut pas fonder un avenir durable sur la dépossession de populations vulnérables.
Le troisième enjeu est celui de l’intermittence. Nous sommes habitués à ce que l’électricité soit disponible sur demande. Et comme elle ne se stocke pas, elle doit de surcroît être consommée au moment de sa production. Les renouvelables, qui produisent quand le soleil brille et quand le vent souffle, répondent mal à ces deux exigences contradictoires.
Une solution souvent proposée consiste à stocker les surplus dans des batteries. Mais celles-ci coûtent cher, exigent beaucoup de ressources et se heurtent à de sérieux problèmes d’échelle. La grande batterie que Tesla a installée en 2017 en Australie a fait couler beaucoup d’encre. Mais elle a coûté cher et sa capacité est limitée. Au prix pratiqué en Australie, une batterie Tesla capable de stocker pendant 24 heures la production d’un grand barrage, comme le complexe Robert-Bourassa (LG2) dans le nord du Québec, coûterait 33 milliards de dollars. Même si les prix pouvaient être divisés par dix, ce qui est très incertain, la facture demeurerait salée.
En pratique, l’intermittence est gérée non pas par des batteries, mais par des usines ou gaz ou aux granules de bois, avec les émissions de gaz à effet de serre associées. On pourrait aussi envisager une adaptation de nos usages, par exemple rationner la consommation d’électricité lorsque le soleil ne brille pas, mais cela ne se fera pas rapidement et la résistance du secteur commercial et industriel sera très forte.
En somme, l’intermittence est un obstacle physique lié aux conditions de production. C’est certainement un frein technique, parce que les technologies permettant d’atténuer le problème n’existent pas ou sont trop coûteuses. Et une possible adaptation présente de fortes contraintes sociales.
Le quatrième enjeu est celui de la non-substituabilité. L’électricité renouvelable est incapable de remplacer tous les usages des carburants liquides. Les batteries ne répondent tout simplement pas aux besoins énergétiques de la machinerie lourde, des avions de ligne et des navires de commerce maritime. Certains procédés industriels ont besoin de carburants fossiles comme matière première (acier, plastiques, fertilisants). D’autres, comme la production d’aluminium et de ciment, ne se prêtent pas du tout à une production intermittente – l’arrêt du procédé endommage les installations.
Certains de ces obstacles, comme la trop faible capacité des batteries, sont essentiellement insolubles. Il faudra trouver des moyens de contourner l’obstacle, mais ceux-ci n’apparaissent pas tous clairement en ce moment. On ne peut pas véritablement parler d’un obstacle physique ou d’une contrainte sociale, mais le frein technique est beaucoup plus important qu’on ne l’admet généralement.
Le cinquième et dernier enjeu est celui du financement. Les renouvelables reçoivent beaucoup d’aide et de subventions et cette industrie pourrait éventuellement décoller… si seulement elle réalisait assez de bénéfices pour pouvoir investir à un rythme élevé. La déréglementation et les appels d’offres créent une compétition meurtrière entre producteurs, a révélé au début de 2018 une étude menée par Trade Unions for Energy Democracy.
En conséquence, les bénéfices sont faibles, le risque est élevé et le milieu de l’énergie reste donc prudent. Par rapport aux besoins d’une transition réussie, il manquera l’équivalent de 14 000 milliards de dollars d’investissements dans le solaire et l’éolien d’ici 2030. Les dépenses dans le secteur des batteries ne dépassent pas 10 milliards de dollars, recherche et déploiement inclus. Autrement dit, l’allocation de ressources financières est largement insuffisante.
Il ne s’agit ni d’un obstacle physique ni d’un frein technique. La contrainte est entièrement sociale, ce qui ne signifie pas que cet enjeu de financement soit plus facile à résoudre que les autres.
En conclusion
En raison des contraintes, évoquées ci-dessus, il apparaît clair qu’en 2050, les renouvelables ne remplaceront pas à 100 % les énergies fossiles au niveau de consommation actuel. La transition ne sera faite qu’en partie, peut-être de l’ordre de 30 à 50 %. Comme entre-temps la déplétion des ressources pétrolières va réduire la quantité de carburants fossiles disponibles, nous risquons de devoir compter sur beaucoup moins d’énergie disponible qu’en ce moment. Ceci va donner un coup d’arrêt final à la croissance économique telle que nous la concevons en ce moment.
Ce qui apparaît clair aussi, c’est que la transition énergétique serait plus facile si nous visions moins haut et si nous acceptions accepte de vivre avec un niveau moins élevé de consommation matérielle. L’idée n’est pas si farfelue qu’il n’y paraît. Une baisse de 30 % du PIB nous ramène au niveau de vie de 1993; une baisse de 50 %, en 1977. Une baisse de 50 % de la consommation d’énergie nous ramène au niveau de 1975; un baisse 80 %, au niveau de 1950. Bref, ce n’est pas un retour au Moyen-Âge. La vie de nos parents et grands-parents ne se résumait pas à sucer des cailloux dans une caverne!
Ce qu’il faut retenir de cet exposé, ce qu’il n’existe pas de solution uniquement technique. Pour réussir, la transition énergétique doit aussi se fonder sur une évolution des usages et des besoins. Il faut pour cela prendre du recul par rapport à la trame narrative actuelle sur la transition, la croissance verte et l’économie circulaire. Ces approches ne tracent pas un chemin vers le salut, mais servent plutôt à réaffirmer que le capitalisme industriel détient toutes les solutions et qu’il suffit de lui faire confiance.
Mais les obstacles à la transition montrent les limites de ce discours et l’impossibilité d’une croissance continue. Le changement technique doit s’accompagner d’une remise en question du consumérisme et de la croissance qui ne peut pas avoir lieu dans le cadre capitaliste actuel. La théorie de la décroissance propose une alternative plus difficile en apparence, mais plus susceptible de réussir sans ruiner le climat de la planète et sans exacerber les inégalités sociales.
php
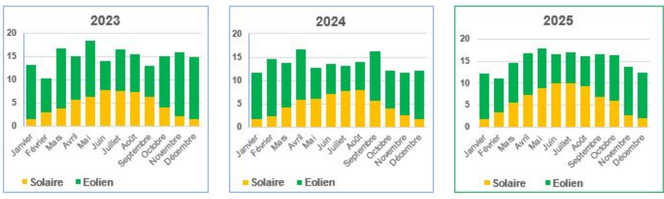
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire