Extrait du "Le Mouvement Social "
2002/3 (no 200)
Pages : 222
Affiliation : Revue précédemment diffusée par les Éditions Ouvrières (jusqu'en 1993), puis par les Éditions de l'Atelier (de 1993 à 2007).
DOI : 10.3917/lms.200.0033
Éditeur : La Découverte

Pages 33-54
Les grèves de mai-juin 1936 revisitées
Dans la mémoire collective, les grèves du Front populaire occupent la place exceptionnelle d’un événement fondateur; elles marquent à la fois l’accès à la dignité de ce que l’on peut nommer, alors, la classe ouvrière, l’affirmation de sa force et l’entrée dans une forme de modernité sociale qu’instaurent les « conquêtes » des accords Matignon. Pourtant ce qui s’est joué en mai-juin 1936 nous échappe encore en partie. L’abondante historiographie des grèves a évolué au gré des préoccupations, soucieuse d’abord d’analyser le déroulement et la chronologie du mouvement, puis d’identifier les responsabilités politiques ou syndicales, sans en dégager toute la signification. C’est à cette question que l’on voudrait s’attacher ici après un bref rappel des événements eux-mêmes.

photos de 1936
Trois vagues de grèves et un accord
Les débuts
La chronologie des grèves est bien connue. Les deux premières éclatent au Havre chez Breguet le 11 mai, et le 13 chez Latécoère à Toulouse, pour protester contre le licenciement d’ouvriers grévistes le 1er mai [1] Elles sont victorieuses après une nuit d’occupation. Les jours suivants, deux usines d’aviation à Courbevoie et Villacoublay connaissent des mouvements identiques. La presse ouvrière est très discrète sur ces grèves pendant cette semaine. Elle l’est un peu moins la semaine suivante et, le dimanche 24 mai, L’Humanité diffusée pendant l’immense manifestation au mur des fédérés (600 000 manifestants) évoque en cinquième page « une belle série de victoires dans les usines d’aviation ». Cet article a-t-il eu beaucoup d’influence ? La manifestation elle-même a-t-elle joué un rôle de détonateur ? Toujours est-il que la semaine qui suit enregistre une première vague de grèves dans les usines d’aviation et d’automobile de la banlieue parisienne : Nieuport, Lavalette, Hotchkiss, Sautter-Harlé, Lioré-Ollivier, Farman, et, le 28 mai, Renault, Fiat, Chausson, Gnome et Rhône, Talbot, Citroën, Brandt, Salmon, ainsi que Le Matériel Téléphonique et l’imprimerie Crété. Mais le mouvement semble aussitôt tourner court : le ministre du Travail, Frossard, organise une rencontre entre l’Union des industries métallurgiques et mécaniques de la région parisienne (le G.I.M.) et les syndicats. La reprise semble acquise le 30, tandis que les discussions se poursuivent, et le lundi de Pentecôte, 1er juin, il n’y a plus que 10 usines occupées en région parisienne. Pourtant la grève repart vigoureusement. Le mardi 2 juin, 66 usines sont occupées à midi, 150 le soir. La province est gagnée : Fives-Lille dans le Nord le jour même, le lendemain, l’usine des Batignolles à Nantes. Renault et Citroën reprennent la grève le 4 juin. Le 6, c’est le vote de la confiance à la Chambre, et le dimanche 7, à 15 heures, le début des négociations à l’hôtel Matignon où s’est installé Léon Blum, premier Président du Conseil de l’histoire à n’avoir pas pris simultanément la responsabilité d’un portefeuille. L’histoire de ces accords a été récemment renouvelée. Contrairement à la version donnée par Blum lui-même, une première rencontre entre lui et les négociateurs choisis par la C.G.P.F., MM. Duchemin, Dalbouze, Lambert-Ribot et Richemond, a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 juin, tant la gravité de la situation était ressentie par tous.[2] Cet entretien a permis à L. Blum de constater que le patronat ne faisait pas de l’évacuation des usines un préalable. Il a fixé en outre les enjeux d’une éventuelle négociation : elle portera sur les salaires et les conventions collectives, mais pas sur les 40 heures et les congés payés qui relèvent de la loi à laquelle les patrons se plieront. Fort de ces assurances, L. Blum peut proposer à la C.G.T. de négocier, sans risquer un refus patronal qui aurait conduit à l’impasse. Avant même le Conseil des ministres qui approuve sa déclaration ministérielle, il demande par radio aux travailleurs le 5 juin à midi « de s’en remettre à la loi pour celles de leurs revendications qui doivent être réglées par la loi, de poursuivre les autres dans le calme, la dignité et la discipline ». C’est le cadre même dans lequel il inscrit son action. Les accords Matignon, connus le lundi 8 juin au matin, n’arrêtent pas cette seconde vague de grèves. Au contraire, elle s’étend à de nouvelles professions. Les grands magasins sont entrés en grève le 6; le 8, ce sont le bâtiment parisien et les assurances, tandis que des négociations immédiates évitent que les banques ne débrayent. Au milieu de la semaine on compte un million et demi de grévistes. [3] Le reflux commence lentement à la fin de la semaine, alors que la C.G.T., le parti communiste et le parti socialiste se mobilisent pour la reprise. C’est le jeudi 11 juin au soir que Thorez prononce devant des responsables communistes réunis au gymnase Jean Jaurès – et non dans une usine occupée – la phrase célèbre : « Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue ». Mais, pour que la grève cesse, il faut encore que les négociations locales aboutissent et elles sont parfois longues. La métallurgie parisienne reprend le 15 juin. A la fin du mois, les vacances et les premiers congés payés approchant, le calme semble revenir. Une troisième vague de grèves se produit pourtant fin juin-début juillet. Elle concerne d’une part des secteurs paisibles ou fortement syndiqués, où les ouvriers avaient fait initialement le choix de la négociation, d’autre part de petites entreprises artisanales dont les patrons ne peuvent payer les augmentations de salaires. En Haute-Vienne, par exemple, la porcelaine et la chaussure, relativement syndiquées, n’avaient pas fait grève en juin; les premières grèves apparaissent dans le bâtiment, début juillet.[4] Dans le Loiret, on note de même une vague de grèves dans les petites entreprises fin juin.[5] Dans le Finistère, les premières grèves, essentiellement brestoises, étaient survenues immédiatement après les accords Matignon. De nouvelles éclatent dans le reste du département à la fin juin et à la mi-juillet, et notamment dans le bâtiment.[6] Près du Havre, les Filatures et tissages de Graville repartent en grève le 25 juin et l’occupation se terminera le 14 août seulement.[7] Cette dernière vague de grèves n’a pas l’importance des deux précédentes, mais elle a beaucoup contribué à donner le sentiment que toute la France avait été touchée. De fait, on compte seulement trois départements exempts de grèves en mai-juillet 1936. Au total, les grèves ont concerné plus de 12 000 entreprises dont près de 9 000 ont été occupées.[8] Certes, elles n’ont affecté ni les chemins de fer ni les postes ni les services publics de l’État et des collectivités, mais, pour le secteur privé, leur ampleur est sans précédent. Comparées aux grandes grèves de 1906-1910 et de 1919-1920, elles ne frappent pas seulement par leur puissance, mais aussi par leur simultanéité dans le temps et plus encore par la forme nouvelle qu’elles ont prise, l’occupation des lieux de travail. C’est une véritable « explosion sociale qui est venue frapper le ministère Blum au moment même de sa formation ».[9]
Des grèves venues d’en bas
Pour rendre compte à la fois des modalités du mouvement – les occupations d’usine – et de sa concentration sur les semaines de formation du gouvernement Blum, une explication a été avancée dès juin 1936 : celle d’un complot communiste. Cette thèse ne mérite pas longue discussion.[10] D’une part, elle ne repose sur aucun élément de preuve, alors que nombre d’indications attestent la volonté précoce du P.C.F. de limiter le mouvement, puis de le faire cesser dans l’ordre. Chez Renault, où la grève a éclaté le 28 mai, la section communiste appelle à la reprise le 29 au prix d’un accord avec la direction jugé dérisoire par F. Lehideux, administrateur délégué de la Société, tandis que L’Humanité parle d’une « sortie dans l’enthousiasme ».[11] On a vu l’engagement de Thorez le 11 juin; L’Humanité des jours suivants est sans équivoque. D’autre part, la thèse du complot communiste se heurte à deux invraisemblances majeures. La première est d’ordre stratégique : le P.C.F. était beaucoup trop docile aux injonctions du Komintern pour entreprendre de déstabiliser un pays dont la force, face à l’Allemagne hitlérienne, importait à la diplomatie stalinienne. La seconde est d’ordre tactique : s’il avait lancé les grèves, pourquoi le P.C.F. l’aurait-il fait dans l’industrie où il était relativement faible, et non dans les services publics où il était plus fort ? [12] Il faut chercher ailleurs l’origine du mouvement. La responsabilité ne peut être imputée à l’extrême gauche : la C.G.T. syndicaliste révolutionnaire comme les trotskystes étaient beaucoup trop faibles pour avoir pu peser. Reste la C.G.T., à laquelle la réunification syndicale donne alors un dynamisme nouveau. Mais tous les témoignages la décrivent prise de court par le mouvement, comme le reconnaît lui-même son secrétaire général, Léon Jouhaux, le 15 juin : « le mouvement s’est déclenché sans qu’on sût exactement comment et où ». [13] En outre, les grèves correspondent ici moins encore que dans le cas du P.C.F. à des secteurs de forte implantation : les taux de syndicalisation sont particulièrement faibles dans les secteurs à fortes grèves, comme la métallurgie (4 %), le textile (5 %), les industries alimentaires (3 %), alors qu’ils sont de 22,44,36 et 35 % dans les chemins de fer, la poste, les services publics et l’enseignement où il n’y a pas de grève. [14] Le cas limite est les grands magasins, qui connaissent une grève particulièrement spectaculaire, alors qu’ils ne comptent pas de section syndicale, ni d’ailleurs de cellule communiste. Il est donc clair qu’aucune force politique ou syndicale nationale n’a voulu ces grèves. Elles sont venues d’en bas, de la base, et non du sommet, des états-majors. C’est pourquoi on peut les dire spontanées. Ce qu’il ne faudrait pas caricaturer en imaginant que les ouvriers auraient obéi à une sorte d’impulsion soudaine et irrationnelle. Dire que les grèves ont été spontanées, c’est souligner qu’elles ont répondu à des initiatives locales, mais ces initiatives ont été souvent prises par des militants, notamment des unitaires [15] qui, depuis parfois plusieurs années, se consacraient à créer les conditions d’un nouveau rapport de force dans l’entreprise. [16] C’est au cours de cette « préhistoire » des grèves (J. Jackson) que se sont noués les réseaux militants sur lesquels repose dans certaines grandes usines le succès de 1936. Chez Renault, la grève est partie, le 28 mai, des ateliers les mieux contrôlés par l’organisation communiste; des responsables nationaux – Costes, Frachon, Hénaff – sont venus aussitôt la soutenir. [17] Et la toute première grève avec occupation, celle de Breguet au Havre, avait été soigneusement préparée par un militant communiste connu, Louis Eudier. [18] Comment des militants auraient-ils pu agir autrement ? La grève ne les a pas surpris : ils y travaillaient depuis longtemps et ils l’espéraient; ils ont saisi l’occasion favorable créée par la victoire du Front populaire et l’espoir qu’elle a fait naître parmi les travailleurs. Mais le succès dépasse leur attente et atteste un climat nouveau. Conclure de telles initiatives militantes que le parti ou la C.G.T., à leur niveau central, auraient lancé la grève serait excessif : ces cas sont limités à quelques entreprises, bien moins nombreuses que celles qui se sont mises en grève par contagion, sans avoir même rédigé un cahier de revendications et où l’on aurait cherché en vain un syndiqué. Au vrai, il n’était au pouvoir d’aucune organisation de créer un climat aussi exceptionnel, où la grève et l’occupation semblaient s’imposer comme l’évidence de ce qu’il fallait faire. Le mouvement collectif qui emporte les entreprises dépasse les capacités des organisations. En témoignent les difficultés que celles-ci rencontrent pour le canaliser, l’apaiser et lui donner une issue satisfaisante.
Les causes du mouvement
Le temps court du Front populaire
L’explosion sociale de 1936 est indissociable, en effet, d’un climat politique profondément original. Plus que le résultat des élections, ce qui compte ici, ce sont les conditions dans lesquelles le Front populaire les a remportées, c’est le mouvement qui a porté au pouvoir la nouvelle majorité. A s’en tenir au décompte des voix, les élections de 1936 n’ont rien d’un raz de marée. Certes, le centre de gravité des gauches s’est déplacé; le parti communiste a beaucoup progressé, tandis que les radicaux ont reculé, ce qui fait du parti socialiste le principal parti de la coalition et lui vaut de diriger le gouvernement, pour la première fois de notre histoire. Mais, si le Front populaire distance la droite d’environ 1 200 000 voix, par rapport aux élections de 1932, gagnées par le Cartel des gauches si peu à gauche, le gain est de moins de 300 000 voix. [19] Ce n’est pas considérable, même si la victoire est nette.
Elle prend en fait toute sa signification par la mobilisation populaire qui l’a précédée. Le choc du 6 février 1934 a donné à l’ensemble de la gauche le sentiment d’une menace fasciste de grande ampleur, qui exigeait la mobilisation de toutes les forces démocratiques dans l’urgence et la nécessité. On le voit dès les manifestations unitaires du 12 février 1934 qui rassemblent, dans d’innombrables localités, des milliers de manifestants dont il est clair parfois qu’ils ressentent cet engagement comme un devoir impérieux; ainsi à Cognac où, pour la première fois, les socialistes défilent dans la rue avec leur bannière rouge. [20] L’heure de se montrer et de se compter a bel et bien sonné. Les élections municipales de 1935 comme les élections législatives de 1936 ne se sont pas préparées seulement dans des réunions sous les préaux des écoles. L’époque est scandée d’innombrables cortèges et meetings. [21] Les organisations politiques ne se contentent pas de s’exprimer par le journal, le tract et l’affiche; elles s’exposent dans d’immenses défilés, marchant en nombre derrière des calicots qui les signalent. La mobilisation s’effectue dans la rue, et la manifestation devient alors la forme privilégiée de l’affirmation et de la propagande, au point que les pouvoirs publics sont amenés à prendre, en octobre 1935, un décret qui, les soumettant à déclaration préalable, leur donne indirectement la reconnaissance et le statut juridique qui leur manquaient jusque-là. Or ces manifestations constituent l’un des lieux d’émergence d’une culture de Front populaire qui réconcilie héritage républicain et lutte de classe comme elle marie drapeaux tricolores et drapeaux rouges. Cette culture antifasciste, démocratique et populaire – au sens où le peuple tout entier se rassemble contre les factieux – « relève d’une pédagogie de masse qui interpelle le groupe et non l’individu, valorise l’émotionnel longtemps décrié et esthétise les masses en mouvement ». [22] Les manifestations donnent à voir un peuple immense, dont les masses ouvrières sont part entière, un peuple pacifique mais fort, résolu, sûr de la justesse de sa cause et de sa propre légitimité, car il se pense lui-même comme le descendant du peuple des cathédrales, de Jeanne d’Arc et de la Révolution française. Les films réalisés par les organisations ouvrières à l’époque illustrent magistralement ce mouvement. « La France n’est pas aux Français, car elle est aux deux cents familles; la France n’est pas aux Français, elle est à ceux qui la pillent », affirme ainsi, de façon spectaculaire, La vie est à nous réalisé par Renoir à la demande du parti communiste en janvier 1936. Et Les bâtisseurs, financé par la Fédération du bâtiment en 1938, s’ouvre sur une séquence où deux ouvriers réparant la flèche de la cathédrale de Chartres se posent en continuateurs des compagnons du XIIe siècle, affirmant que les cathédrales étaient « comme des maisons du peuple »... avant que le film ne récapitule tout le patrimoine architectural de la France, des châteaux de la Renaissance à la Tour Eiffel et au chantier du Palais d’Iéna. [23] Les élections de 1936 ne sont pas un scrutin parmi d’autres, mais l’aboutissement de ce puissant mouvement politique et culturel, où le peuple rassemblé revendique pleinement l’héritage national. L’explosion sociale de 1936 est d’abord, dans l’espace du travail, l’expression de la même culture politique. Il est possible que les occupations aient constitué, ici ou là, une prise de gage en début de négociation, ou encore une garantie contre d’éventuelles agressions. Mais il est frappant qu’elles aient été si peu discutées : elles s’imposent comme ce qu’il faut faire. C’est que, dans cette culture de Front populaire, l’occupation est l’équivalent, pour le conflit social, de la manifestation pour le débat politique. Dans les lieux du travail, aussi, l’heure est venue de se montrer. Il ne suffit pas de cesser le travail, il faut manifester que l’on est nombreux, résolus et forts. Bien que pacifique, comme la plupart des manifestations, l’occupation est une entreprise d’intimidation : montrer sa force, peut-être pour ne pas avoir besoin de s’en servir, et elle a été perçue comme telle par l’encadrement. Pour cette mise en scène, cette démonstration, où se rassembler, sinon sur le lieu même du travail ? Sortir dans la rue, espace public, convient pour prendre l’opinion à témoin. Mais c’est aux patrons, aux chefs, que l’on veut faire sentir cette force qui prend conscience d’elle-même; aucun lieu ne s’y prête mieux que l’usine, théâtre de la domination désormais contestée. L’occupation s’impose aux ouvriers comme la façon la plus naturelle d’affirmer réellement et symboliquement à la fois leur existence et leur force collectives. Cela compte plus que les revendications elles-mêmes, et c’est pourquoi ils occupent souvent l’usine avant d’avoir discuté ce qu’ils vont exiger du patronat : d’abord la grève et l’occupation, ensuite le cahier de revendications.
Le temps médian de la crise économique
Cette interprétation par la culture politique de l’explosion sociale du Front populaire accorde peu de place aux causes économiques. Or le bon sens, partagé par la plupart des historiens, tend à voir dans la crise économique des années 1930 son explication la plus robuste. Frappée de plein fouet par le chômage et la misère, la classe ouvrière se serait révoltée, poussant au pouvoir le Front populaire et attendant de lui qu’il améliore son sort de façon décisive. Avant d’évoquer le rôle des facteurs culturels, ne serait-il pas plus simple, et mieux fondé, d’accorder aux facteurs matériels toute leur importance ?
Un premier point frappe l’observateur : la résistance des salaires nominaux. Calculé sur la base 100 en 1930, l’indice des salaires recule très peu, s’établissant à 94,6 d’août 1935 à mai 1936. Or, pendant le même temps, les prix de détail baissent beaucoup. Calculé sur la même base 100 en 1930, l’indice des prix de détail à la consommation atteint en août 1935 son minimum de 74, et il est encore à 76,4 en mai 1936. Ce qui voudrait dire que le pouvoir d’achat, donc le niveau de vie des ouvriers, non seulement ne s’est pas détérioré mais s’est amélioré, et de façon sensible, pendant la crise économique. Selon les calculs d’ A. Sauvy, cette amélioration serait de 23,8 % en mai 1936, à la veille du Front populaire. [24]
En fait, cette analyse qui contredit le sens commun comporte un biais qui interdit de la soutenir : elle repose sur la série statistique des salaires horaires des ouvriers des industries mécaniques de la région parisienne. Or, quand le chômage sévit, le salaire horaire n’est évidemment pas un bon indicateur du revenu ouvrier : une appréciation correcte des niveaux de vie salariés doit prendre en compte le chômage sous toutes ses formes.
D’abord le chômage complet. Son évolution est très difficile à retracer, car les séries publiées concernent le chômage secouru, et celui-ci n’a cessé d’augmenter au fur et à mesure des créations de fonds de secours aux chômeurs par les municipalités. Le seul chiffre plausible est celui du recensement de mars 1936, qui dénombre 864 000 chômeurs alors que l’on est toujours au creux de la crise. [25] C’est beaucoup, mais c’est relativement peu par rapport aux pays voisins. Certes, la relative faiblesse du chômage complet renvoie aux particularités du tissu économique français à l’époque. D’une part, les différences régionales sont sensibles, car le monde rural absorbe une partie du chômage, qui frappe plus durement les régions proprement industrielles.[26] D’autre part, le travail à domicile est encore très important, et il absorbe les fluctuations de l’activité économique, les entreprises sous-traitant à des façonniers en période de pleine activité pour ne pas avoir à licencier à la morte-saison; or les travailleurs à domicile sans travail ne sont pas considérés comme des chômeurs. [27] Mais la raison principale est d’ordre démographique.
La main-d’œuvre disponible pour travailler est en effet en baisse sensible de 1931 à 1936 : d’un recensement à l’autre, la population active, chômeurs inclus, a diminué de 1 760 000 personnes, dont 1 423 000 ouvriers. Pour une part, cette diminution s’explique par le renvoi dans leur pays d’origine de nombreux immigrés : la France malthusienne, atteinte par une pénurie de main-d’œuvre chronique, avait beaucoup recouru à l’immigration. Quand la crise s’installa, on organisa le retour des immigrés par trains entiers. Du coup, leur nombre diminue fortement de 1931 à 1936, passant de 2 715 000 à 2 198 000. Compte tenu des naturalisations, on peut évaluer à près de 400 000 l’effectif des étrangers qui ont quitté la France. Pour une autre part, la plus importante, la contraction de la population active est une conséquence de la guerre. En 1916, le nombre des naissances est inférieur à la moitié de ce qu’il était avant 1914 au cours d’une année normale. Au total, le déficit des naissances dû à la guerre est de l’ordre de 1,4 million. Or la génération née pendant la guerre quitte l’école et entre au travail pendant la crise économique, ce qui contribue fortement à réduire la population active, puisque son renouvellement est très inférieur à ce qu’il aurait dû être. [28] Une troisième raison explique l’importance relativement limitée du chômage complet en France, pendant la crise économique : l’arbitrage effectué par de nombreux chefs d’entreprise en faveur du chômage partiel. C’est pour une part une contrepartie du paternalisme : l’emploi n’est pas à l’époque la variable d’ajustement qu’il est devenu aujourd’hui et beaucoup de patrons se font un devoir moral de donner du travail à leurs ouvriers. Mais c’est aussi qu’ils y trouvent leur intérêt. Dans les secteurs encore très artisanaux de l’industrie, où les machines sont souvent anciennes, la qualification de la main-d’œuvre est un atout majeur : plutôt que de licencier de bons ouvriers qu’on aura de la peine à retrouver une fois la crise passée, il peut sembler plus judicieux de les conserver, tout en les faisant chômer un jour ou deux. [29] De fait, le chômage partiel ne peut être négligé. L’indice de la durée du travail calculé par Sauvy (base 100 en 1930) tombe à 90,1 en mai 1932, repasse au-dessus de 94 pendant l’hiver 1933-1934, puis retombe à 90,8 en avril 1935. Au moment des élections législatives, il est remonté à 95 [30]. La durée moyenne de la semaine de travail, qui s’établissait à 47,8 heures en 1930 dans les industries de transformation, diminue de plus de 3 heures, se situant en 1935 à 44,4 heures. Naturellement, ces chiffres ne sont que des moyennes, et les situations concrètes sont contrastées : à côté d’entreprises qui travaillent six journées de huit heures, d’autres font moins de 40 heures par semaine.
Dans l’ensemble, cependant, l’ampleur du chômage n’est pas telle qu’elle plonge dans la misère l’ensemble des travailleurs. Pour annuler l’effet positif des baisses de prix sur le niveau de vie ouvrier, à salaire horaire pratiquement constant, il faudrait en effet que le chômage ait réduit de plus de 20 % la masse des heures travaillées. Or l’effet du chômage partiel semble, au pire moment, de l’ordre de 10 % tandis qu’au recensement de 1936 le chômage total représente 8,6 % de l’ensemble des salariés (chômeurs inclus). Certes, la situation des chômeurs est précaire, d’autant que les secours sont encore très limités; certes, les ouvriers craignent pour leur emploi, mais l’analyse globale des salaires, des prix et de l’emploi ne permet pas de voir dans la misère ouvrière la cause principale du Front populaire et de son explosion sociale. Cela ne veut pas dire, pour autant, que la crise économique ait été sans effets. Mais ses effets sont d’un autre ordre.
Le temps long de la taylorisation
Pour les comprendre, il faut s’interroger plus globalement sur les réactions des entreprises à la crise qui s’installe. Cette crise vient du dehors, du marché international. La stabilisation du franc par Poincaré – une dévaluation – s’était faite à un niveau favorable aux entreprises françaises, qui bénéficiaient d’un avantage de change, alors que les rentiers auraient souhaité une plus forte revalorisation. [31] Cet avantage a été progressivement réduit par la baisse des prix mondiaux, en attendant que la dévaluation de la livre en 1931, puis celle du dollar en 1933 ne renversent complètement la situation. Désormais le refus de dévaluer, favorable aux rentiers, rend les prix français prohibitifs sur le marché mondial. Pour ne pas perdre tous leurs marchés, les entrepreneurs doivent impérativement réduire sensiblement leurs prix de revient. Le chômage leur permet de diminuer leur production, non d’en diminuer le coût. La baisse des salaires réduirait les coûts, mais, on l’a vu, celle qu’on constate n’est pas à la mesure du problème. Il faut donc, pour comprimer les prix de revient, se tourner vers une autre solution. Or la taylorisation en propose une à point nommé : produire plus en travaillant autant, réaliser des gains de productivité. C’est possible parce que le mouvement est en cours depuis longtemps. Les principes du taylorisme ont été introduits en France par Henry Le Chatelier à partir de 1906 et certains industriels commencent à s’en inspirer dès avant la guerre, comme Berliet ou Renault. Ils sont mis en œuvre pour des fabrications limitées dans les usines de guerre et se répandent au sortir de la guerre, notamment dans l’automobile ou la réparation ferroviaire. Il s’agit d’un processus long et progressif : la mise en ligne de la production s’effectue par étapes et ne se limite pas à la chaîne. Celle-ci, elle-même, se précise peu à peu : les dispositifs se rehaussent pour être à la portée de l’ouvrier, les temps de station à chaque poste de travail, d’abord très longs, se réduisent. Le travail s’automatise progressivement : sur certaines photos de chaînes chez Renault, à la fin des années 1920, on voit encore à côté des pièces à usiner tournevis et marteau [32]. Peu à peu, la différenciation s’accroît entre les ouvriers professionnels qui peuplent les ateliers d’outillage et les ouvriers spécialisés sur machines, à qui incombe la production en série et le montage et parmi lesquels les femmes deviennent plus nombreuses. Le processus d’organisation du travail et de recomposition de la force de travail est en cours. [33] Il s’accélère dans les années de la reconstruction, avec la création en 1926 du Comité national de l’organisation française (C.N.O.F.), celle de la Commission d’études générales de l’organisation scientifique du travail (C.E.G.O.S.), puis l’ouverture d’une chaire d’ O.S.T. au Conservatoire national des Arts et Métiers. Le Bureau international du travail réunit à Genève des conférences sur l’organisation du travail. Après avoir fondé son entreprise aux États-Unis, Charles Bedaux crée en 1927 une filiale en France et commence à diffuser le système de salaire au rendement qui porte son nom. Bref, quand s’ouvre la crise, la rationalisation de la production s’amorce et les outils de son développement sont en place. Symboles et temples d’une production industrielle rationalisée, les grandes usines d’automobiles conçues autour des chaînes de montage marquent le paysage, avec Renault à l’Île Seguin (1930) et Citroën quai de Javel (1933).
Dès cette époque, pourtant, la taylorisation ne s’accompagnait pas en France d’une politique salariale fordiste. A plus forte raison, quand la crise oblige à comprimer les prix de revient, la rationalisation est utilisée pour accroître la production sans augmenter les salaires. Aux Mines d’Anzin, le système Bedaux de salaire aux points est introduit en 1932 : le chronométrage détermine la valeur du point de rémunération à partir de la quantité moyenne de charbon abattu en une minute. Le mineur qui « fait » 60 points en une heure reçoit le salaire prévu; s’il « fait » 75 points dans l’heure, les 15 points supplémentaires lui sont payés avec un abattement de 25 %. Ce système est largement appliqué dans les constructions mécaniques, et singulièrement dans les grandes usines taylorisées, comme chez Renault, Chausson, etc. Le Journal d’usine de Simone Weil [34] permet de saisir son fonctionnement : si le rendement prévu n’est pas atteint, l’ouvrier ne « fait » pas le nombre de points nécessaires pour gagner le salaire prévu (taux d’affûtage). Ce mode de salaire permet de payer relativement moins les pièces produites en plus de ce qui était prévu dans le temps assigné (les bonis); il oblige surtout les ouvriers – qui n’en comprennent pas le détail car sa complexité décourage le décompte – à maintenir le rendement prévu pour ne pas être pénalisés. La rationalisation est ainsi l’outil d’une intensification des cadences. Elle est imposée aux ouvriers, principalement aux ouvriers spécialisés, par une maîtrise que Simone Weil nous montre à l’œuvre : contremaîtres et chefs d’atelier ne sont plus les professionnels très qualifiés de l’ancien atelier et leur tâche consiste uniquement à répartir le travail et à faire respecter les cadences. Ce sont vraiment les « sous-officiers » de l’armée du travail, pour reprendre une métaphore ancienne : leur autorité sans appel s’impose, d’autant plus que le chômage est assez répandu pour que les ouvriers redoutent de perdre leur travail. Or c’est très vite le sort de ceux qui ne respectent pas les cadences, comme Simone Weil, maladroite et fragile, en fait l’expérience à plusieurs reprises et comme La vie est à nous le met en scène, avec un vieil ouvrier dont le renvoi pour cadence insuffisante déclenche une grève. On comprend mieux, dans ces conditions, l’explosion du Front populaire. La crise n’a pas plongé les ouvriers dans la misère, mais elle s’est traduite par une surexploitation systématique, par une intensification des cadences, par un renforcement des contraintes disciplinaires. [35] C’est tout cet ensemble qui fait l’objet d’un rejet massif en mai-juin 1936. Si le mouvement politique et culturel du Front populaire a donné au mouvement social ses formes d’expression, sa cause profonde est la surexploitation que la taylorisation rend possible et que la crise généralise. L’analyse que nous proposons permet de rendre compte de plusieurs aspects de ce conflit social sans précédent. D’abord le fait qu’il prenne naissance et s’affirme de façon spectaculaire précisément dans les usines de construction mécanique et automobile où la taylorisation a le plus progressé et où les cadences sont les plus élevées. Mais dans d’autres secteurs, les salaires au rendement sont tout aussi directement en cause : ainsi au service d’expéditions de la Samaritaine où le système Bedaux était appliqué [36] ou encore aux usines Arthur Martin de Revin. [37] Partout, les licenciements arbitraires pour production insuffisante sont mis en cause.
En second lieu, les principales conquêtes ouvrières de 1936 concernent précisément le temps. Ce sont les 40 heures et les congés payés. Échapper à la contrainte des cadences et à l’autorité arbitraire des petits chefs qui les imposent : voilà ce qu’apporte le Front populaire. Mais il ne se contente pas de créer ainsi un temps libre, un temps de loisir et de re-création. A l’intérieur même du temps de travail, il introduit un contre-pouvoir qui permet de limiter l’exploitation : les délégués d’atelier. On ne voit pas assez le changement concret introduit dans les ateliers et les usines par les conventions collectives et les délégués ouvriers. D’abord, dans un certain nombre de cas, les accords conclus entérinent l’abandon du système Bedaux; ainsi par exemple à la Samaritaine ou dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais. [38] Ensuite, là où il n’est pas formellement abandonné, les contremaîtres, discrédités et mal soutenus par la hiérarchie – ceux de Renault feront même grève pour cette raison le 22 mars 1937 [39] –, ne parviennent plus à faire respecter les cadences. Dès qu’ils le tentent, les délégués élus par les ouvriers font débrayer l’atelier. Simone Weil a bien analysé cette situation nouvelle dans un rapport que la C.G.T. lui avait commandé sur les conflits du Nord : « Sur le papier, le travail aux pièces est maintenu, mais les choses se passent dans une certaine mesure comme s’il n’existait plus; en tout cas la cadence du travail a perdu son caractère obsédant, les ouvriers ont tendance à revenir au rythme naturel du travail ». [40] Les contre-maîtres sont « tout à fait désorientés ». Beaucoup plus que les 40 heures, n’en déplaise à Sauvy, c’est ce retour à des cadences « naturelles » qui explique que la production industrielle ne soit pas repartie comme le gouvernement l’escomptait. Le travail a repris après les grèves, mais pas comme avant. L’explosion sociale du Front populaire naît ainsi à la rencontre de trois temporalités qui interfèrent, s’amplifient et entrent en résonance comme des ondes de fréquence différente : le temps long de la taylorisation qui s’étend sur la majeure partie du XXe siècle et met en place de nouvelles formes et de nouvelles conditions de travail ouvrier, le temps médian de la crise économique qui comprime les coûts de production en développant le salaire au rendement et en intensifiant les cadences, enfin le temps court du politique et du culturel qui joue ici le rôle d’un déclencheur.
Pourtant cette explication ne rend pas compte de la totalité de l’événement. Elle permet de comprendre qu’un mouvement social de grande ampleur se soit produit, mais ne dit rien sur les formes particulières qu’il a prises. Elle explique les grèves, pas les occupations.
Signification des occupations
Une visée révolutionnaire ? Pour beaucoup d’observateurs, les occupations ont une signification révolutionnaire. A l’époque, la plupart des patrons y ont vu le début d’une soviétisation [41] soutenus par une presse de droite inquiète. L’union des syndicats patronaux des industries textiles écrit à Blum : « il s’agit en réalité d’un mouvement essentiellement révolutionnaire qui se caractérise par l’occupation des lieux de travail, effectuée en violation de toute légalité ». [42] La même analyse est partagée par des militants situés à la gauche du parti socialiste, qui ont reproché après la guerre à Léon Blum sa pusillanimité : J. Danos et M. Gibelin tout d’abord, puis C. Audry, D. Guérin, et, plus récemment, J. Kergoat. [43] La discussion porte en grande partie sur le sens des mots, et l’on pourrait ici entamer une longue dissertation sur ce que « révolution » veut dire. Il est certain qu’un grand mouvement social comme celui du Front populaire, ou encore celui de 1968, ouvre une période d’incertitude où les acteurs peuvent difficilement prévoir les lendemains. Il est également certain qu’aucun des grands acteurs collectifs de l’époque n’a cherché à faire évoluer la situation vers une révolution. La question que posent les occupations est celle des intentions des grévistes plus que de leurs objectifs. Que veulent-ils dire en occupant les usines ? Les auteurs qui leur prêtent une visée révolutionnaire répondent à cette question comme les patrons au moment même : ils « ont mis en cause le droit de propriété patronale sur l’entreprise ». [44] Les arguments qui vont en ce sens sont repris de façon récurrente. On cite les ouvriers de la biscuiterie Delespaul-Havez qui remirent en route leur usine le 4 juillet, ou des déclarations comme celle de Gauthier, secrétaire de la métallurgie parisienne, le 6 juin : « De toutes parts, nos camarades insistent pour que nous agissions auprès des ministères de l’Air, de la Guerre, des P.T.T. Sinon, déclarent les ouvriers des usines, nous prendrons personnellement la direction de la production ». [45] J. Kergoat souligne à juste titre que de telles menaces ne sont pas anodines. Mais ce sont malgré tout de simples menaces, et elles sont rares. Incontestables, et importantes parce qu’elles attestent la présence d’une minorité trotskyste ou communiste qui prendra plus d’importance par la suite dans les usines, les tentatives de débordement n’ont pas abouti en juin 1936. [46]
Inversement, les historiens qui contestent cette thèse ont fait valoir la totale indifférence des grévistes à la comptabilité de l’entreprise, pourtant disponible, et leur attitude envers les patrons, où l’indifférence l’emporte de beaucoup sur l’agressivité. Jean Coutrot, patron-ingénieur averti et modernisateur, qui a visité de nombreuses usines et qui écrit à chaud, le signale et son témoignage est confirmé par Henri Prouteau. [47] Les grévistes n’envisagent nullement la disparition du patronat. L’occupation n’est pas le début d’une action qui doit se prolonger, elle ne marque pas l’avènement de temps nouveaux; elle est explicitement vécue comme une parenthèse. L’article célèbre de Simone Weil est très clair sur ce point : « Bien sûr, cette vie si dure recommencera dans quelques jours. Mais on n’y pense pas, on est comme les soldats en permission pendant la guerre. Et puis, quoi qu’il puisse arriver par la suite, on aura toujours eu ça. Enfin, pour la première fois, et pour toujours, il flottera autour de ces lourdes machines d’autres souvenirs que le silence, la contrainte, la soumission ». Et plus loin : « Ils savent bien qu’en dépit des améliorations conquises le poids de l’oppression sociale, un instant écarté, va retomber sur eux. Ils savent qu’ils vont se retrouver sous une domination dure, sèche et sans égards ». [48] D’autres indices confirment ce témoignage, à commencer par le soin apporté par les grévistes à entretenir le matériel, à nettoyer les machines et à organiser la surveillance des lieux : il s’agit de retirer aux patrons tout motif de grief, lors de la reprise du travail. Les vendeuses des grands magasins poussent encore plus loin le scrupule qui couchent par terre, à côté de transatlantiques ou de canapés, pour qu’on ne puisse pas leur reprocher ensuite d’avoir sali ou détérioré le matériel. Manifestement, l’occupation n’est pas le début d’une expropriation : les grévistes anticipent le retour des patrons et se prémunissent contre d’éventuelles mesures de rétorsion; ils ne se placent pas dans une perspective révolutionnaire où leur pouvoir remplacerait définitivement celui des patrons. Il faut chercher ailleurs le sens de l’événement.
La lutte et la fête
On est tenté alors de centrer l’analyse, non sur le fait même de l’occupation, mais sur ses modalités, et ce qui frappe aussitôt, c’est l’aspect festif de la grève. Après beaucoup d’autres [49; j’ai moi-même longuement souligné cet aspect, insistant sur la rupture avec le quotidien que constitue l’occupation : le temps est aboli, les machines se taisent, le travail a cessé, des groupes discutent, l’espace est remanié en fonction d’autres usages et des fêtes s’organisent; il arrive qu’on danse... Le texte de S. Weil, cent fois repris, s’impose ici comme le témoignage le plus explicite et le plus pertinent : « Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie. Une joie pure. Une joie sans mélange... ». [50] Et toute la page qui suit est construite sur une rhétorique de phrases qui commencent par « Joie » : « Joie de pénétrer dans l’usine... Joie de parcourir... », etc. Un demi-siècle plus tard, dans un style moins littéraire, cette vendeuse d’un grand magasin lui fait écho : « C’est vraiment un bon souvenir. On ne savait pas trop comment cela allait tourner, mais on s’est bien amusées. Il y avait les bals, tout ça... On chantait; on était gaies quoi ! Même si l’on savait qu’après on allait reprendre. On s’est bien amusées entre nous ». [51] A cette vision des occupations on a reproché de faire bon compte de toute la tension qui régnait dans les usines. On ne peut oublier, en effet, que l’occupation est aussi une prise de gage, un atout dont les grévistes s’emparent à la fois pour se prémunir contre une tentative de remise en route de l’usine par des jaunes et pour rendre le patron plus conciliant. Cette tactique avait déjà été tentée ici ou là, chez Talbot ou Chenard et Walcker en 1931, provoquant une évacuation par la police, puis quelques mois plus tard chez Babcock et Wilcox. [52] Le souvenir ne s’en était pas perdu et Chenard et Walcker avait connu une nouvelle tentative infructueuse en mars 1935. Dans le Nord, les Forges et Aciéries du Nord et de l’Est à Trith-Saint-Léger avaient connu de même, du 13 au 18 novembre 1929, une grève des bras croisés, c’est-à-dire une occupation partielle. [53] En décembre 1935, le secrétaire du syndicat unitaire des métaux, Musmeaux, reproche aux grévistes de Louvroil d’être sortis de l’usine : « si vous aviez tenu 24 heures à l’intérieur, vous auriez eu tout ce que vous auriez voulu et ce n’est pas les gendarmes mobiles qui auraient pu vous chasser de vos ateliers ». [54] La première occupation, celle de Breguet au Havre, s’inscrit exactement dans cette perspective et les forces de l’ordre ne se risquèrent pas à faire évacuer des ateliers où les grévistes menaçaient de détruire un prototype d’hydravion. L’occupation, arme tactique, ne donne pas aux grévistes une sécurité absolue, même si le changement de gouvernement rend désormais improbable une évacuation par la police, ce qui change tout. La tension subsiste. De nombreux témoignages montrent les occupants sur leurs gardes, soucieux de contrer les tentatives de reprise en mains par la direction, craignant vaguement une intervention extérieure. L’usine occupée, gardée par les piquets, se vit aussi comme une place assiégée. La fête, quand elle éclate, est bien une vraie fête et la joie des grévistes une vraie joie, mais cela n’empêche pas que la fête est organisée : pour le comité de grève, c’est aussi une façon de maintenir le moral en combattant l’ennui autant que le désordre. Ces remarques me conduisaient à dédoubler en quelque sorte les grèves et à dire qu’elles se déroulent simultanément sur deux plans : celui de la revendication et celui de la fête. [55] Un plan réaliste, celui de l’action, et un plan symbolique, celui du geste, de l’expression collective. J’opposais la révolution, qui est effort pour réaliser un idéal, et les grèves de 1936, où je voyais l’expression de cet idéal. La fête qui accompagne les grèves n’est pas gratuite, elle ne traduit pas seulement le plaisir d’être ensemble ou le désir de s’amuser : elle a un sens, elle dit quelque chose sur la communauté ouvrière, sa liberté, sa dignité et sa souveraineté. Ce qui me conduisait à considérer que les occupations n’étaient pas devenues un mythe, mais que, dès le début, elles étaient un mythe et avaient été vécues comme telles. L’occupation aurait révélé des hommes et des femmes à leurs propres yeux, et c’est pourquoi ils ne l’ont jamais oubliée. Je retrouvais la conclusion de J. Lhomme, faisant de juin 1936 « plutôt une crise de conscience qu’une crise, au sens absolu du terme ». [56]
Cette analyse me paraît toujours pertinente, mais elle demande à être prolongée de deux façons. D’abord en liant davantage le registre de la lutte et celui de la fête. Affirmation d’une liberté conquise sur le temps et l’espace du travail, la fête exprime symboliquement ce dont la lutte affirme le sérieux. On retrouve ici le lien entre la grève et la fête qui structurait déjà la célébration du 1er mai quand elle était réussie. Le fait de chômer ce jour-là matérialise une liberté et une émancipation que la fête inscrit dans l’ordre émotif et symbolique comme une prise de conscience collective et un principe d’espoir. [57] En second lieu, il convient d’accorder plus d’importance au fait que l’occupation, comme la grève, est générale. La grève générale constitue un phénomène profondément original, qui donne au mouvement ouvrier français un caractère spécifique. Les autres pays industriels connaissent davantage de grèves, mais aucun n’a jamais vu de mouvement aussi massif et aussi long que ceux de 1936, 1968 ou 1995. Dans le déclenchement de la grève et l’occupation de l’usine avant même l’identification des revendications à faire aboutir, il y a la volonté de faire comme les autres, de ne pas se singulariser, c’est-à-dire de manifester son appartenance à une communauté plus large. Par sa généralité même, la grève dépasse la simple lutte revendicative pour affirmer l’existence et la force d’un groupe solidaire et amener le patronat et l’encadrement à reconnaître à tous ses membres une existence propre, des besoins légitimes et de la considération. L’appartenance à une communauté, la conscience de constituer une classe et de la faire reconnaître par toute la société s’expriment sur le registre plus émotif, plus chaleureux de la fête. Ce sont d’ailleurs les fêtes que les syndicalistes placent au centre de leurs représentations des grèves. Le film tourné sur le moment par les techniciens du spectacle en grève, Grèves d’occupation, leur est tout entier consacré. Au cœur de la satisfaction profonde qui donne aux occupations leur caractère exceptionnel et inoubliable, il n’y a pas seulement le sentiment d’une dignité retrouvée et affirmée, haut et fort, mais l’émotion d’une fraternité et d’une communauté de destin.
Ces remarques ne lèvent pourtant pas la contradiction fondamentale autour de laquelle se noue toute l’interprétation de 1936. Certes, en occupant les usines, les ouvriers mettent en cause le rapport au patron et à son autorité, mais ils ne contestent explicitement ni son droit de propriété ni même son rôle dirigeant. Or les patrons voient dans l’occupation la négation de leur pouvoir, et du droit de propriété qui le fonde. Alors, où est l’enjeu ?
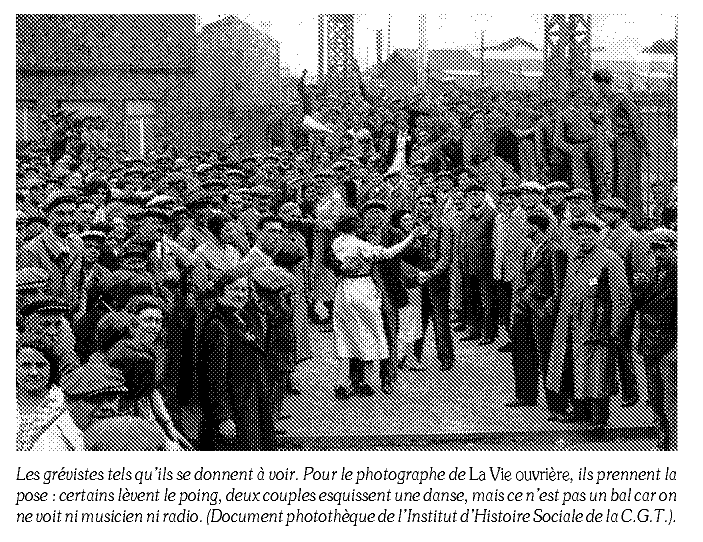
Espace privé, espace public
Que la propriété soit le fondement du pouvoir patronal constitue une évidence sur laquelle on ne s’attardera pas, sinon pour en tirer les conséquences quant à la nature même de ce pouvoir. La propriété étant privée, le pouvoir que le patron exerce dans ce qu’il nomme souvent sa « maison » est lui aussi d’ordre privé. Il implique, de la part des ouvriers, non seulement une obéissance dans le travail, mais une forme de reconnaissance ou de gratitude, en tout cas, un lien personnel. Les patrons défendent évidemment avec leur pouvoir leur intérêt économique, mais aussi une conception de leur rôle, de leur image sociale. La conversation rapportée par S. Weil est ici éclairante : « Le patron est l’être le plus détesté. Détesté de tout le monde. Et c’est lui pourtant qui fait vivre tout le monde. Comme c’est étrange, cette injustice. Oui détesté de tous. – Autrefois, au moins, il y avait des égards. Je me souviens, dans ma jeunesse... – C’est fini, ça. – Oui, même là où la maîtrise est bonne... – Oh ! les salopards ont fait tout ce qu’il fallait pour nous amener là. Mais ils le paieront ». [58] Il est injuste que les patrons soient détestés : parce qu’ils « font vivre » leurs ouvriers, ceux-ci sont leurs obligés et ils leur doivent une certaine reconnaissance. Ce sentiment est évidemment plus fort chez les patrons des petites et moyennes entreprises que des grandes. Les dirigeants des sociétés anonymes sont moins directement concernés que les industriels propriétaires de leurs entreprises, et cette différence a été très généralement soulignée. [59] Elle explique les contradictions qui font exploser l’organisation patronale après les accords Matignon et entraînent sa recomposition. [60] Il ne s’agit pas seulement de divergences économiques, les petites entreprises pouvant plus difficilement absorber les hausses de salaires que de grandes entreprises taylorisées où l’on pouvait travailler en plusieurs équipes. Il s’agit d’abord de la mise en cause personnelle du patron par ses ouvriers, de l’image de soi patronale. Ce qui rend la discussion avec les ouvriers parfois impossible. Le patron de la Samaritaine, un grand magasin, Gabriel Cognacq, accepte de recevoir une délégation, mais il suffoque de colère, « explose, tape sur la table, parle d’ingratitude : “Je suis tombé malade à force de travail...” » et la rencontre tourne court. [61] Un exemple caricatural, mais significatif, de cette attitude est fourni par ce patron de trois usines de coton de la Côte-d’Or qui évoque, dans une lettre au préfet, « les sentiments que nous voulons voir régner dans notre personnel, afin de nous permettre de leur pardonner quand ils le mériteront leur conduite inqualifiable », et qui obligea ses ouvriers, pour les reprendre après la grève, à signer un véritable acte de contrition : Regrettant de nous être mal conduits vis-à-vis de vous, en nous mettant en grève, nous vous prions de nous pardonner, et, en nous embauchant, de nous permettre de nous racheter dans l’avenir par une conduite exemplaire. En vous remerciant à l’avance, agréez, Monsieur Marchal, nos salutations respectueuses. [62] C’est précisément ce lien personnel, déjà entamé par les licenciements de 1930-1935 [63] que les grévistes refusent, y compris dans les grandes entreprises. Chez Sautter-Harlé, le grand patron tente d’inciter « ses ouvriers » à reprendre le travail. Le responsable du comité de grève « a bondi sur le marbre, coupé la parole au patron et improvisé une intervention dans laquelle il faisait comprendre aux ouvriers qu’ils n’étaient pas les ouvriers du patron et au patron que les ouvriers n’étaient pas “ses” ouvriers. Le patron a dû quitter le marbre sous les huées ». [64] Juin 1936 acte ainsi la délégitimation du paternalisme et institue une rupture profonde. Jean-Paul Sartre l’a bien perçue et mise en scène dans L’enfance d’un chef. Son héros, Lucien Fleurier, est le fils d’un industriel à qui il doit succéder. Quand il était petit et qu’il se promenait le dimanche avec son père, « on rencontrait des ouvriers de papa qui saluaient papa », qui l’appelaient monsieur et qui enlevaient leur casquette pour leur parler tandis que Lucien et son père gardaient la leur. A une date qui n’est pas précisée, mais que le contexte permet de situer vers le Front populaire, « la mentalité des ouvriers de M. Fleurier avait beaucoup changé... Quand Lucien faisait, le dimanche, un petit tour de promenade avec son père, les ouvriers touchaient à peine leur casquette en les voyant et il y en avait même qui traversaient pour n’avoir pas à saluer ». [65] Ce qui est en jeu, dans les occupations d’usine, c’est la nature même du lien entre patrons et ouvriers, celle du contrat de travail. Que l’usine soit ou non la propriété du patron importe peu ici; ce qui compte, c’est que le patron n’y soit pas chez lui au même sens qu’il est chez lui dans sa maison, avec sa famille. Le paternalisme, qui incarnait pour les patrons la bonne façon de remplir leur rôle, se trouve contesté dans ses fondements mêmes. L’entreprise n’est pas une grande famille, et les ouvriers ne sont pas des domestiques, des serviteurs; ils ne s’engagent pas pour autre chose que pour un travail déterminé, payé d’un salaire déterminé. Ils n’attendent pas de bienfaits de leurs patrons et ne leur doivent en contrepartie aucun service, aucune allégeance. Le contrat de travail est d’ordre public, et son contenu doit faire l’objet non d’une négociation personnelle impossible entre chaque salarié et l’employeur, mais d’une négociation entre syndicats et patronat. La grande nouveauté, en ce sens, ce sont les conventions collectives, et il est révélateur qu’elles ne se généralisent qu’à partir du Front populaire, alors qu’elles ont été instituées par une loi de 1919. [66] Collective, la convention détermine le mode d’autorité légitime dans l’atelier et exclut toute forme d’arbitraire. C’est pourquoi la question des petits chefs et de leur pouvoir est si cruciale : dans un espace public, régi par des règles générales, l’arbitraire des petits chefs qui peuvent, sur un mouvement d’humeur, renvoyer un salarié au chômage n’est plus tolérable. Les délégués d’atelier sont là pour faire respecter les règles et ils donnent aux problèmes personnels une expression publique et collective. Dans les grands magasins, une des revendications fondamentales est celle d’un conseil de discipline, pour éviter les renvois arbitraires. [67] Partout, la question de l’embauchage et du débauchage est posée, ce qui irrite au plus haut point les patrons, car ils entendent choisir leur personnel, et le faire éventuellement en fonction de critères de comportement hors travail qui pourraient avoir sens s’il s’agissait de domestiques appelés à partager l’intimité familiale et le soin des enfants, mais qui sont déplacés dans l’espace public de l’usine ou du grand magasin. Avec le Front populaire, le lieu de travail sort ainsi de la sphère privée pour entrer dans la sphère publique. Le contrat de travail n’institue pas un lien personnel de subordination, mais un lien fonctionnel de production. Du coup, la détermination même du salaire en est affectée : elle ne relève plus du bon vouloir ou de la générosité patronale, mais de la convention collective, et des procédures obligatoires de conciliation et d’arbitrage sont mises en place pour trancher les désaccords sur ce point [68][68] Sur l’importance de ces procédures, le livre de J..... La propriété privée de l’entreprise subsiste, mais le pouvoir patronal est encadré par des règles formelles qui définissent ce que le patron est en droit d’attendre de ses employés. Rien n’illustre mieux cet enjeu central du Front populaire qu’une anecdote, rapportée par Bénigno Caceres. A l’époque, il était ouvrier dans une petite entreprise du bâtiment, à Toulouse. Un dimanche matin, qu’il prenait l’air assis sur une chaise devant chez lui, son patron vint à passer. Des bonjours sont échangés, une conversation s’instaure, et son patron lui demande un service : « A propos, j’ai laissé ma voiture là-bas, tu serais gentil si tu avais un moment de la laver ce matin ». Et Caceres de répondre : « Excusez-moi, Monsieur, mais ce n’est pas prévu par la convention collective ». Au terme de ce nouvel examen, ce qui frappe sans doute le plus dans l’épisode du Front populaire, c’est l’adéquation des conquêtes ouvrières à la situation économique, sociale et politique. L’occupation s’inscrit dans l’exact prolongement des manifestations qui scandent l’ascension de ce grand mouvement social et politique. Les 40 heures et les congés payés répondent à la surexploitation entraînée par la crise économique dans des entreprises en voie de rationalisation. Ils donnent réalité et consistance au temps privé des salariés. Symétriquement, les conventions collectives et les délégués d’atelier instituent un nouveau régime du contrat de travail, conçu comme contrat d’ordre public dans des entreprises qui restent la propriété de leurs actionnaires. L’extension de l’espace privé de la vie ouvrière s’accompagne du passage dans l’espace public du travail ouvrier. Par quoi s’introduit, dans l’univers du travail, une modernité décisive où les salariés conquièrent leur dignité d’hommes libres.
Notes
- Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris I.
- J. KERGOAT, La France du Front populaire, Paris, La Découverte, 1986.
- Au procès de Riom, L. Blum raconte que Lambert-Ribot l’a fait contacter par l’intermédiaire de Grunebaum-Ballin, le vendredi matin (L’œuvre de Léon Blum, t. V : 1940-1945, Paris, A. Michel, 1955, p. 261). Cette version est démentie par A. ROSSITER, « Popular Front economic policy and the Matignon negotiations », The Historical Journal, 30,3,1987, p. 663-684, qui se fonde sur le récit donné par le président de la Chambre de Commerce de Paris, Dalbouze, à son bureau, le 8 juin 1936 après-midi. Cet article est ignoré de S. WOLIKOW, Le Front populaire en France, Bruxelles, Éd. Complexe, 1996. M. TORI-GIAN, Every Factory a Fortress. The French Labor Movement in the Age of Ford and Hitler, Athens, Ohio University Press, 1999, cite cet article en bibliographie mais n’en tient pas compte dans son récit, p. 99-100. J. GARRIGUES, Les patrons et la politique. De Schneider à Seillière, Paris, Perrin, 2002, p. 183 date la rencontre du 5 juin au soir et ne donne pas de références.
- Le nombre officiel est de 1 831 000 grévistes et 12 142 grèves en juin d’après les statistiques du ministère du Travail.
- F. MAZABRAUD, Les grèves de 1936 en Haute-Vienne, mémoire de maîtrise, Université Paris I, 1980; de même, à Clermont-Ferrand, l’influence syndicale pèse contre la grève dans le livre ou à l’usine à gaz. Voir E. PANTHOU, L’année 1936 dans le Puy-de-Dôme, Paris, F.E.N.-U.N.S.A., Cahiers du Centre fédéral, no 14,1995.
- F. MARLIN, Pour la République, la Paix, la Liberté. Le Front populaire en terre radicale : le Loiret 1934-1939, thèse, Université de Paris VIII [J.-P. Brunet], 1994.
- « Images du Front Populaire, Finistère 1934-1938 », Skol Vreizh, no 7, mars 1987, p. 49.
- F. CAHIER, La classe ouvrière havraise et le Front populaire, 1934-1938, mémoire de maîtrise, Université de Paris I [J. Droz, J. Girault], 1980, p. 55.
- J. LHOMME, « Juin 1936 », in A. SIEGFRIED (dir.), Aspects de la société française, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1954, p. 73-93.
- Léon Blum au procès de Riom, op. cit., p. 167, qui cite ici un article de Lucien Romier dans Le Figaro du 1er septembre 1936.
- Elle est lancée par J. BARDOUX, « Le complot du 12 juin », Revue de Paris, 15 août 1936, et reprise, à gauche, par P. MONATTE, La Révolution prolétarienne, 25 juin 1936, pour qui le P.C.F. aurait cherché à pousser Blum à laisser le gouvernement à une personnalité comme Édouard Herriot. Je l’ai longuement réfutée dans un article, « Les grèves de juin 1936, essai d’interprétation », in Léon Blum chef de gouvernement 1936-1937, Paris, A. Colin, 1967, p. 69-87. J. JACKSON, The Popular Front in France. Defending Democracy 1934-1938, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, partage cette analyse p. 87 sq.
- B. BADIE, Stratégie de la grève, Paris, Presses de la F.N.S.P., 1976, p. 69; J. KERGOAT, La France..., op. cit., p. 102.
- En 1934, le P.C.F. compte 80 cellules dans la métallurgie pour toute la France, 2 dans le textile, 8 dans les produits chimiques, contre respectivement 94,16 et 25 dans les chemins de fer, la poste et les services publics, qui ne se mettent pas en grève. Cf. R. ALLOYER, « Nos forces dans les entreprises », Cahiers du Bolchevisme, 1er février 1934, p. 180 sq.
- Déclaration au Comité confédéral national, citée par J. KERGOAT, La France..., op. cit., p. 148. Sur les permanences syndicales débordées de délégués de grévistes venus demander conseil et soutien, voir de nombreux témoignages dans G. LEFRANC, Juin 36, « l’explosion sociale » du Front Populaire, Paris, Julliard, 1966.
- A. PROST, La C.G.T. à l’époque du Front populaire, essai de description numérique, Paris, A. Colin, 1964.
- M. TORIGIAN, Every Factory..., op. cit., donne plusieurs exemples p. 99 sq.
- E. SHORTER et C. TILLY, Strikes in France 1930-1968, Cambridge, Cambridge University Press, 1974, citant G. Lefranc, font des trotskistes, anarchistes, pivertistes et communistes de stricte obédience les cadres du mouvement, soulignant qu’il s’agit de militants politiques plutôt que syndicaux (p. 133). Nous reviendrons sur cette généralisation trop rapide, que ne confirment ni les travaux ultérieurs de G. Lefranc ni nos propres recherches.
- B. BADIE, « Les grèves du Front populaire aux usines Renault », Le Mouvement Social, no 81, octobre-décembre 1972, p. 69-109, p. 82. Voir aussi J.-P. DEPRETTO, S. V. SCHWEITZER, Le communisme à l’usine. Vie ouvrière et mouvement ouvrier chez Renault, 1920-1939, Roubaix, EDIRES, 1984, p. 181 sq.
- F. CAHIER, La classe ouvrière havraise..., op. cit.; L. EUDIER, « Breguet-Le Havre : première grève-occupation en 1936 », Cahiers d’histoire de l’institut Maurice Thorez, 1972, no 29, p. 67-70.
- Les radicaux perdent 570 000 voix par rapport à 1932 (1 745 000 contre 2 315 000), les socialistes de toutes nuances en gagnent 172 000 (2 203 000 contre 2 034 000), et les communistes en gagnent 686 000 (1 469 000 contre 783 000), soit un gain de 288 000 voix par rapport à 1932.
- J’ai étudié en détail ces manifestations : « Les manifestations du 12 février 1934 en province », Le Mouvement Social, no 54, janvier-mars 1966, p. 7-27.
- Voir D. TARTAKOWSKY, « Stratégies de la rue, 1934-1936 », Le Mouvement Social, no 135, avril/juin 1986, p. 31-62, et Les Manifestations de rue en France 1918-1968, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997, notamment chapitres 12 et 13, p. 307-361.
- D. TARTAKOWSKY, Les Manifestations..., op. cit., p. 358.
- D. TARTAKOWSKY, « Le cinéma militant des années 1930, source pour l’histoire du Front populaire », Les cahiers de la Cinémathèque, no 71, décembre 2000, p. 15-24.
- A. SAUVY, Histoire économique de la France entre les deux guerres, t. II : 1931-1939, Paris, Fayard, 1967, tableaux 7,8 et 9, p. 500,520 et 521.
- Contre 453 000 en 1931 et 537 000 en 1926.
- Voir N. BAVEREZ, « Chômage et marché du travail sous le Front populaire », Le Mouvement Social, no 135, avril-juin 1986, p. 106-108 et « Chômage des années 1930, chômage des années 1980 », ibid., no 154, janvier-mars 1991, p. 103-130.
- Voir R. SALAIS, « La formation du chômage moderne dans les années trente », Économie et statistique, no 155, mai 1983, p. 15-29.
- La même contraction purement démographique de la population active se constate en Allemagne, et elle contribue fortement à la réduction du chômage que les nazis attribuent à leur politique économique. Voir T. MASON, Social Policy in the Third Reich. The Working Class and the « National Community », Providence/Oxford, Berg, 1993.
- Caractéristique de ce comportement patronal, la répartition des chômeurs en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, connue dans les industries métallurgiques et mécaniques : si, avec la prolongation de la crise, on licencie davantage des ouvriers anciens, le gros des chômeurs a été employé depuis moins d’un an (55 % en 1931,42 % en 1935). Les ouvriers de 5 ans d’ancienneté et plus mis au chômage représentent 11 % de l’ensemble en 1931 et 25 % en 1935, ce qui est encore relativement peu. Voir C. RIST, Les chômeurs d’après une enquête récente. Communication à la Société de Statistique de Paris, Paris, Berger-Levrault, 1942.
- A. SAUVY, Histoire économique..., op. cit., p. 545.
- On peut voir dans cette donnée l’une des raisons de l’opposition viscérale des milieux conservateurs à toute dévaluation qui aurait affecté de nouveau les revenus des rentiers. Sur l’analyse de la crise économique en France, voir le no 154, déjà cité, du Mouvement Social (dirigé par R. BOYER ).
- A. P. MICHEL, L’introduction du travail à la chaîne aux usines Renault 1917-1939, Paris, J.C.M. Éditions, 1997,32 p.
- A. MOUTET, « Les origines du système de Taylor en France. Le point de vue patronal (1907-1914) », Le Mouvement Social, octobre-décembre 1975, p. 15-51; Les Logiques de l’entreprise. La rationalisation dans l’industrie française de l’entre-deux-guerres, Paris, Éd. de l’ E.H.E.S.S., 1997. Voir aussi P. FRIDENSON, Histoire des usines Renault, t. I : Naissance de la grande entreprise, 1898-1939, 2e éd., Paris, Éd. du Seuil, 1998; « Un tournant taylorien de la société française (1904-1918) », Annales E.S.C., septembre-octobre 1987, p. 1031-1060; S. V. SCHWEITZER, Des engrenages à la chaîne. Les usines Citroën 1915-1935, Lyon, P.U.L., 1982. La montée des O.S. s’accompagne d’une féminisation relative de la main-d’œuvre qui, dans le travail des métaux ordinaires de la Seine, passe de 14,5 % en 1921 à 17,4 % en 1936 (C. OMNÈS, Ouvrières parisiennes. Marchés du travail et trajectoires professionnelles au XXe siècle, Paris, Éd. de l’ E.H.E.S.S., 1997).
- S. WEIL, La Condition ouvrière, Paris, Gallimard, 1968 [1re éd. 1951], p. 45-145. Voir aussi les rapports de stage de l’école des surintendantes d’usine cités par A. FOURCAUT, Femmes à l’usine en France dans l’entre-deux-guerres, Paris, Maspero, 1982.
- Deux articles du no 154, déjà cité, du Mouvement Social (C. OMNÈS, « La politique d’emploi de la Compagnie française des Téléphones Thomson-Houston face à la crise des années 1930 », p. 41-61, et D. PHAN, « Productivité, emploi et salaires ouvriers chez Renault autour des années 1930 », p. 63-101) confirment cette analyse. Dans les deux cas, le niveau de vie annuel des ouvriers ou des ouvrières augmente entre 1930 et 1935 en raison d’une croissance de la productivité. Mais celle-ci résulte d’organisations très différentes. Chez Renault, la proportion de salaires aux pièces augmente et concerne 81 % du personnel en 1937; l’ajustement à la conjoncture repose sur le chômage partiel et les heures supplémentaires. P. FRIDENSON, Histoire des usines Renault..., op. cit., p. 206 sq., l’avait déjà signalé, ainsi que des substitutions d’ O.S. à des ouvriers qualifiés. Chez Thomson-Houston, l’ajustement conjoncturel passe par la fluctuation des effectifs, dans un marché du travail où les ouvrières licenciées retrouvent en général assez vite du travail, ou de nouvelles embauches. La compagnie cesse d’investir en 1932 et pourtant les gains de productivité, de l’ordre de 2,7 % par an, permettent de maintenir le niveau des salaires, avec une réduction légère de l’écart entre salaires féminins et masculins. Ces gains de productivité ne viennent pas de l’introduction du salaire aux pièces, qui concerne toutes les ouvrières dès 1930, mais, dans un contexte de turn-over rapide, d’une politique de sélection fine de la main-d’œuvre à la sortie comme à l’entrée.
- G. LEFRANC, Juin 36..., op. cit., p. 210.
- J. KERGOAT, La France..., op. cit., p. 149, qui cite sans source une chanson mettant en cause ce système.
- R. HAINSWORTH, « Les grèves du Front populaire de mai et juin 1936 », Le Mouvement Social, no 96, juillet-septembre 1976, p. 3-45. Repris avec d’autres articles de la revue dans J. BOUVIER (dir.), La France en mouvement 1934-1938, Seyssel, Champ Vallon, 1986.
- A. PROST, « Le climat social », in R. RÉMOND et J. BOURDIN (dir.), Édouard Daladier, chef de gouvernement, Paris, Presses de la F.N.S.P., 1977, p. 99-128. Ces résistances au retour aux normes antérieures de productivité ont été depuis mises en lumière dans l’automobile, l’aviation et le bâtiment par M. SEIDMAN, « The Birth of the Week-End and the Revolts against Work : The Workers of the Paris Region during the Popular Front (1936-1938) », French Historical Studies, vol. XII, no 2, Fall 1981, p. 249-276 et son livre, Workers Against Work : Labor in Paris and Barcelona during the Popular Fronts, Berkeley, University of California Press, 1991. Voir également H. CHAPMAN, State Capitalism and Working-Class Radicalism in the French Aircraft Industry, Berkeley, University of California Press, 1991.
- S. WEIL, « Enseignements à tirer des conflits du Nord », in La condition ouvrière, op. cit., p. 267-278, citation p. 269.
- Sur les patrons, voir J. LHOMME, « Juin 1936 », art. cit., I. KOLBOOM, La revanche des patrons. Le patronat français face au Front populaire, Paris, Flammarion, 1986, le témoignage anonyme « Journal d’un patron. Une collaboration de classes est-elle possible ? », Études, juin et juillet 1938, p. 332-346 et 433-446, et une lettre de S. Weil à Auguste Detœuf rapportant une conversation entendue dans le train, in La condition ouvrière, op. cit., p. 255-259.
- Cité par G. LEFRANC, Juin 36..., op. cit., p. 132.
- J. DANOS, M. GIBELIN, Juin 1936, Paris, Éditions ouvrières, 1952; C. AUDRY, Léon Blum ou la politique du juste, Paris, Julliard, 1955; D. GUÉRIN, Front populaire, révolution manquée, Paris, Julliard, 1963; M. JAQUIER, Simple militant, Paris, Denoël, 1974; J. KERGOAT, La France..., op. cit.
- J. KERGOAT, La France..., op. cit., p. 155, qui cite, sans source, une ouvrière de la raffinerie Say occupée disant : « ce n’est plus “la boîte”, c’est notre usine ».
- J. DANOS et M. GIBELIN, Juin 1936, op. cit., p. 95; J. KERGOAT, La France..., op. cit., p. 155-156.
- P. BROUÉ et N. DOREY, « Critiques de gauche et opposition révolutionnaire au Front populaire », Le Mouvement Social, no 54, janvier-mars 1966, p. 91-133, donnent le meilleur bilan de ces tentatives.
- J. COUTROT, L’Humanisme économique. Les leçons de juin 1936, Paris, Centre polytechnicien d’études économiques, 1936, récuse même le terme d’occupation en raison de ses connotations militaires et préfère dire les usines « habitées » (p. 16). Sur lui, voir O. DARD, Jean Coutrot. De l’ingénieur au prophète, Besançon, Presses universitaires franc-comtoises, 1999, p. 247 sq. et M. A. BEALE, The Modernist Enterprise. French Élites and the Threat of Modernity, 1900-1940, Stanford, Stanford University Press, 1999, p. 145-164. H. PROUTEAU, Les occupations d’usine en Italie et en France, Paris, Librairie technique et économique, 1938.
- « La vie et la grève des ouvrières métallos », article paru sous le pseudonyme de S. Galois dans La Révolution prolétarienne, 10 juin 1936, S. WEIL, La condition ouvrière..., op. cit., p. 218-237. Citation, p. 231-232 et 237. Souligné par moi.
- Le premier est sans doute M. COLLINET, qui consacre un chapitre de son livre : Esprit du syndicalisme, Paris, Éditions ouvrières, 1951, à « Une grève-kermesse ».
- La condition ouvrière..., op. cit., p. 230.
- Témoignage recueilli par A. MARRAST, Mémoires des grèves de 36 dans les grands magasins, mémoire de maîtrise, Université de Paris I, 1986, p. 101.
- M. TORIGIAN, Every Factory..., op. cit., p. 60-61. Voir aussi dans la partie non publiée de la thèse d’État d’ A. MOUTET, La rationalisation industrielle dans l’économie française au XXe siècle, Université Paris X-Nanterre, 1992, t. III, p. 1341-1374.
- G. FUNFFROCK, Les grèves ouvrières dans le Nord (1919-1935). Conjoncture économique, catégories ouvrières, organisations syndicales et partisanes, Roubaix, EDIRES, 1988, p. 313.
- Ibid., p. 324.
- A. PROST, « Les grèves de juin 1936... », art. cit., p. 69-87.
- J. LHOMME, « Juin 1936 », art. cit., p. 92, en italiques dans le texte.
- E. J. HOBSBAWM, « Birth of a Holiday : the First of May », in C. WRIGLEY, G. WOO (eds.), On the Move : Essays in Labour and Transport History presented to Philip Bagwell, Londres, The Hambeldon Press, 1991, p. 104-122. Voir aussi G. DENECKERE, M.-L. GEORGEN, I. MARSSOLEK, D. TARTAKOWSKY et C. WRIGLEY, « Premiers mai », in J.-L. ROBERT, F. BOLL, A. PROST (dir.), L’invention des syndicalismes. Le syndicalisme en Europe occidentale à la fin du XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997, p. 199-217.
- S. WEIL, La condition ouvrière..., op. cit., p. 256. C’est S. Weil qui souligne.
- Voir par exemple un article de Jacques Barnaud dans les Nouveaux cahiers, cité par G. LEFRANC, Juin 36..., op. cit., p. 274.
- Voir sur ce point I. KOLBOOM, La revanche des patrons..., op. cit.
- G. LEFRANC, Juin 36..., op. cit., p. 216.
- Cité par Le Peuple, 21 août 1936.
- Ainsi chez Michelin, ce bastion où le paternalisme résiste. Voir A. GUESLIN (dir.), Michelin, les hommes du pneu. Les ouvriers Michelin à Clermont-Ferrand de 1889 à 1940, Paris, Éd. de l’Atelier, 1993. L. BADEL, Un milieu libéral et européen. Le grand commerce français 1925-1948, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1999, note de même, p. 52, mais pour d’autres raisons, une « profonde remise en cause du paternalisme patronal » dans L’Employé parisien au début de 1936.
- G. LEFRANC, Juin 36..., op. cit., p. 202.
- J.-P. SARTRE, Le Mur, Paris, Gallimard, 1939, p. 147 et 159.
- Cf. C. DIDRY, Naissance de la convention collective. Débats juridiques et luttes sociales en France au début du XXe siècle, Paris, Éditions de l’E.H.E.S.S., 2002.
- Le patronat cède sur les salaires pour tenter de résister sur le conseil de discipline et ne reconnaît ce nouveau droit que le 21 juin sur un arbitrage du ministre de l’Intérieur. Voir L. BADEL, Un milieu libéral..., op. cit., p. 54.
- Sur l’importance de ces procédures, le livre de J. COLTON, Compulsory Labor Arbitration in France, 1936-1939, New York, King’s Crown Press, 1952, reste fondamental. Voir aussi notre contribution au colloque Daladier, déjà citée.
php
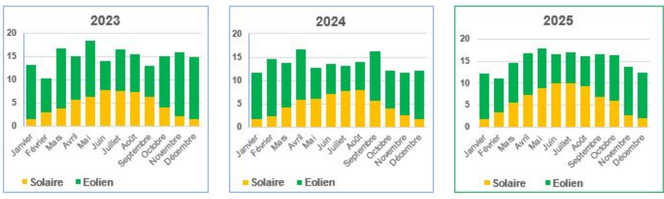
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire